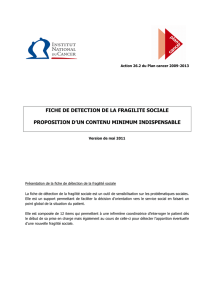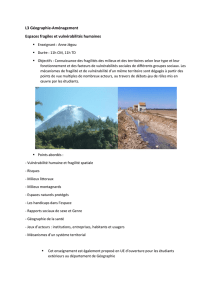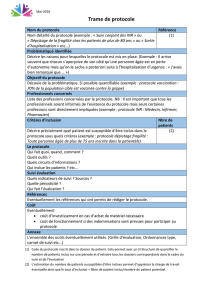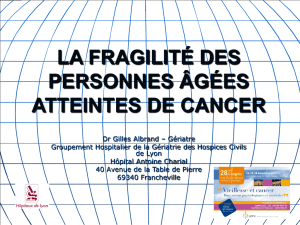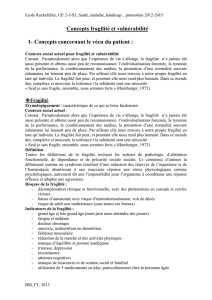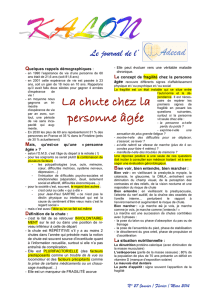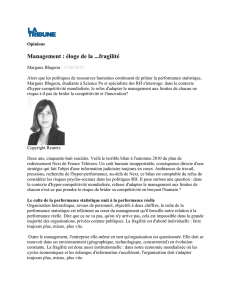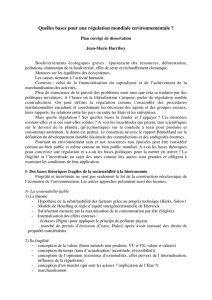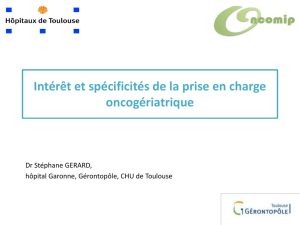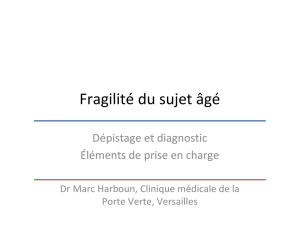Téléchargez la transcription de l`intervention d`Elena Lasida

Intervention d’Elena Lasida
!
Elena Lasida est membre de l’institut catholique de Paris, où elle dirige un master en
économie sociale. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrage!: Finance et bien commun (2009),
Oser un nouveau développement, au-delà de la croissance au-delà de la croissance et de
la décroissance (2010) et récemment Le gout de l’autre, la crise, une chance pour
réinventer le lien.
!
Le thème de ces Rencontres m’a tout de suite interpellé. Le terme de fragilité est devenu,
depuis quelque temps, très à la mode!; il apparaît de manière récurrente dans de nombreux
colloques, rencontres, échanges. Le mouvement Esprit civique met par exemple la
question de la fragilité au centre de sa réflexion lors d’une rencontre à Cluny le 4 octobre
2014. La fragilité apparait aujourd’hui comme une référence, et la nouveauté, c’est que ce
terme n’est pas employé pour désigner un problème à résoudre ou un manque à combler,
mais plutôt comme la source de quelque chose de nouveau. Cela renvoie donc à quelque
chose de l’autre, et je pense que quelque chose de nouveau est en train d’être dit sur
l’humain.
Je voudrais développer ici une réflexion en trois points. A titre personnel, une première
résonance, selon moi, c’est que la fragilité touche quelque chose de profondément humain.
Nous sommes tous fragiles. Une deuxième résonnance relève de l’ordre de la théorie
économique, qui de manière générale n’évoque jamais la question de la fragilité. Pourtant,
cette fragilité permet aujourd’hui des ouvertures au niveau même de la théorie
économique. Enfin, je donnerai quelques exemples très concrets de la manière dont cette
fragilité, que je vois aujourd’hui dans des dimensions et des lieux différents, peut produire
de l’intelligence collective.
Au premier niveau, mon expérience personnelle est celle d’une étrangère!: je ne suis pas
Française. L’expérience de l’étranger est une expérience de la différence. En tant
qu’étrangère, j’ai vécu en particulier trois sortes de fragilité, qui m’ont fait découvrir quelque
chose de nouveau. La première, c’est l’expérience radicale de toute personne arrivant dans
un pays étranger pour une longue durée!: la solitude. Pour moi, cela a été l’occasion de faire
d’improbables rencontres!; justement parce que j’étais étrangère dans un lieu inconnu, je
me suis rapprochée d’abord des personnes qui partageaient les mêmes fragilités. Je suis
venue comme étudiante, je parlais très mal le français et évidemment, les autochtones
n’avaient pas la patience de m’écouter. Je me suis donc rapprochée des étrangers. Après
coup, j’ai réalisé que ces personnes, devenues mes amies, étaient très différentes de moi!:
je ne les aurai jamais choisies comme amies dans mon pays. Nous avions des choix de vie
ou des orientations politiques souvent très opposés, mais nous nous sommes retrouvés
dans une expérience de fragilité commune, ce qui nous a permis de partager quelque
chose de fondamental. Ca m’a beaucoup fait réfléchir. On se retrouve souvent avec une
étiquette qui vous colle à la peau, or la fragilité est une manière de déconstruire les
étiquettes, de se trouver à un niveau différent.

Ma deuxième expérience de fragilité liée à l’étranger, c’est le fait de se retrouver dans un
lieu avec lequel on n’a aucune appartenance historique commune. En France, quand vous
rencontrez une personne, vous vous en faites une représentation à partir de son lieu, de sa
ville d’origine. De même, le lieu de ses études ou sa famille offrent une référence commune
qui permet de savoir quelque chose sur cette personne. Pour les Français, je ne venais de
nulle part, je n’avais aucune histoire commune avec eux. Cela a représenté une expérience
profonde de liberté. C’est difficile d’être considérée comme une espèce d’OVNI. Du coup,
on est en dehors du moule. Moi-même, je me sens plus libre dans un lieu où les autres ont
de nombreuses références communes. Au niveau relationnel, le fait d’être en dehors du
moule permet des confidences et une liberté que peu de gens ont. Cette expérience de
non-appartenance, de non-historicité a été une expérience de liberté.
La troisième et dernière chose, qui a été très difficile à vivre pour moi, c’est mon accent.
Quand je suis arrivée en France, la première question que l’on me posait systématiquement
était!: «!D’où venez-vous!?!». C’est intéressant, bien sûr, car cela dénote une curiosité, un
esprit d’ouverture chez ceux que je rencontrais. Mais lorsqu’on s’entend poser cette
question à longueur de journée, on se sent en permanence d’ailleurs. On vous renvoie sans
cesse votre statut d’étranger. A un moment, j’ai donc décidé d’essayer de perdre mon
accent. J’ai découvert à cette occasion que l’accent donne une couleur, une tonalité
différente aux mots. Certains mots, dits avec l’accent, étaient entendus de manière
différente. Cette expérience, avant tout négative, m’a donc révélé quelque chose de positif!:
les mots ne sont pas seulement le contenu qu’ils signifient, mais aussi la musique qui les
accompagne. A travers la musique se transmet aussi quelque chose.
Ces exemples d’étrangeté, qui relèvent d’une fragilité personnelle, m’ont donné une
manière particulière d’envisager les choses, en croisant deux logiques de pensée
différentes!: la logique du nord, plutôt cartésienne, qui va séparer, ordonner et classer (et
qu’on connait très bien en France), et la logique du sud, qui est plutôt une pensée du récit,
un peu circulaire. C’est en racontant qu’on arrive à l’essentiel. Ces deux manières de penser
sont à l’intérieur de moi, et leur croisement a produit une logique de penser propre qui est
la mienne. Pour moi, c’est de l’intelligence collective!: ces pensées, je les ai reçues de
peuples, d’histoires, de traditions différentes.
Changeons maintenant de registre pour passer à la théorie économique. Ce qu’on appelle
le paradigme dominant, la théorie néoclassique, ne parle jamais de fragilité. Cette théorie
est centrée sur l’idée que l’on peut donner réponse à tout. L’économie se présente souvent
comme cette pensée unique qui aurait réponse à tout. Aujourd’hui cependant, à travers la
rencontre avec d’autres disciplines, l’économie découvre progressivement la source et la
fécondité de cette fragilité qu’elle voyait uniquement comme un problème à résoudre. La
théorie économique est dont en train de se déplacer, ce que j’illustrerai avec trois mots.
Le premier, c’est celui de complétude. L’idée de l’humain sous-jacente à la théorie
économique néoclassique, c’est ce qu’on appelle souvent l’Homo oeconomicus!: quelqu’un
qui dispose d’une rationalité parfaite, d’une capacité cognitive illimitée. Il peut avoir toute
l’information nécessaire, la gérer et choisir en fonction de ses intérêts. Cet Homo
oeconomicus! est un type parfait, complet, qui n’a besoin de personne. Or l’incomplétude
c’est justement un manque de complétude. Parler d’incomplétude, c’est évoquer
l’asymétrie d’information entre les individus. Aujourd’hui, certaines théories économiques
font une place à l’incomplétude, à la notion de relation entre les gens, qui est normalement
absente dans la théorie néoclassique. Dans cette dernière, c’est l’objet, le rapport entre
l’homme et l’objet, qui est au centre. Penser l’humain comme un être incomplet, ayant
besoin des autres pour faire ses choix, met au centre non l’objet mais la relation. Cette
redécouverte donne naissance aujourd’hui à une économie de l’incomplétude. Dans son
ouvrage L’empire de la valeur. Refonder l’économie (2011), André Orléan évoque par
exemple la valeur économique comme une valeur relationnelle, en partant du fait que
l’homme économique est un être incomplet.
Deuxième mot au centre de la théorie économique, qui traduit la toute-puissance, c’est le
terme d’équilibre. Le paradigme dominant, en économie, c’est de parvenir à des situations
d’équilibre, où l’offre égale la demande. Certes, on est souvent en déséquilibre, mais il faut
viser l’équilibre. Mais là encore, la théorie économique est en train de faire l’expérience d’un
déséquilibre qui ouvre à quelque chose de nouveau, à une nouvelle manière de penser la
logique économique, permettant de faire place, par exemple, à des logiques de

coopération et pas seulement de concurrence. Cela vaut aussi pour les relations de
pouvoir. L’idée de déséquilibre permet de penser des notions jusque-là impensées par la
théorie économique. Apparaît alors au centre l’idée d’institution. La théorie néoclassique
postule des individus!; même les entreprises sont des agents considérées comme des
agents individuels. Au contraire, lorsqu’on se met à parler d’institution, on s’ouvre à d’autres
logiques que celle de la logique concurrentielle, de maximisation de l’intérêt. A travers le
déséquilibre s’ouvre des logiques nouvelles.
Le dernier mot important de la théorie néoclassique, c’est celui de certitude. Cette théorie,
part du principe qu’on est toujours en situation de certitude, ou d’incertitude
probabilisable!: si on ne sait pas, on peut tout de même calculer les probabilités qu’une
chose se produise ou non. En économie, on parle donc toujours de prévision parfaite. Le
futur doit être anticipé, parfaitement prévu. Aucune place pour l’incertitude. Mais
aujourd’hui, la théorie commence à prendre en compte le fait que l’incertitude permet
d’ouvrir à quelque chose de radicalement nouveau, qui ne pouvait pas être prévu ou
anticipé. L’incertitude ouvre un espace, un horizon, ce qui laisse la possibilité de
l’émergence du radicalement nouveau, pour reprendre le raisonnement d’Hanna Arendt, qui
différenciait la fabrication et la création. La fabrication, c’est construire quelque chose de
planifié à l’avance, c’est un travail d’ingénieur de planification et d’exécution. La création,
elle, est de l’ordre du bricolage!: lorsqu’on se met à construire, on ne connait pas la finalité
de cette production. Grâce à la nouvelle place accordée à l’incertitude, l’économie,
commence doucement à passer d’une logique de fabrication à une logique de création.
Voilà selon moi comment la fragilité, l’incomplétude, l’incertitude et le déséquilibre ouvrent
désormais des nouveaux possibles, des intelligences nouvelles, en termes de logique
économique.
A un troisième niveau, je voudrais enfin donner quelques exemples plus concrets, dans
trois domaines différents, de ces fragilités qui produisent de nouvelles formes
d’intelligence collective.
Le premier exemple s’inscrit dans le cadre universitaire, et concerne un travail de
recherche pour mettre au point une méthode afin d’évaluer l’utilité sociale de l’ARCHE, une
association créée par le Canadien Jean Vanier en 1964 pour accueillir, sous forme de vie
communautaire, des personnes avec un handicap mental. Nous avons là des personnes
qui, en général, sont considérés comme non intelligentes, or d’une certaine manière
l’ARCHE met en avant une autre forme d’intelligence. A l’occasion de ce travail d’évaluation,
j’ai découvert notamment combien la fragilité des personnes accueillies avait été source
d’innovation. La fragilité de base, acceptée comme telle, a permis d’introduire un modèle de
gouvernance beaucoup plus démocratique que celui que l’on trouve dans les associations
les plus démocratiques. En effet, du fait de la grande fragilité de départ, une gestion
démocratique classique de la vie communautaire était très complexe à mettre en place.
Afin de faire participer tout le monde, les responsables ont donc inventé un système de
discernement, dans lequel les décisions se prennent progressivement à travers des
procédures des rencontres. Une telle forme de gouvernance me semble beaucoup plus
démocratique que celle qui consiste à dire que toutes les personnes participent à la prise
de décision. Partir d’une fragilité, la prendre au sérieux, a conduit à inventer une nouvelle
manière de gouverner, de gérer ensemble une communauté.
Le deuxième exemple que je voudrais évoquer, c’est le secteur de l’économie sociale et
solidaire (ESS). A l’origine des différentes pratiques inventées dans le cadre de l’ESS, il y a
une prise en compte de la fragilité. Le commerce équitable part de la fragilité des petits
producteurs du sud qui n’accèdent pas au marché international. Le microcrédit part de la
fragilité des personnes pauvres qui ne peuvent pas accéder à un crédit bancaire
traditionnel. L’invention d’activités économiques d’insertion part du constat que de
nombreuses personnes se sont éloignées du marché du travail classique. A l’origine, il y a
toujours une fragilité. Ce que je trouve intéressant dans ce secteur, c’est que ces pratiques
ne sont pas des réponses apportées à la fragilité dans une logique de réparation. On ne
cherche pas à réparer, à combler des manques!: on invente une autre manière de faire
ensemble de l’économie, en mettant au centre le principe de l’interdépendance. L’économie
néoclassique part de l’idée que chacun est indépendant, que nous avons des besoins et
que le marché nous permet de satisfaire nos besoins et de maximiser nos intérêts!; elle
utilise beaucoup le langage mathématique, difficilement compréhensible pour beaucoup

de gens, et on a donc l’impression d’une vérité absolue. Mais grâce à la crise, on s’est rendu
compte que les économistes n’avaient pas la solution au problème et qu’au contraire,
parfois, ils produisent les problèmes. Au contraire, l’économie solidaire montre qu’on a tout
intérêt à se penser non pas comme des êtres indépendants et auto-suffisants, mais
comme des êtres interdépendants. Dans le commerce équitable, les consommateurs
accordent de l’importance aux intérêts des producteurs. La consommation n’est plus alors
seulement une manière de satisfaire des besoins individuels!; elle contribue aussi à
construire la société à travers l’acte de consommation. Le choix de consommation est un
choix politique. Il a un effet sur les autres. De manière générale, toutes les pratiques de
l’ESS ont quelque chose de révolutionnaire, elles disent justement que l’économie ne
recouvre pas tant une manière de satisfaire des besoins en produisant des biens et des
services nécessaires qu’une manière de construire une société. L’économie a pour finalité
première d’être un médiateur social, c’est le moyen dominant d’établir des relations les uns
avec les autres. Or cette dimension, cette richesse relationnelle de l’économie, qui n’est pas
prise en compte dans la théorie néoclassique, est au cœur de l’ESS.
Enfin, le dernier exemple que je voudrais aborder concerne un autre domaine!: celui du
développement durable et de notre rapport à la nature. Nous avons aujourd’hui pris
conscience que la nature est fragile, qu’elle s’épuise, qu’elle se dégrade. Cela nous oblige à
penser un autre rapport avec elle. Face à cette fragilité, il y a ceux qui estiment que la
technique a toujours apporté des réponses et que nous finirons par inventer une solution.
C’est une approche instrumentale de la nature. La fragilité de la nature ne produit rien, on va
simplement mettre en place des instruments nouveaux. Pour d’autres, la nature est quelque
chose de très important et appelle la décroissance!: il faut produire moins, consommer
moins, pour donner place à une nature presque sacralisée. Entre ces deux postures
extrêmes que sont l’instrumentalisation et la sacralisation, je pense que nous avons la
place pour penser un autre type de rapport avec la nature, de l’ordre de l’alliance. Ce
rapport reconnaîtrait que la nature est fragile qu’elle a quelque chose à nous donner et à
recevoir de nous, selon son rythme et ses besoins. Cette volonté d’établir une nouvelle
relation avec la nature conduit à penser à de nouvelles manières de consommer, de
produire, de se déplacer, une nouvelle manière de vivre ensemble. C’est un chantier
énorme, mais je pense qu’il est tout à fait propice pour inviter l’humanité à réfléchir à la
manière dont la fragilité peut être source d’intelligence collective.
Pour conclure, je dirais que le rapport entre micro et macro représente un très grand défi
aujourd’hui. Il s’agit de voir comment la multiplicité des pratiques au niveau micro-
économique donne à voir, à construire, quelque chose de nouveau. L’innovation venue d’en
bas est très importante!; lorsque j’observe autour de moi, je suis admirative devant la
capacité d’innovation, de créativité, d’imagination, des acteurs de la base. Mais il faut aussi
arriver à établir de nouvelles relations entre le haut et le bas. On ne peut pas imaginer que
les impulsions nés d’en bas vont se généraliser d’elles-mêmes. Les innovations au niveau
de la base, surabondantes, ne font pas un système. Elles ne forment pas un modèle
alternatif, mais proposent plutôt une pluralité d’expériences. Cela devrait susciter de la
créativité en haut, et il faudrait alors se retrouver dans des manières différentes de faire
ensemble. L’une des principales sources d’innovation, selon moi, réside aujourd’hui dans
les nouvelles formes de partenariats. Les territoires sont à la base de nombreux
partenariats entre entreprises et pouvoirs publics, entre pouvoirs publics et associations,
entre société civile et entreprises. Il y a là une source d’innovation très grande et je pense
que c’est par ce biais-là que viendra un changement général. !
!
Elena Lasida
1
/
4
100%