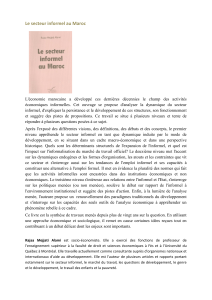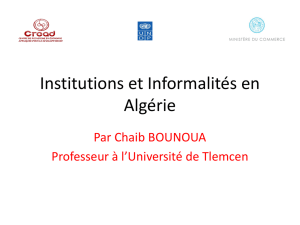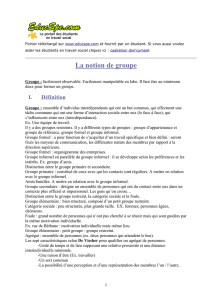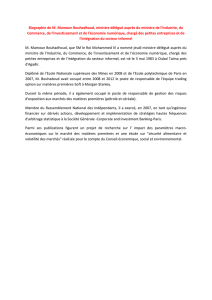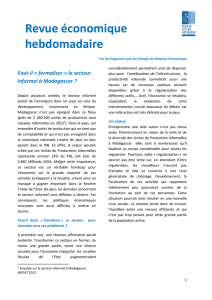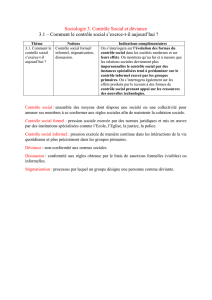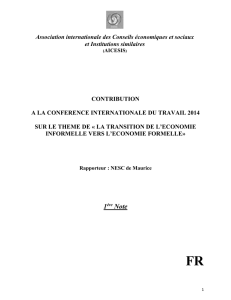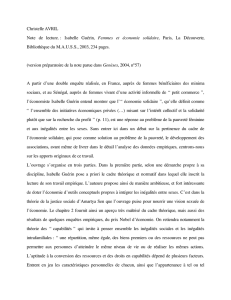inégalités et informalités dans les amériques

9
INÉGALITÉS ET INFORMALITÉS DANS LES AMÉRIQUES
Virginie BABY-COLLIN
Maître de conférences en géographie
Université de Provence, UMR TELEMMe
virginie.baby-[email protected]
Articuler inégalités et informalités dans les Amériques relève d’un triple défi. Alors que les deux
notions ont donné lieu à une abondante littérature scientifique, le pluriel auquel invite la réflexion
engage à prendre en compte la diversité de leurs acceptions.
D’abord, si la généralisation de la démocratie permet plus d’égalité politique et citoyenne, les
inégalités économiques et sociales ne cessent de croître ; elles relèvent aussi bien d’accès aux
droits, à la citoyenneté, qu’aux services urbains et sociaux, à l’éducation, au logement, à
l’emploi. Déclinées selon les appartenances ou assignations ethniques, le genre, l’âge, le lieu de
résidence, le statut légal ou illégal, les inégalités ont des impacts spatiaux, sont porteuses de
disparités territoriales que les politiques d’aménagement tentent, diversement, de corriger. Notion
philosophique, politique, géographique, mesurée sur le plan social et économique, l’inégalité,
fléau à combattre, est peu confrontée à l’informalité.
Economique dans son acception la plus généralisée, l’informalité peut ensuite être définie a
minima comme une part de l’activité économique qui échappe à certains cadres normatifs,
administratifs, statistiques, fiscaux (Charmes, 2003), ou, plus largement, comme « toutes les
activités génératrices de revenus, non régulées par l’Etat, dans des contextes sociaux où les
activités similaires sont réglementées » (Portes et alii, 1989 : 12). L’analyse protéiforme du
secteur puis de l’économie informelle renvoie aussi aux relations à l’Etat, qu’explore l’ouvrage
de Lautier, De Miras, Morice (1991). L’informel comme écart ou déviance à la norme, à la règle,
au droit, est investi par la sociologie de la déviance (travaux de H. Becker) et la science politique.
La notion s’est diffusée dans le champ des études urbaines (logement informel, services
informels…) lors de la transition urbaine des pays du sud qui a vu naître le concept économique -
à partir des études de Keith Hart (1973), au Ghana, puis de la publication du rapport du
programme mondial de l’emploi sur le Kenya, ILO (1972). L’économie informelle, pour certains
devenue la « globalisation populaire » (Lins Ribeiro, 2008), n’est cependant pas équivalente à
l’économie illicite, de laquelle relève par exemple le narco-trafic. Si toutes deux partagent l’usage
fréquent de la corruption, l’importance des relations de confiance, certains principes de
réciprocité, elles s’en distinguent sur le plan de la violence comme principe de fonctionnement :
omni-présente dans l’économie illicite, celle-ci ne caractérise guère l’économie informelle
(Sousa, 2004). Cette dernière peut être illégale pour l’Etat, mais elle est socialement licite et
protégée, pour les acteurs qui y ont recours, tant producteurs que consommateurs (Lins Ribeiro,
2008, Monnet, 2007). De nombreux auteurs ont contribué à éclairer ces différences entre
informel et illégal, s’insurgeant contre leur assimilation fréquente (notamment Portes, Haller,
2004 : 12)
Or, malgré le foisonnement des travaux existants, et bien que le premier rapport du BIT (ILO,
1972) pose la question économique de l’informel en relation avec celle de l’égalité, l’articulation
entre les informalités et les inégalités n’est que peu traitée en tant que telle. Les sciences sociales
ont surtout mis en relation les inégalités avec les notions d’injustice, d’inéquité, de disparités,

10
sociales, économiques, spatiales, ou avec la question plus générale du développement, ainsi que
de la persistance de la pauvreté (cf. Salama, 2006, 2009). L’informalité est observée sur le terreau
de situations de précarité, de pauvreté, de dynamiques de subsistance et de processus d’exclusion,
et interrogée à partir de ces dimensions. C’est aussi dans leur rapport à l’Etat, à la norme, à la
règle, que les informalités prennent leur sens. Formuler le questionnement sur les relations entre
informalités et inégalités implique ainsi, d’une certaine façon, de déplacer le regard.
Troisièmement, la difficulté de l’exercice ressortit de l’espace interrogé : les Amériques. Au-delà
de l’unité physique ou de l’horizon historique qui lui donne naissance en tant que « Nouveau
monde » en 1492, cet espace de plus de 900 millions d’habitants rassemble la première puissance
mondiale et certains des pays les plus pauvres de la planète, tels Haïti ; en termes de
développement, d’inégalités et d’informalités, voilà des contextes qu’il est peu aisé de confronter.
Pourtant, la mondialisation, questionnant l’étanchéité des frontières, invite à reconsidérer les
limites traditionnelles des territoires et leurs approches séparées ; la fondation récente de l’Institut
des Amériques en est un exemple. Les frontières culturelles entre mondes anglo-saxon et latin
sont questionnées, par la présence de plus de quarante millions d’Hispaniques aux Etats-Unis,
notamment la « Mexamérique » du sud-ouest, dont S. Huntington craint qu’elle ne mette en
danger l’identité étasunienne (2004, chapitre 9 : the hispanic challenge). Les frontières sont aussi
discutées dans les grandes villes latino-américaines, aux paysages et aux mœurs inégalement
« américanisés », qu’il s’agisse du règne de l’automobile, des shopping centers, ou de la
consommation de masse de plus en plus issue de standards et de produits d’origine étasunienne.
Les campagnes de bien des régions rurales affectées par les migrations internationales, du
Mexique à la Bolivie, traduisent aussi, via les échanges avec le Nord (El norte), des évolutions
d’ambiances, de pratiques – montée en puissance des églises évangéliques, par exemple –, de
paysages, qui rendent nécessaire la mise en lien scientifique des deux Amériques, dans des
contextes de transnationalisation massifs. L’accélération des échanges économiques, humains, et
des modes de mises en lien, qui justifie des questionnements articulant nord et sud plutôt que les
opposants (cf. Autrepart, « On dirait le sud… », 41/2007), n’amenuise pas pour autant les
inégalités. Au contraire : entre nord et sud, l’écart se creuse ; les pays dits développés concentrent
19% de la population et 80% des richesses, et l’écart de revenus avec les pays dits en
développement serait passé de 1 à 11 en 1870 à 1 à 30 en 1965, puis à 1 à 78 en 2000, alors que
les 20% des habitants les plus pauvres, qui disposent au début du XXIème siècle de 1,1% du
revenu mondial, en bénéficiaient de 2,3% en 1960 (Carroué, 2004 : 41). Lisibles aux échelles
macro-régionales, les inégalités s’expriment à bien d’autres niveaux. La crise financière et
économique actuelle, déclenchée aux Etats-Unis, met en évidence le creusement des inégalités au
sein même des populations et des espaces de la première puissance économique mondiale. Les
échelles de ces inégalités se recomposent, traversent des espaces urbains très ségrégués, que l’on
dit aussi fragmentés (cf. par exemple Navez Bouchanine, 2002). Il n’en demeure pas moins que
l’informel reste un phénomène économique majeur en Amérique latine, aux proportions peu
comparables avec les Etats-Unis et le Canada. Si nous tenterons de rester sensibles à cette échelle
américaine de référence, le traitement des Amériques dans la question posée rendra compte de la
saillance de sa partie latine, comme en témoignent aussi les terrains de recherches de la plupart
des auteurs de cette publication.
Le propos s’articule autour d’une double question : quelles sont les déclinaisons des inégalités et
des informalités dans les Amériques ? Et comment peut-on y articuler ces notions ?

11
Informalités, inégalités : quelles dimensions américaines ?
Du continent des inégalités au sud à leur creusement récent au nord
L’Amérique latine est le continent qui présente les plus fortes inégalités de revenus. En
témoignent les mesures économiques classiques, comme le coefficient de Gini : en moyenne
supérieur à 50 en Amérique latine (cf. tableau 1), il varie de 30 à 40 en Asie, est proche de 30 en
France, de 40 aux Etats-Unis (données indicatives, car variables selon les sources, sur une échelle
allant de 0 – égalité parfaite – à 100 – inégalité totale –). Comme le rappelle E. Ottone, secrétaire
général adjoint de la CEPAL (2008), les origines de ces inégalités renvoient à l’histoire régionale
: ancienneté de la concentration des actifs (productifs, éducatifs) entre les mains de quelques-uns,
inégalité foncière héritée du régime de l’encomienda et de la prédation des ressources liée à
l’économie coloniale agricole d’exportation et minière, concentration des influences et des
pouvoirs politiques entre les mains des élites économiques depuis plusieurs siècles… Au-delà de
ces dimensions structurelles, depuis le milieu des années 1980, les inégalités ont tendance à se
creuser « au profit des 5% à 10% de la population les plus riches et au détriment d’une fraction
des couches moyennes et parfois des travailleurs les moins qualifiés » (Salama, 2006 : 5). La
polarisation vers le haut des revenus s’explique « essentiellement par la part croissante des
activités financières dans le PIB et par la forte rémunération des actifs financiers » (p. 5). Le
« défi des inégalités », objet de l’ouvrage de Pierre Salama, place l’Amérique latine dans une
situation où une croissance modérée ne permet pas de diminuer la pauvreté, en raison même de
l’importance des inégalités structurelles, et malgré l’existence de politiques redistributives, ce qui
caractérise des économies particulièrement excluantes (p. 59-60). En 2005, selon la CEPAL, la
pauvreté concerne 40 à 48% des ménages latino-américains.
Au regard de leur importance absolue, l’augmentation des inégalités en Amérique latine, depuis
les années 1980, est moins forte, en termes relatifs, que dans les pays développés, qui partent
d’un niveau d’inégalités bien plus bas. C’est aux Etats-Unis que cette augmentation est la plus
forte : l’indice de Gini y est passé de 35 en 1970 à 44 en 2005. La transformation radicale des
structures du marché du travail, en lien avec le passage à des économies post-fordistes, est pour
beaucoup dans ces évolutions : creusement des échelles de salaires, notamment par le haut,
croissance de la proportion de bas salaires, aggravation de la flexibilité du travail, baisse de la
syndicalisation, stagnation du revenu minimum, apparition à la fois de working rich et de
working poor... Si les revenus sont l’un des principaux modes de mesure des inégalités, les
indicateurs de bien-être (accès aux soins, au logement, à l’éducation, aux services, à la
consommation) et leurs marques spatiales (disparités entre régions, entre villes et campagnes,
entre quartiers urbains) permettent cependant de nuancer les évaluations issues des seuls
indicateurs de richesses. Les réflexions sur les modes de réduction des inégalités insistent sur les
politiques sociales, leurs effets inégalement redistributifs, leurs objectifs d’inclusion sociale pour
réduire une pauvreté non réductible à ses dimensions monétaires, mais peu articulée à
l’informalité.
Les informalités dans les Amériques
En 2000, le BIT souligne les inquiétudes générées par la croissance continue du secteur informel
dans les pays en développement, son explosion dans les pays en transition, et son apparition dans
les pays développés. En Amérique latine, continent très urbanisé1, l’informel est la première
source d’emploi : 75% des travailleurs, 40% du PIB régional, 7 emplois sur 10 créés dans ce
1 Plus de 77% d’urbains. La CEPAL ne recense d’ailleurs, dans les actifs informels, que les urbains.

12
secteur entre 1990 et 2005 (OIT, 2006) – 9 sur 10 en Afrique (BIT, 2000)2 –. Si dans les pays du
sud les plans d’ajustement structurel mis en place dans les années 1980-2000 ont contribué à une
rétraction de l’emploi formel, on assiste dans le même temps à un processus d’informalisation de
certains pans de l’économie nord-américaine et des pays développés en général (Sassen, 1997).
La transition post-fordiste accélère les formes d’externalisation de tâches, de sous-traitance ; pour
réduire les coûts, éviter les conflits syndicaux, maintenir une grande flexibilité, les secteurs de la
construction, de l’habillement, de l’électronique, de l’ameublement et de l’appareillage, voient se
développer ces nouvelles formes d’emploi dans les grandes villes des Etats-Unis (BIT, 2000 : 3-
4). Ce processus d’informalisation a contribué à la révision de la notion d’informel et à son
élargissement : lors de la 90ème conférence internationale du travail en 2002, l’OIT a remplacé la
notion de « secteur informel » par celle « d’économie informelle ». Aux salariés et propriétaires
de micro-entreprises, employés domestiques et travailleurs indépendants non qualifiés du secteur
informel, l’économie informelle ajoute les travailleurs précaires ou sans protection, indépendants
ou salariés des grandes, moyennes ou petites entreprises. La Banque Mondiale compte alors 54%
d’emplois urbains informels en Amérique latine, divisés en deux catégories: (1) Les travailleurs
informels indépendants (24% de l’emploi urbain en moyenne) – propriétaires de micro-
entreprises, professionnels indépendants, artisans, ouvriers de la construction, chauffeurs de taxis,
vendeurs de rue… ; (2) les travailleurs informels salariés (environ 30 % des emplois urbains et
plus de la moitié de tous les emplois du secteur informel) – employés domestiques, travailleurs
familiaux non rémunérés, employés de petites ou plus grandes entreprises sans protection sociale.
Le rapport précise leurs profils : niveau éducatif généralement inférieur au secondaire,
importance des secteurs de la construction, de l’agriculture, du commerce au détail, du transport,
faible durabilité dans l’emploi (moins d’un an), forte présence de jeunes (parmi les salariés
informels), des plus âgés (parmi les indépendants), des femmes avec enfants (Perry et alii, 2007,
encadré 1 : 5).
Dans leur typologie fonctionnelle de l’informel, Portes et alii (1989) distinguaient trois types
d’activités : 1) les activités de survie (production directe, vente de biens et services – activités
types : autoconstruction de logements, vente ambulante) ; 2) les activités destinées à améliorer la
flexibilité de la gestion et à réduire les coûts du travail des entreprises formelles à travers des
mécanismes de sous-traitance hors du système formel (exemple type : ateliers de confection
clandestins, utilisant une main d’œuvre immigrée, travaillant à la tâche, et travaillant pour de
grands firmes textiles étasuniennes) ; 3) les petites entreprises qui, souhaitant accumuler du
capital, jouissent dans l’informel d’une plus grande flexibilité et de moindres coûts (exemple
type : micro-entreprises artisanales). Si les trois se retrouvent en Amérique latine, c’est
principalement la seconde qui se développe au nord, la première et la dernière relevant des
situations plus anciennes et classiques au sud. Le tableau 2 met en évidence l’ampleur des
différentiels de situations d’informalité au sein de l’Amérique latine : si l’informel varie de plus
du simple au double entre le Chili et le Pérou, il est aussi très différencié selon le genre (près de
20 points d’écart en moyenne entre hommes et femmes), les femmes étant beaucoup plus
présentes dans l’informel, même s’il existe quelques exceptions (Honduras, République
dominicaine, Venezuela).
2 L’informel regrouperait 75% de l’emploi non agricole en Afrique subsaharienne, 65% en Asie, 55% en Amérique
latine, 45% en Afrique du Nord (Charmes, 2003).

13
Tableau 1 : Inégalités, développement et informalité dans les Amériques
Pays
IDH 2007
(indicateur de
développement
humain) *
Ratio revenus
10% les + riches /
10% les + pauvres
1992-2007*
INDEX
de GINI
1992-2007*
Secteur
informel**
Canada
0,966
9,4
32,6
N.C.
Etats-Unis
0,956
15,9
40,8
N.C.
Chili
0,878
26,2
52
30,7
Argentine
0,866
31,6
50
41,0
Uruguay
0,865
20,1
46,2
43,8
Mexico
0,854
21
48,1
45,7
Costa Rica
0,854
23,4
47,2
37,7
Venezuela
0,844
18,8
43,4
50,1
Panama
0,84
49,9
54,9
36,5
Brésil
0,813
40,6
55
41,8
Pérou
0,806
26,1
49,6
64,6
Ecuador
0,806
35,2
54,4
57,3
moyenne Am.
latine
0,8
36,1
51,4
49,2
Rép.
Dominicaine
0,777
25,3
50
48,9
Paraguay
0,761
38,8
53,2
60,1
El Salvador
0,747
38,6
49,7
54,7
Honduras
0,732
59,4
55,3
43,9
Bolivie
0,729
93,3
58,2
62,5
Guatemala
0,704
33,9
53,7
58,1
Nicaragua
0,699
31
52,3
58,4
*Source : Human development report, 2009.
**Source : CEPAL STAT, 2009 (http://websie.eclac.cl/). La CEPAL utilise l’expression de « secteur de basse
productivité (ou secteur informel) », qu’elle définit, en milieu urbain, comme : « toute personne qui est employeur ou
salarié – professionnel, technicien ou non –, qui travaille dans des entreprises comptant jusqu’à 5 employés, ou dans
la domesticité, ou qui est travailleur indépendant non qualifié – à son propre compte, et travailleurs familiaux non
rémunérés sans qualification professionnelle ou technique ».
La tentative de mise en lien des indicateurs de mesure des inégalités et de l’informalité n’est que
modérément éclairante (tableau 1). Si la Bolivie ou le Paraguay cumulent des inégalités graves et
une informalité très forte, associées à un indicateur de développement humain plutôt bas, d’un
côté, et si le Costa Rica ou l’Uruguay, dans la tranche haute de l’IDH, bénéficient d’inégalités
relativement faibles ainsi que d’un secteur informel modéré, de l’autre, de nombreux pays
soulignent les limites d’une association trop rapide entre les deux dimensions interrogées. Le
Panama présente ainsi un secteur informel faible, associé à des inégalités très fortes, tout comme
le Brésil, et tous deux ont un IDH plutôt supérieur à la moyenne régionale. Le Pérou, en
revanche, bien que disposant d’un IDH proche, apparaît moins inégalitaire que ses voisins, tout
en étant le pays d’Amérique latine où le secteur informel est le plus élevé. Le Venezuela présente
une situation relativement comparable, bien qu’accusant moins l’ampleur de l’informalité. Ces
observations rapides ne permettent pas de conclure que des inégalités de revenus marquées sont
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%