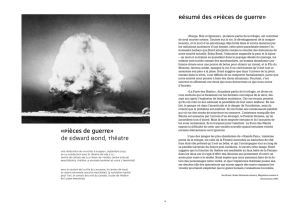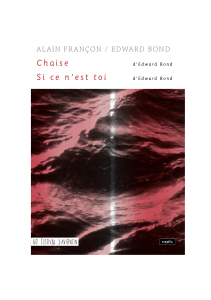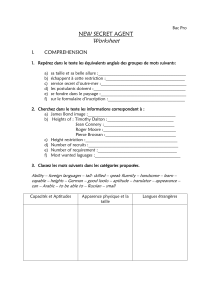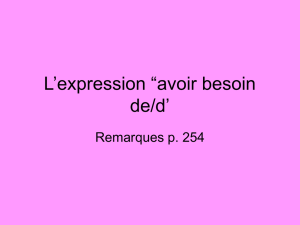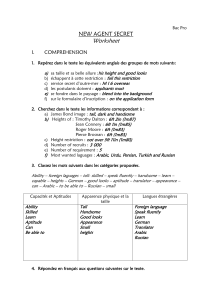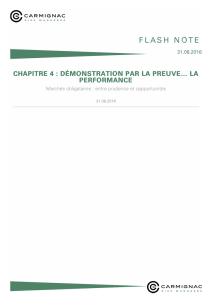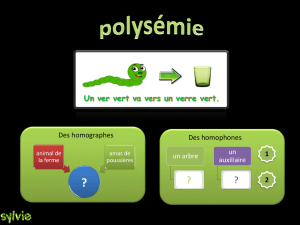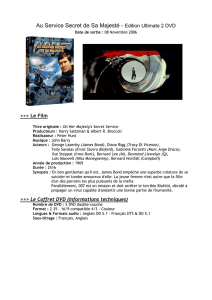Télécharger la présentation complete du colloque

! 1
RENCONTRES
EUROPÉENNES
EDWARD BOND
Amiens-Paris 2016
Un Tragique pour le XXIème siècle.
La logique du théâtre selon Edward Bond —
à la lumière des "TiE Plays"
(pièces pour Theatre-in-Education).
Université de Picardie Jules Verne
Centre de Recherches en Arts et en Esthétique (CRAE) – UFR des Arts
Groupe de Recherche CORPUS - UFR de Langues et Cultures étrangères)
Maison du Théâtre
Centre Culturel Jacques Tati
Institut de Recherches en Études théâtrales (IRET),
Paris III/Sorbonne Nouvelle

! 2
"Nous vivons dans la perplexité et un chaos croissant. La nuit est
obscure. Quand les Grecs durent affronter la même obscurité, ils
créèrent le théâtre qui nous a donné la lumière par laquelle nous nous
voyons nous-mêmes. Aujourd'hui, il nous faut créer un nouveau théâtre,
sinon la nuit obscure se lèvera sur un jour encore plus obscur. Ce
nouveau théâtre est le seul moyen que nous avons de nous rendre
démocratiquement responsables de notre époque. "
1
Depuis plus de cinquante ans, Edward Bond œuvre à élaborer une
poétique du théâtre et une forme tragique répondant aux spécificités de
notre temps. Pour Bond, le héros des tragédies grecques n'est pas
victime du destin : il sacrifie sa vie afin de préserver ce que sa vie porte
de sens humain. Il prive les dieux/l'autorité du pouvoir de la fatalité en
énonçant sa propre nécessité inscrite dans le paradoxe et l'ambiguïté qui
sont au fondement, et aux limites de notre humanité.
Ainsi, la tragédie nous apprend que "le sens donné à la vie est
plus important que la vie elle-même" .
2
Pour le système (néo-)libéral actuel, les complexités de l'humain
sont des obstacles car elles enrayent le fonctionnement mécanique du
consumérisme (jusque dans l'institution théâtrale elle-même : voir les
distributions de prix en fin d'année). Le marché est donc condamné
logiquement à récupérer pour la ravaler toute expression culturelle
libre ; une idéologie médiatique réactionnaire tue à petit feu, tout en la
glorifiant abstraitement, le désordre libérateur de la création.
"Petit manifeste pour la création de Les gens", inédit, 2013.
1
"Être humain : notice pour le programme de la création en Turquie de Rouge Noir et ignorant", mai
2
2014.

! 3
Cependant, le geste dramatique ("drama") peut encore se prévaloir
d'une ultime garantie : aucun appareil de répression étatique, aucun
contrôle technologique, aucune forme de bâillonnement institutionnalisé
ne pourront empêcher Antigone, Hécube, Hamlet, Lear (c'est-à-dire
nous) d'affronter la "question humaine" et de sonder le paradoxe qui
fonde leur geste dans le monde.
Même Macbeth, au comble de l'abomination, ne peut s'empêcher
de penser les raisons qui le poussent à commettre des abominations.
"Voilà pourquoi la civilisation a créé la scène. Voilà pourquoi nous
jouons des pièces. Voilà pourquoi nous gardons espoir."
3
En nous fondant (non exclusivement) sur les dix pièces écrites par
Bond depuis 1994 pour être jouées pour et avec des collégiens et
lycéens, les "Rencontres européennes Edward Bond, Paris-Amiens
2016" viseront à explorer, dans un cadre universitaire, mais aussi
sur les plateaux et les scènes de théâtre, les outils théoriques et
conceptuels — proprement "poétiques" — que Bond forge et met en
pratique pour l'art dramatique depuis plus de cinquante ans, en vue
de l'urgente et nécessaire ré-invention d'une dramaturgie apte à
regarder les yeux dans les yeux notre crise présente (que Bond
nomme depuis 2012 la "Troisième Crise" de la culture occidentale).
Il convient ici de rappeler que, selon Bond, la question du
Tragique, dans les pièces écrites pour "Theatre-in-Education" ne va pas
de soi.
Ibid.
3

! 4
Dans une lettre récente, il affirme :"Je n'écris pas de tragédies pour les
jeunes. La raison pour laquelle celles-ci leur seraient inutiles tient à la manière
dont ils sont immergés directement dans leur expérience personnelle.
Généralement, les adultes ne sont pas immergés dans leur expérience personnelle
de la même manière car ils en sont réduits à manipuler (et non utiliser de manière
créatrice) leur expérience pour survivre sur le marché. Dans une situation
extrême et dangereuse, chacun de nous rode à l'intérieur de lui-même — c'est ce
que font constamment les enfants. Dans les pièces pour jeunes publics, je me
rappelle — et utilise — la manière dont les enfants enquêtent. Une enquête qui ne
souffre aucune manipulation. Où suis-je ? — voilà la question incontournable.
Dans sa majeure partie, l'écriture pour jeunes gens traite ceux-ci selon la manière
dont les jeunes sont perçus par les adultes. Je n'écris pas pour les jeunes en tant
que jeunes mais pour les jeunes en tant qu'adultes : les adultes qu'ils deviendront
un jour. C'est une erreur d'écrire pour les jeunes comme s'ils étaient des petits
adultes, et par conséquent limités et incapables de comprendre par eux-mêmes —
mais c'est aussi une erreur d'écrire comme s'ils étaient des adultes qui ont la
fâcheuse tendance de faire de temps en temps des caprices. Les contes des frères
Grimm débutent dans le tragique et se terminent dans la liberté. Je crois que c'est
ce que font mes pièces pour jeunes publics — bien qu'elles définissent la liberté
comme une responsabilité. […]
Je crois que pour les jeunes j'écris au cœur de la radicalité de l'innocence.
Pour les adultes, il est nécessaire au préalable de mettre à découvert ou de
déterrer cette innocence."
4
Les "Rencontres européennes", qui se dérouleront (c'est essentiel) à
part égale dans des théâtres et dans l'Université — et en présence, chaque
fois que possible, des jeunes gens impliqués dans les divers projets de
création, d'ateliers, de master class — chercheront à cerner les contours de
cette nouvelle utilisation de la scène et du tragique telle que la préconise, et la
met en œuvre (en "actes"), Edward Bond — une scène et un tragique qui
redonnent sa centralité à l'acteur afin qu'il aide le spectateur à retrouver la vue, et
à exercer le regard libre de l'imagination.
Une scène qui nous aide à nous reconstituer en communauté lucide,
responsable de son devenir.
AXES D'EXPLORATION ET DE RECHERCHE
Correspondance personnelle du 6 février 2014.
4

! 5
1. Bond et la naissance de la tragédie : définir les critères et les formes
du tragique bondien.
À partir de pièces telles que Lear (1971) et La Femme (1978), qui prennent pour
personnages principaux ceux de Shakespeare et d'Euripide, ou d'œuvres comme les
Pièces de guerre (1983-85) et Dans la compagnie des hommes (1987-88), hantées par
les figures de Hamlet et Macbeth, peut-on retracer une évolution synchronique dans
la réflexion de Bond sur le tragique ?
La question est de savoir si Edward Bond est parvenu, jusque dans ses pièces les
plus récentes — notamment avec Déa (pièce encore inédite, et terminée en 2014, où une
Me-dea futuriste, plusieurs fois infanticide, se transforme, sous la pression d'une guerre
totale, en Agavé fracassant à coups de pied la tête de son fils décapité), ou avec Les
Routes en colère (2014), écrite d'abord pour lycéens (pièce où un fils ne peut apprendre
le secret meurtrier de son père — incapable de communiquer avec lui par le langage —
que par le biais de coups frappés sur une table, alphabet morse habité par la folie du
monde) — si Bond est parvenu, donc, à réaliser le projet de synthèse, plusieurs fois
annoncé, qui ferait de nous les "Grecs-Jacobéens", capables de nous retrouver
autour d'un théâtre implacablement focalisé sur les situations extrêmes qui nous
définissent et nous obligent à définir de nouvelles responsabilités.
À ce titre, une pièce comme Auprès de la mer intérieure (1995), qui constitue la
première tentative de Bond d'écriture pour jeunes publics dans leur propre salle de
classe, parvient-elle à inventer la forme de fiction tragique adaptée à la question de la
représentation/monstration de la Shoah ?
De Sauvés (1964) au Bol affamé (2012), peut-on définir une spécificité, une
idiosyncrasie, une forme bondienne spécifique de la tragédie ?
Bond revendique une tâche qui est de raconter et d'explorer la "quatrième
histoire" (ou "troisième crise") qui est la nôtre et qui frôle, selon lui, pour la première
fois dans l'évolution de l'humanité, l'absence ou la perte de notre Histoire humaine.
Comment définir cette "logique de la tragédie" à laquelle Bond fait si
souvent allusion, et qu'il règle sur, ou assimile avec la "logique de l'imagination"
propre à l'être humain, et qui permet à celui-ci, justement, de rester humain ou de
revendiquer le "droit d'être humain" ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%