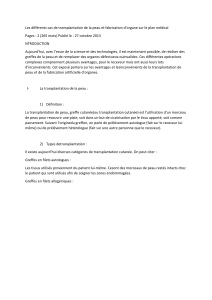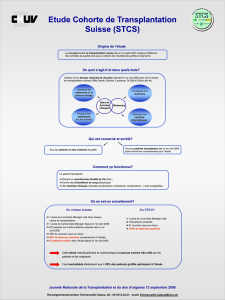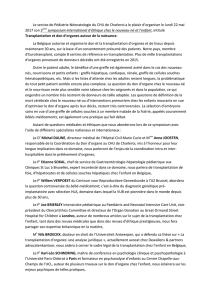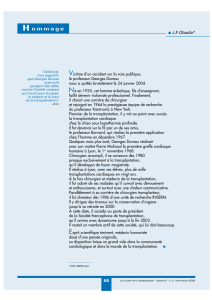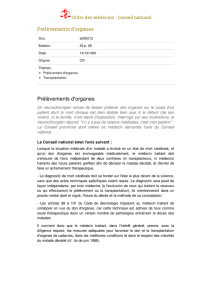Version PDF imprimable - The Royal College of Physicians and

© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Tous droits réservés.
Ce document peut être reproduit pour des fins éducatives seulement, et ce, à condition que la phrase suivante soit incluse dans tous les documents relatifs : © Le Collège royal des
médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Cité et reproduit avec permission. Veuillez faire parvenir un exemplaire du produit final à l’attention du directeur associé, Unité des spécialités
du Bureau de l’éducation spécialisée. Il faut obtenir l’autorisation écrite du Collège royal pour toutes les autres utilisations. Pour obtenir plus de renseignements sur la propriété
intellectuelle, veuillez communiquer avec nous à documents@collegeroyal.ca. Si vous avez des questions concernant l’utilisation de ce document, veuillez communiquer avec nous à
credentials@collegeroyal.ca.
Page 1 de 19
Exigences en matière de formation de compétences
dans le domaine de compétence ciblée de
transplantation d'organes
MARS 2017
VERSION 2.0
Remarque : Dans ce document, et conformément aux critères d’une discipline de DCC,
toutes les déclarations renvoient à l’application des compétences en transplantation
d’organes du titulaire d’un diplôme de DCC à une population de patients prédéfinie et aux
compétences préexistantes telles que décrites dans sa discipline d’accès.
« Le médecin stagiaire de DCC » renvoie aux candidats dont la discipline d’accès est l’une
des suivantes : gastroentérologie, hépatologie, maladies infectieuses, néphrologie ou
pneumologie.
« Le chirurgien stagiaire de DCC » renvoie aux candidats dont la discipline d’accès est l’une
des suivantes : chirurgie cardiaque, chirurgie générale, urologie ou chirurgie thoracique.
DÉFINITION
La transplantation d’organes est le domaine de compétence enrichie qui englobe les soins
des patients adultes et pédiatriques présentant une défaillance d’organe terminale traitée
par transplantation, incluant les patients qui subissent une transplantation d’organes tels
que le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas et les intestins.
EXIGENCES D'ADMISSIBILITÉ
Le candidat au domaine de compétences ciblées (DCC) doit avoir obtenu une certification du
Collège royal ou l’équivalent dans l’une des disciplines suivantes : chirurgie cardiaque,
gastroentérologie, chirurgie générale, hépatologie, maladies infectieuses, néphrologie,
pneumologie, chirurgie thoracique ou urologie. Ces disciplines ont en commun un ensemble
de compétences liées au traitement de défaillance d’organes en phase terminale par la
transplantation d’organes, que chaque discipline applique à sa population de patients
spécifique :
• Chirurgie cardiaque : cœur, transplantation cœur-poumon et transplantation
pulmonaire
• Gastroentérologie ou hépatologie : défaillance intestinale et transplantation
intestinale, maladie hépatique en phase terminale et transplantation du foie
• Chirurgie générale : transplantation d’organe abdominal, pouvant inclure la
transplantation intestinale, du rein, du foie et du pancréas
• Maladies infectieuses : tous les groupes d’organes
• Néphrologie : maladie rénale en phase terminale et transplantation de rein
• Pneumologie : maladie pulmonaire en phase terminale et transplantation du poumon

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION DE COMPÉTENCES EN
TRANSPLANTATION D’ORGANES (2017)
© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Tous droits réservés.
Page 2 de 19
• Chirurgie thoracique : transplantation pulmonaire
• Urologie : transplantation du rein et du pancréas entier
Tous les stagiaires doivent avoir obtenu une certification dans leur (sur)spécialité primaire
ou avoir une attestation dans leur domaine de compétence ciblée afin d'être admissibles à la
certification du portfolio du Collège royal en transplantation d’organes.
OBJECTIFS
Au terme de la formation, le médecin diplômé doit avoir atteint le degré de compétence
d'un médecin spécialisé en transplantation d’organes, capable de pratiquer dans ce domaine
de compétence ciblée (DCC) enrichi, dans le champ de sa discipline primaire. Le candidat
doit comprendre les fondements théoriques de cette discipline, y compris ses assises en
science et en recherche, tels qu'ils s’appliquent à la pratique de la médecine et de la
chirurgie.
La discipline de transplantation d’organes comprend les responsabilités suivantes :
• évaluation de personnes présentant une maladie d’organe en phase terminale afin de
déterminer si elles sont candidates à la transplantation d’organes;
• évaluation de donneurs d’organes potentiels pour déterminer s’ils sont candidats au
don d’organes;
• sensibilisation autour du don d’organes et de l’attribution équitable d’organes donnés
aux personnes en attente de transplantation d’organes;
• prélèvement et préservation d’organes de donneurs vivants ou décédés,
transplantation de ces organes à des personnes présentant une maladie d’organe en
phase terminale, et prise en charge de l’optimisation de la qualité d’organe par le
biais de l’application de techniques de préservation ex vivo et du choix du moment
de l’intervention;
• soins périopératoires du receveur d’organe;
• prise en charge de l’immunosuppression du receveur d’organe;
• suivi du fonctionnement de l’allogreffe du receveur d’organe et prise en charge du
dysfonctionnement de l’allogreffe;
• soins prodigués au receveur d’organe présentant un dysfonctionnement de greffon
en phase terminale; et
• avancement de la discipline par la participation à des activités scientifiques.
Le médecin diplômé doit démontrer qu'il possède les connaissances, les compétences et les
comportements requis pour dispenser des soins et des services axés sur le patient à un
vaste public. Dans tous les aspects de la pratique de la spécialité, le diplômé doit pouvoir
aborder de façon professionnelle les questions d’appartenance sexuelle, d’orientation
sexuelle, d’âge, de culture, d’origine ethnique et d’éthique.
À la fin de la formation, le médecin diplômé possédera les compétences suivantes et sera à
même de s'acquitter efficacement des tâches inhérentes aux rôles suivants :

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION DE COMPÉTENCES EN
TRANSPLANTATION D’ORGANES (2017)
© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Tous droits réservés.
Page 3 de 19
Expert médical
Définition :
En tant qu'experts médicaux, les médecins et chirurgiens en transplantation d’organes
assument tous les rôles CanMEDS et s'appuient sur leur savoir médical, leurs compétences
cliniques et leurs attitudes professionnelles pour dispenser des soins axés sur les patients.
Le rôle d'expert médical est le rôle pivot du médecin dans le cadre CanMEDS.
Compétences clés et habilitantes : Les médecins et chirurgiens en transplantation
d’organes peuvent…
1. Agir à titre de conseiller, intégrant tous les rôles CanMEDS afin de fournir des
soins médicaux optimaux, éthiques et axés sur le patient
1.1. Effectuer une consultation, incluant la présentation d’évaluations et de
recommandations bien documentées par écrit, par oral et sous forme électronique
en réponse à une demande d’un autre professionnel de la santé
1.2. Montrer l’utilisation de toutes les compétences CanMEDS pertinentes à la
transplantation d’organes
1.3. Repérer les enjeux éthiques pertinents qui découlent des soins aux patients et y
réagir de façon appropriée
1.4. Montrer qu’ils sont à même d’établir les priorités dans leurs obligations
professionnelles lorsqu’ils sont aux prises avec de multiples patients et de multiples
problèmes
1.5. Faire preuve de compassion et prodiguer des soins axés sur le patient
1.6. Reconnaître les enjeux éthiques associés à la prise de décisions médicales et y
réagir de façon appropriée
1.7. Faire preuve d’expertise médicale ailleurs que dans les soins aux patients,
notamment lorsqu’ils témoignent en cour à titre d’expert, ou conseiller le
gouvernement, le cas échéant
2. Acquérir et conserver des connaissances, des compétences et un
comportement cliniques appropriés à la transplantation
2.1. Appliquer leurs connaissances des sciences cliniques, socio-comportementales et
biomédicales fondamentales pertinentes à la transplantation d’organes
2.1.1. Évaluation de receveurs de transplantation d’organes
2.1.1.1. Causes de maladies en phase terminale et risque de récurrence de la
maladie avec l’allogreffe
2.1.1.2. Indications et méthodes de traitement de maintien en vie dans l’attente
d’une transplantation
2.1.1.3. Indications et contre-indications pour la transplantation d’organes,
incluant sans s’y limiter
2.1.1.3.1. Pertinence anatomique
2.1.1.3.2. Évaluation des risques immunologiques

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION DE COMPÉTENCES EN
TRANSPLANTATION D’ORGANES (2017)
© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Tous droits réservés.
Page 4 de 19
2.1.1.3.3. Facteurs prédictifs de survie jusqu’au moment de la transplantation
et après la transplantation
2.1.1.3.4. Comorbidités préexistantes
2.1.1.3.5. Risque infectieux et statut d’immunisation
2.1.1.4. Facteurs liés à la source du donneur d’organe, vivant ou décédé, et
résultat pour le receveur, incluant sans s’y limiter :
2.1.1.4.1. Risque de récurrence de la maladie
2.1.1.4.2. Complications techniques de chirurgie d’implantation d’organes
2.1.1.4.3. Moment de la transplantation
2.1.1.4.4. Pertinence anatomique
2.1.2. Évaluation de donneurs d’organes potentiels
2.1.2.1. Principe de prise en charge du donneur pour optimiser le prélèvement et
le fonctionnement d’organe
2.1.2.2. Facteurs pris en compte dans l’évaluation d’un donneur d’organe
potentiel, incluant sans s’y limiter :
2.1.2.2.1. Facteurs anatomiques
2.1.2.2.2. Risque de maladie transmissible
2.1.2.2.3. Critères de distribution exceptionnelle
2.1.2.2.4. Méthodes pour évaluer le fonctionnement d’organe et les critères
de pertinence
2.1.2.2.5. Facteurs de risque de dysfonctionnement d’organe, incluant sans
s’y limiter :
2.1.2.2.5.1. Âge
2.1.2.2.5.2. Comorbidités
2.1.2.2.5.3. Type de donneur d’organe : vivant ou décédé; diagnostic de
décès neurologique ou cardiaque
2.1.2.3. Facteurs spécifiques au donneur d’organe vivant, incluant sans s’y
limiter :
2.1.2.3.1. Risques pour le donneur vivant, immédiats et à long terme
2.1.2.3.2. Suivi approprié du donneur
2.1.3. Attribution d’organe
2.1.3.1. Motif et limites des examens suivants effectués par le laboratoire
d’histocompatibilité, incluant sans s’y limiter :
2.1.3.1.1. Groupage HLA
2.1.3.1.2. Titrage des anticorps PRA (panel reactive antibody)

EXIGENCES EN MATIÈRE DE FORMATION DE COMPÉTENCES EN
TRANSPLANTATION D’ORGANES (2017)
© Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, 2017. Tous droits réservés.
Page 5 de 19
2.1.3.1.3. Identification d’anticorps spécifiques du donneur
2.1.3.1.4. Compatibilité croisée
2.1.3.2. Facteurs pris en compte dans l’attribution d’organes à des individus en
attente d’une transplantation, incluant sans s’y limiter :
2.1.3.2.1. Considérations anatomiques
2.1.3.2.2. Fonctionnement prédit de l’organe
2.1.3.2.3. Considérations immunologiques en fonction du type d’organe
2.1.3.2.3.1. Groupe sanguin
2.1.3.2.3.2. Résultats de comptabilité croisée
2.1.3.2.3.3. Compatibilité HLA
2.1.3.2.3.4. Statut PRA
2.1.3.2.3.5. Statut des anticorps spécifiques du donneur
2.1.3.2.4. Risque d’infection ou de maladie transmissible
2.1.3.2.5. Prioritisation parmi les personnes sur la liste d’attente
2.1.3.2.5.1. Statut de receveur et risque de progression ou de mortalité
2.1.3.2.5.2. Principes d’éthique, incluant sans s’y limiter, à l’équité et
l’utilité
2.1.4. Prélèvement, préservation et implantation d’organe
2.1.4.1. Technique chirurgicale pour le prélèvement d’organe pertinente à la
discipline d’accès du stagiaire de DCC, pour les donneurs dans les
catégories suivantes :
2.1.4.1.1. Donneur avec diagnostic de décès neurologique (DDN)
2.1.4.1.2. Donneurs d’organe après décès cardiaque (DDC)
2.1.4.1.3. Donneurs vivants
2.1.4.2. Techniques de préservation d’organe ex vivo
2.1.4.3. Techniques d’implantation pour les cas suivants :
2.1.4.3.1. Organes de donneurs décédés
2.1.4.3.2. Organes de donneurs vivants pertinents à la discipline d’accès
2.1.5. Soins périopératoires de receveurs d’organes
2.1.5.1. Physiopathologie, histologie, prévention, reconnaissance et prise en
charge des lésions ischémiques ou de reperfusion
2.1.5.2. Diagnostic différentiel et prise en charge de dysfonctionnement précoce
d’allogreffe
2.1.5.2.1. Causes immunologiques
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%