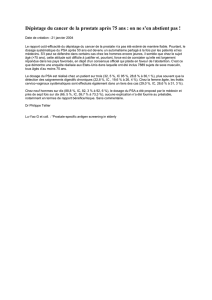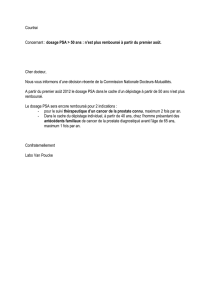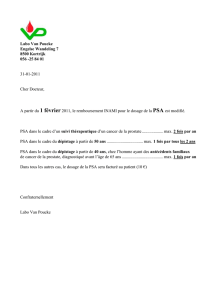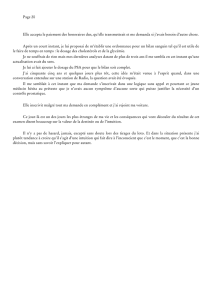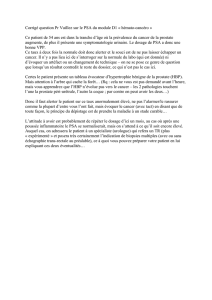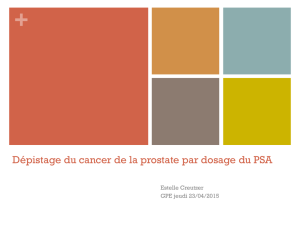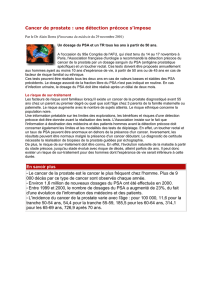L`assurance de la responsabilité civile professionnelle – Données

Le médecin, le juge et la recommandation
Commentaire sur le jugement rendu le 22 /03 /2013 par le TGI de Troyes ; aff. X. /G.
04 /2013
Jean VILANOVA – Juriste
jean.vilanova@ca-predica.fr

2
Le récent procès d’un médecin généraliste jugé devant le Tribunal de grande instance de Troyes pour retard de diagnostic d’un cancer de la prostate a fait
couler beaucoup d’encre. Le tribunal, par décision rendue le 22 /03 dernier a écarté toute responsabilité à la charge du praticien. Au niveau des
commentaires, on pourrait en rester là en attendant une éventuelle procédure d’appel. On aurait tort car cette affaire va bien au-delà de la « classique »
recherche d’une faute médicale. Elle soulève en effet bien d’autres questions ; notamment celle née de la difficulté de conjuguer l’art avec un système normé,
les recommandations. Bien davantage que celui d’un médecin, d’aucuns ont prétendu que ce procès était d’abord celui des recommandations médicales, pas
moins ! Qu’en est-il précisément ?
En 2002, M. X. est âgé de 52 ans lorsqu’il consulte pour divers maux. Les examens pratiqués révèlent un état de santé déficient : HTA, apnées du sommeil,
troubles urinaires et déficit auditif. Le bilan fait aussi état « d’une prostate légèrement augmentée au toucher rectal. » Il existe enfin un facteur de risque
familial de cancer colique. Son médecin généraliste, le docteur G. oriente M. X. vers un gastroentérologue pour une endoscopie digestive haute avec biopsie
et une coloscopie pour dépistage d’un cancer colique (pas de cancer colique). Il l’oriente également vers un cardiologue en vue du traitement de l’HTA.
Entre 2003 et 2007, le patient consulte le docteur G. à plusieurs reprises. Il se plaint notamment de modifications urinaires avec des mictions plus
impérieuses et plus nombreuses, y compris nocturnes. Le médecin impute ces troubles au traitement contre l’HTA. Ce n’est que lorsque se déclarent des
douleurs au niveau du sacrum que le praticien prescrit un dosage PSA (Prostate Specific Antigen). Celui-ci fait alors apparaître un taux de PSA élevé. Le
patient est hospitalisé pour y subir divers examens complémentaires. On diagnostique un cancer de la prostate à un stade avancé.
Une procédure est lancée contre le médecin généraliste au motif d’un dépistage tardif – et fautif – de ce cancer. Le patient réclame 500 000 € en réparation
de son préjudice, la faute selon lui commise ayant écarté toute possibilité d’intervention rapide et radicale. Quant à la CPAM, elle estime à 40 000 € les
sommes qui lui sont dues au motif des frais de soins engagés.
a. Le référé d’abord…
En mai 2009, statuant sous la forme des référés, le Tribunal de grande instance de Troyes ordonne au docteur G. le versement au patient de la somme de
15 000 € au titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts. Le jugement est confirmé en mai 2010 par la Cour d’appel de Reims statuant elle aussi
sous la forme des référés. La décision des magistrats s’appuie sur le rapport d’expertise rédigé par un urologue et son confrère médecin généraliste. Ce
rapport mentionne qu’en 2003, un médecin généraliste ne pouvait ignorer l’intérêt d’un dépistage du cancer prostatique par dosage PSA.
Rappel des faits
Décision

3
Selon les experts, l’absence de prescription de ce dépistage a fait perdre au patient une chance de guérison. Et, dans une certaine mesure, ils enfoncent le
clou en affirmant qu’à cette époque (2003), un tel dépistage faisait consensus.
b. Le jugement sur le fond ensuite…
L’affaire est abordée sur le fond dans le cadre du procès ouvert le 1er /03 /2013, ici encore devant le Tribunal de grande instance de Troyes. Le jugement
rendu le 22 /03 précise que… « le médecin n’a commis aucune faute de diagnostic ou de dépistage en lien avec le cancer de la prostate dont souffre le
patient… » Un jugement qui se situe donc aux antipodes des décisions rendues en référé !
Les magistrats émettent des critiques relativement sévères à l’encontre du premier rapport d’expertise. Au contraire des affirmations formulées par les deux
rédacteurs du rapport, le tribunal pointe le fait que, de masse ou individuel en lien aux symptômes présentés par le patient, le dépistage ne donnait lieu à
aucune recommandation par les autorités sanitaires de l’époque (l’ANAES). Mieux – ou pire ! – l’ANAES avait même, en la matière, rendu des avis
défavorables au dépistage systématique par dosage PSA.
Dès lors pour les juges la recherche en responsabilité doit porter sur un domaine précis : le patient présentait-il des signes évocateurs de suspicion de la
présence d’un cancer ?
- Dans l’affirmative, le défaut de dosage devient potentiellement fautif.
- Dans la négative, aucune faute ne saurait être rapportée contre le médecin.
Le tribunal conclut à une absence de faute à toutes les étapes de la relation nouée entre M.X et son médecin généraliste, de la première décision prise en
2002, jusqu’à la prescription du dosage PSA 5 ans plus tard. « Aucun des symptômes présentés par le patient avant 2007 n’était de nature à faire suspecter
un cancer de la prostate ou à justifier un dépistage par dosage PSA, compte tenu des données acquises de la science… »
Une décision rendue par une juridiction de 1er degré, aussi pertinente soit-elle n’a pas force de norme, chacun le sait. Et ici, le demandeur peut interjeter appel
dans un délai d’un mois à partir de la signification du jugement (22 /03). Puis, après arrêt rendu par la cour d’appel, si un pourvoi est formée par l’une ou
l’autre des parties, il appartient alors à la Cour de cassation, en tant que juridiction suprême de définir la jurisprudence, elle normative.
Nous n’en sommes pas là, loin s’en faut mais cette affaire mérite que l’on s’y arrête. Par-delà les souffrances endurées, en premier lieu celle du patient bien
entendu mais aussi, on ne doit pas l’écarter, celle du médecin poursuivi, elle touche à certaines lignes et met en lumière quelques aspects complexes.
a. Sur le jugement proprement dit
Certes, nous disent les juges – et il est fondamental de respecter l’autorité de la chose jugée – l’absence de dosage PSA, en 2002, pour dépistage d’un
cancer de la prostate ne constitue pas une faute eu égard aux symptômes relevés et aux données acquises de la science. Il n’empêche, cette prostate
Discussion

4
présentait une hypertrophie débutante accompagnée de troubles mictionnels. Aussi, sans rechercher les signes d’un cancer, n’y avait-il pas lieu de s’attacher
à un traitement spécifique ? N’est-ce point là un aspect possiblement inabouti du jugement ?
Poser ces questions ne revient pas à y répondre mais il nous semble que compte tenu des contours élargis conférés depuis longtemps à l’obligation de
prudence – une composante parmi quelques autres de l’obligation régalienne de moyens – il peut y avoir matière à investigation plus large que celle focalisée
sur la seule recherche de la tumeur cancéreuse.
b. Sur les recommandations médicales : à quoi servent-elles, d’où proviennent-elles et quelle est leur force ?
Une définition…
« Les recommandations médicales se présentent comme des documents écrits destinés à aider le praticien, éventuellement le patient, à choisir la prise en
charge la plus appropriée en fonction d’une situation clinique donnée. Outil d’aide à la décision, ces recommandations visent aussi à encadrer les pratiques
professionnelles afin de réduire leur hétérogénéité. » (1)
Une histoire…
A l’origine, on est en droit de penser qu’un système de recommandations médicales est antinomique avec l’art du praticien. Cet art, parce que c’est un art
justement, méconnaît a priori tout système normatif. Quant à l’obligation de moyens dévolue au soignant elle ignore en soi la borne, la limite, la contrainte.
Voilà pour le pur concept, une sorte d’idéal…
Mais la médecine est aussi de notre monde et de notre temps et il lui faut s’y adapter. De là, naît la recommandation car il importe d’évaluer les pratiques. Les
évaluer du point de vue de leur efficacité mais aussi du point de vue de leur coût ; puis rechercher ce qui pourrait constituer le meilleur service au patient à un
moindre coût. Ce fût, au début des années 1990, l’époque des fameuses « références médicales opposables » qui n’eurent « d’opposable » que le terme et
qui constituèrent une sorte de brouillon vite abandonné.
Aujourd’hui il appartient à la HAS d’abord, aux sociétés savantes et aux agences ensuite d’élaborer et de diffuser les recommandations. Ces
recommandations sont nombreuses. Elles touchent au geste technique, au médicament. Elles visent… « à améliorer la qualité des prises en charge et les
pratiques des professionnels… Elles reflètent un état de l’art scientifique à un moment donné » (1)
La force de la référence
Eu égard à la complexité croissante de l’art mais aussi du fait d’une certaine judiciarisation, les soignants ont de plus en plus besoin de disposer d’un système
de recommandations médicales. Ces recommandations « balisent » l’action possible de l’homme de l’art confronté à une situation donnée tout en influant,
nous l’avons dit, sur le coût des soins.
Le magistrat quant à lui juge « in concreto ». En d’autres termes, il cherche à savoir si, en relation avec le dommage de responsabilité civile au titre duquel il
doit se prononcer, une recommandation existait et si elle a été appliquée ou pas par le médecin incriminé. C’est un des éléments de sa décision. Mais il
importe de conserver en mémoire un point de haute importance. Pour le praticien, le strict suivi d’une recommandation n’est pas, selon nous, nécessairement
exonératoire de toute responsabilité !

5
A contrario, on ne saurait non plus lui reprocher de façon systématique le fait de ne pas avoir tenu compte de la recommandation en engageant une autre
stratégie thérapeutique. Dans tous les cas, ce que l’on attend du médecin, c’est qu’il justifie de ses choix. C’est en cela que nous pensons illusoire, en droit,
une opposabilité stricte de la recommandation dans un sens où cette opposabilité se traduirait alors par une protection du soignant contre les demandes en
réparation de son patient.
La médecine devient peu ou prou un art normé (oxymore…), mais pas trop !
Dans l’affaire de Troyes, prétexte à la présente note, il n’existait pas de recommandation sur l’intérêt de pratiquer le dosage PSA face au tableau clinique
présenté par M. X. La défense du médecin s’est fondée sur cet argument qui s’est avéré ici décisif. Reste à savoir ce qu’il en serait si cette affaire, ou une
autre, semblable, venait à se développer jusque devant la juridiction suprême.
Au moment où ces lignes sont écrites, M. X n’a pas interjeté appel.
(1) 1er Ministre – Centre d’analyse stratégique. Questions sociales. La note d’analyse n° 291 – Octobre 2012
1
/
5
100%