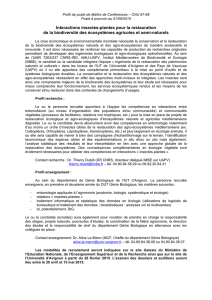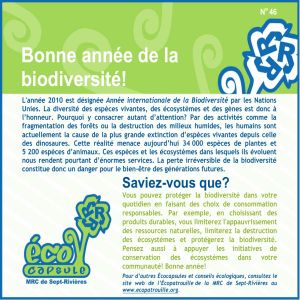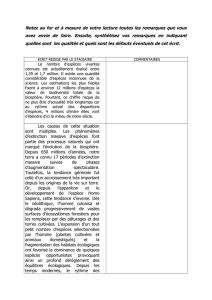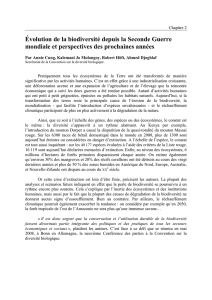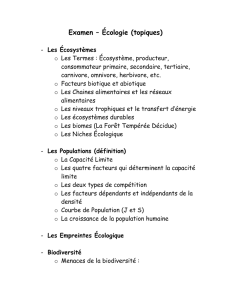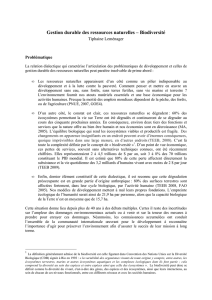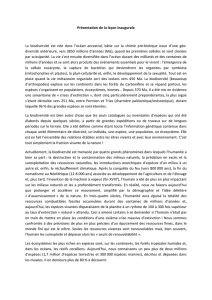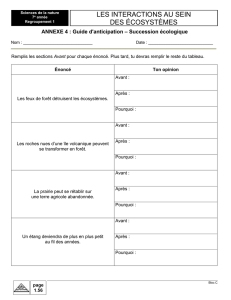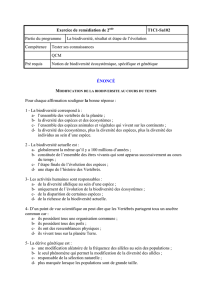ÉCOVÉG13 : Forêt Montmorency, Québec, Canada 10 – 13

1
ÉCOVÉG13 : Forêt Montmorency, Québec, Canada
10 – 13 septembre 2017
Recueil des résumés des communications
CHENOT et al. : communication par affiche
Les nouveaux écosystèmes créés par les activités humaines intensives sont-ils vraiment
nouveaux ?
Julie Chenot, Société des Carrières de La Ménudelle, GAGNERAUD Construction, Saint Martin de Crau, FRANCE, et
Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie, Université d’Avignon, UMR CNRS IRD, Université d’Aix Marseille,
Avignon, FRANCE [email protected]
Anne Aurière, Élise Buisson, Thierry Dutoit, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie, Université d’Avignon,
UMR CNRS IRD, Université d’Aix Marseille, Avignon, FRANCE
Frédéric Bioret, EA 2119 Géoarchitecture, Université de Bretagne Occidentale, CS 93837, 29238 Brest cedex, FRANCE
Renaud Jaunatre, Université Grenoble Alpes, Irstea, UR EMGR, 2, rue de la Papeterie-BP 76, F-38402, Saint-Martin-
d’Hères, FRANCE
La plupart des écosystèmes de la Terre sont modifiés par les activités humaines. Ces écosystèmes ne ressemblent en rien à
leurs précurseurs naturels. Face à ce constat, un nouveau concept émerge : celui des nouveaux écosystèmes de Hobbs et al.
(2006). Ces derniers sont définis comme n’ayant plus aucun lien avec l’écosystème d’origine. En effet, la dégradation d’un
écosystème est telle que le seuil d’irréversibilité écologique est dépassé, aucun retour en arrière ni aucune restauration
écologique n’est envisageable ou possible, d’où l’apparition de nouveautés. Ces nouveaux écosystèmes peuvent avoir des
trajectoires multiples et encore largement inconnues. Cependant, la définition de ce nouveau concept se base uniquement
sur l’écosystème préexistant. Face à ce constat, de nombreuses interrogations portent sur le caractère nouveau de ces
écosystèmes. La phytosociologie sigmatiste vise à caractériser les végétations naturelles et semi-naturelles, à mettre en
avant leur déterminisme mais aussi à identifier leurs dynamiques en intégrant les facteurs biotiques et abiotiques dans la
définition de ces différentes successions. Une étude phytosociologique sigmatiste et paysagère a été menée en mai 2016
pour démontrer ou non le caractère nouveau de ces écosystèmes en essayant de rattacher ces écosystèmes
irréversiblement dégradés à des syntaxons déjà connus. L’objectif est aussi de comprendre les dynamiques végétales qui
se mettent en place sur ces sites mis à nus et d’envisager une réflexion sur les concepts de successions primaire et
secondaire.
CLOSSET-KOPP : communication orale
Quatre décennies de changements de communautés végétales en forêt de Compiègne
(Nord de la France) : quels déterminants ?
Déborah Closset-Kopp, Tarek Hattab, Guillaume Decocq, Unité Écologie et Dynamique des Systèmes Anthropisés
(EDYSAN), Université de Picardie Jules Verne, 1, rue des Louvels, Amiens, Somme 80037, FRANCE deborah.closset-
Le suivi de placettes permanentes est une approche de choix pour appréhender les dynamiques à long terme de la
végétation en contexte de changements globaux, en particulier pour des écosystèmes forestiers. Cette étude, menée en
forêt de Compiègne, cherche à caractériser les changements qualitatifs et quantitatifs de la flore vasculaire survenus au
cours des 45 dernières années, en rééchantillonnant les mêmes sites. Les changements survenus dans des parcelles
forestières à l’échelle du massif, sur différents types de sols et ayant été soumises à différentes intensités de gestion, sont
quantifiés et interprétés à l’aide de différents descripteurs environnementaux et des traits d’histoire de vie des espèces.
Les résultats montrent une augmentation de la richesse spécifique qui entraîne une augmentation de la diversité
fonctionnelle et de la diversité phylogénique. On note une eutrophisation de la végétation, une augmentation de la
palatabilité ainsi qu’une diminution de l’héliophilie. Les espèces hygrophiles, endozoochores, agestochores et
anémochores ont le plus fortement progressé. Ces résultats révèlent les principaux moteurs des changements en forêt de
Compiègne, comme dans de nombreuses forêts tempérées gérées d’Europe occidentale, au premier rang desquels figure
l’intensification de la sylviculture, qui influence les microreliefs, la compacité et le niveau trophique du sol, le degré
d’ouverture des canopées et l’attractivité vis-à-vis des cervidés.

2
DUTOIT, MUNSON : communication orale
Des forêts tempérées nordiques aux steppes méditerranéennes, quels paradigmes pour
leur restauration écologique ?
Thierry Dutoit, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie, UMR CNRS-IRD, AMU-UAPV, IUT Avignon, 337,
chemin des Ménajariés, site Agroparc, BP 61207, 84 911 Avignon Cedex 09, FRANCE [email protected]
Alison D. Munson, Département des sciences du bois et de la forêt, Université Laval, Pavillon Abitibi-Price, bureau 3165,
2405, rue de la Terrasse, Québec, Québec, G1V 0A6, CANADA [email protected]
Un des objectifs de la dernière convention internationale sur la biodiversité qui s’est tenue à Nagoya en 2010 est la
restauration écologique de 15 % de tous les écosystèmes de tous les biomes de la planète d’ici 2020. L’écologie de la
restauration est-elle une discipline scientifique capable de fournir les cadres théoriques et conceptuels pour orienter,
accompagner et évaluer ces opérations ? Face à l’extrême complexité du vivant, de la diversité des objectifs de
restauration et des contextes socio-économiques dans lesquelles elles sont menées, existent-ils des paradigmes et
modèles opérationnels pour tous types d’écosystèmes, ou les approches doivent-elles encore rester largement
pragmatiques ? Les deux conférenciers proposent d’apporter des éléments de réponse à ces questions grâce à deux
exemples aussi différents que les forêts tempérées nordiques et les steppes méditerranéennes. Après avoir présenté
l’origine, la distribution et les enjeux écologiques de la restauration de ces deux types d’écosystèmes, les objectifs,
techniques et verrous scientifiques seront dégagés via des retours d’expériences particulièrement significatifs et un
dialogue entre les deux conférenciers. Les différences et/ou ressemblances observées devraient permettre de mieux
dégager l’importance respective des aspects conceptuels ou expérimentaux pour un meilleur succès des futures opérations
de restauration écologique.
HERMY, VANSTOCKEM : communication orale
Les nouveaux écosystèmes réagissent-ils comme leurs cousins plus naturels ? L’exemple
des toits verts.
Martin Hermy, University of Leuven , Celestijnenlaan 200E, 3001 Heverlee, Houwaartstraat 12 Lubbeek 3210, BELGIQUE
Jan Vanstockem, Division of Forest, Nature and Landscape, University of Leuven, Celestijnenlaan 200e, Box 2411, 3001
Leuven, BELGIQUE [email protected]
Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes qui ne cessent de se densifier et qui laissent très peu de place
aux espaces verts. Les toits des édifices sont pour la plupart vacants et les végétaliser augmenterait grandement la
superficie de l’espace vert urbain. Les toits verts existent depuis longtemps, particulièrement en Europe. Pourtant, la
plupart des recherches se concentrent sur leur construction, leurs matériaux et les services écosystémiques qu’ils rendent.
À mesure que les connaissances en ingénierie évoluent, les substrats et les plantes qui sont introduits produisent de plus en
plus d’exemples de nouveaux écosystèmes. Bien que les toits verts nécessitent peu d’entretien, ils sont aussi sujets à la
colonisation spontanée d’espèces indésirables. Pour cette étude, nous nous sommes penchés sur ces colonisations
spontanées et sur le réservoir de graines qui contribue à la végétation des toits verts, ainsi que sur l’interconnexion entre
les deux. Se basant sur la littérature écologique classique, quelques hypothèses ont été émises puis testées afin de
découvrir si ces nouveaux écosystèmes réagissent comme ceux qui sont plus naturels. La littérature concernant la
colonisation spontanée d’espèces indésirables sur les toits verts est peu abondante. Dans notre étude, plus de 120 espèces
ont été trouvées : 80 % de celles-ci se sont installées spontanément, quoiqu’elles ne couvraient, pour la plupart, qu’une
faible surface des toits. Cinquante espèces ont été trouvées dans le réservoir de graines, la majorité (60 %) étant des
espèces spontanées. Près de la moitié des espèces avaient un réservoir permanent de graines.
JACQUEMART, MOQUET : communication orale
Quelle efficacité de pollinisation pour les insectes visiteurs des myrtilles européennes
(Ericaceae) ?
Anne-Laure Jacquemart, Laura Moquet, Earth and Life Institute, Université catholique de Louvain, Croix du sud 2, boîte
L7.05.14, Louvain-la-Neuve 1348, BELGIQUE [email protected]
Tant pour améliorer la production d’espèces commerciales que pour assurer la survie des espèces sauvages, il est essentiel
d’identifier les insectes qui participent au succès reproducteur des espèces végétales entomophiles. Les éricacées sont
particulières, car elles présentent souvent des anthères poricides, le pollen n’étant libéré que lorsque le visiteur produit des
vibrations (buzz pollination). Notre hypothèse est que cet accès exclusif à certains insectes capables de produire ces

3
vibrations (bourdons et quelques abeilles solitaires) leur procure un avantage qui expliquerait ces évolutions particulières.
Cette hypothèse est renforcée par le fait que le pollen d’éricacées est considéré de qualité nutritionnelle médiocre. Nous
avons analysé les qualités nutritionnelles du pollen (polypeptides, acides aminés, stérols) et l’efficacité pollinisatrice des
visiteurs d’éricacées en Europe. Les résultats indiquent que les qualités nutritionnelles du pollen varient fortement entre
espèces, mais sont adéquates pour une diète d’insecte. D’autre part, le comportement de chaque visiteur importe dans son
efficacité de pollinisateur. Chez certaines espèces, le prélèvement de nectar, y compris par tricherie, est efficace pour la
pollinisation, plus que la vibration. L’abondance des visiteurs reste néanmoins le facteur explicatif le plus important dans
l’efficacité : des bourdons très abondants, même s’ils sont peu efficaces, participent plus au succès reproducteur que les
espèces rares spécialistes d’éricacées. Nous nous questionnerons pour savoir s’il en est de même chez les nombreuses
espèces d’Amérique du Nord et quelles conclusions tirer quant à la conservation des éricacées et des insectes
pollinisateurs.
MARCHAND et al. : communication par affiche
Facteurs influençant la croissance des peuplements boréaux aux différents stades de
développement dans un contexte de changements climatiques récents.
William Marchand, Martin Girardin, Centre de foresterie des Laurentides, 1055, rue du PEPS, Québec, Québec, G1V 4C7,
CANADA [email protected]
Yves Bergeron, Université du Québec à Montréal et Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Institut de
recherche sur les forêts, 445, boulevard de l’Université, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 5E4, CANADA
Source de multiples bienfaits et services, la forêt boréale canadienne a de l’importance sur le plan économique, écologique
et social. Les changements climatiques menacent la pérennité de cet écosystème, laissant planer le doute sur les
possibilités forestières futures. Les hausses de températures, associées à des extrêmes climatiques plus fréquents et plus
intenses que par le passé, pourraient conduire à une diminution de la productivité et une augmentation de la mortalité des
peuplements forestiers. L’objectif général de ce projet est d’examiner les réponses des peuplements boréaux aux
changements climatiques récents, en fonction du stade de régénération post-perturbation. Plus spécifiquement, l’impact
des changements climatiques sur la croissance juvénile des peuplements sera étudié. Nous vérifierons si l’allongement de
la saison de croissance a accéléré la croissance juvénile des peuplements récemment régénérés. Nous examinerons ensuite
le poids de la compétition, comparativement à celui du climat, dans la croissance des peuplements. Nous vérifierons si les
peuplements juvéniles sont principalement contraints par la compétition, contrairement aux peuplements matures dont la
croissance serait fortement dépendante des conditions climatiques. Enfin les mécanismes physiologiques associés à la
diminution du taux de croissance des peuplements surannés seront étudiés. Nous vérifierons si ce phénomène résulte d’un
effet combiné de l’épuisement des réserves glucidiques et de la perte de conductivité hydraulique associé à des stress
climatiques successifs.
MOINARDEAU et al. : communication orale
Restauration des communautés végétales herbacées des digues artificielles du Rhône
grâce au pâturage équin.
Cannelle Moinardeau, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie, UMR CNRS-IRD, AMU-UAPV, IUT Avignon,
337, chemin des Ménajariés, site Agroparc, BP 61207, 84 911 Avignon Cedex 09, FRANCE
François Mesleard, Institut de Recherche de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, FRANCE
Denis Roux, ONCFS, Unité Avifaune migratrice, Maison Guende-Rue du Musée, BP 20, 84390 Sault, FRANCE
Romain Brusson, CNR, Direction régionale d’Avignon, 25 bis Chemin de Rocailles, 30401 Villeneuve Les Avignon, FRANCE
Thierry Dutoit, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie, UMR CNRS-IRD, AMU-UAPV, IUT Avignon, 337,
chemin des Ménajariés, site Agroparc, BP 61207, 84 911 Avignon Cedex 09, FRANCE
Les digues artificielles de la réserve de Donzère-Mondragon ont été créées dans les années 1950 suite au creusement d’un
canal de dérivation du Rhône. Soixante ans après, un pâturage équin (Konik-Polski) a été mis en place pour conserver ou
restaurer certaines communautés végétales à forte valeur patrimoniale, qui s’y sont par ailleurs installées naturellement. À
l’aide de parcelles d’inventaires permanentes établies depuis 2014 et d’analyses de photographies aériennes
multispectrales à très haute résolution, notre étude avait pour objectif de mesurer l’effet du pâturage sur la restauration de
l’hétérogénéité de la mosaïque des communautés (diversité β), leur richesse (diversité α) et leur valeur fourragère. Après
trois années de suivis, nos résultats montrent que le pâturage accroît les diversités α et β ainsi que la valeur fourragère, et
ce, suite à l’apparition d’espèces annuelles de pelouses rases, mais seulement pour certaines pressions de pâturage. Les
analyses de photographies aériennes permettent quant à elles de caractériser l’organisation spatiale et la dynamique
temporelle de ces communautés. L’indice de végétation par différence normalisé (NDVI) met ainsi en évidence un impact

4
du pâturage sur la diminution de la densité foliaire en lien avec la pression de pâturage. La juxtaposition des différentes
couches d’information permet pour sa part de caractériser les variations d’informations obtenues après analyse des
photographies et valide ainsi la précision de la méthode pour mieux organiser le système de pâturage en fonction des
objectifs de conservation.
PAQUETTE : communication orale
Vers un couvert forestier urbain complexe et résilient : développement d’une nouvelle
stratégie de plantation.
Alain Paquette, Département des sciences biologiques, Université du Québec à Montréal, CP 8888, succursale Centre-
On trouve dans les grandes villes du Québec, comme ailleurs dans l’est de l’Amérique du Nord, un très grand nombre
d’espèces d’arbres (200 à 400), soit de quatre à huit fois plus qu’on en trouve en forêt naturelle. Ces chiffres sont
trompeurs : en effet, les arbres municipaux sont très largement dominés (50 % ou plus) par seulement quelques espèces,
toujours les mêmes, comme l’érable de Norvège, l’érable argenté et le frêne rouge. Cette situation est-elle préoccupante ?
Comment en est-on arrivé là ? Si problème, quelles sont les solutions ? L’objectif général de nos projets est de doter les
villes de plans directeurs de la forêt urbaine à long terme pour optimiser la gestion quotidienne des arbres, dans le but
d’atteindre des objectifs de résilience et de rendement en services écosystémiques. Nous étudions aussi l’effet d’un
gradient d’urbanisation sur les arbres, de même que les caractéristiques d’un bon arbre en ville. Le but de nos travaux est
d’obtenir à terme une forêt en meilleure santé et mieux outillée pour absorber et récupérer suite aux stress prévus par les
changements globaux (climat, espèces et maladies exotiques, etc.). Nous utiliserons quelques exemples de travaux réalisés
dans plusieurs villes (Québec, Joliette, Ahuntsic-Cartierville) pour montrer l’approche. Un bilan de la situation actuelle de la
forêt urbaine en termes de diversité (selon plusieurs facettes) sera fait et comparé. À ce bilan seront associés des risques en
fonction des changements globaux et des recommandations pour en augmenter la résilience de la forêt. Nous verrons
qu’une approche par groupes fonctionnels permet d’atteindre les objectifs fixés à l’aide d’outils simples et accessibles.
TABACCHI, LAVOIE : communication orale
Invasions végétales : confidences d’un envahisseur et d’un envahi.
Éric Tabacchi, Centre National de la Recherche Scientifique, 118, route de Narbonne, Toulouse, 31062 Cedex 09, FRANCE
Claude Lavoie, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional, Université Laval, 2325, rue
des Bibliothèques, local 1616, Québec, Québec, G1V 0A6, CANADA [email protected]
Les invasions biologiques occupent un espace grandissant dans la communauté scientifique, même si ce phénomène n’est
pas nouveau. Les effets de plusieurs envahisseurs (insectes, champignons, virus, etc.) sur l’économie sont bien connus,
particulièrement en agriculture. Par contre, ceux occasionnés par les plantes sur la biodiversité font toujours l’objet de
vives controverses : certains soutiennent qu’ils ne sont pas perceptibles au-delà de l’échelle locale, d’autres affirment au
contraire que leur accumulation engendrera sous peu un appauvrissement significatif aux échelles régionales et nationales.
On fera dans cet exposé un retour sur ce débat. On mettra aussi en évidence les paradoxes des invasions – une plante
dominante bienvenue ici est envahissante et indésirable ailleurs – et l’inconfort des conférenciers face au traitement
médiatique souvent accordé aux envahisseurs. Nous examinerons dans quelle mesure les propos véhiculés par les médias
et certains organismes voués à la préservation de la biodiversité et du fonctionnement des écosystèmes appuient leurs
affirmations sur des données objectives avec un solide fondement scientifique. Pour ce faire, nous utiliserons des cas de
figures, des plantes qui se trouvent à la fois en Europe et en Amérique du Nord, et qui ont, selon leur origine, le statut
exotique (envahisseur) ou indigène (envahi). L’objectif de cette présentation n’est pas de nier les effets des invasions, qui
sont réels, mais plutôt de mettre en garde les chercheurs contre les conclusions trop hâtives susceptibles d’être reprises
par les médias et de faire la lumière sur les lacunes dans les connaissances qu’il serait urgent de combler pour solidifier le
débat entourant l’impact réel des envahisseurs sur la préservation de la biodiversité à l’échelle mondiale.

5
TISSERANT : communication par affiche
Réponse positionnelle et fonctionnelle des communautés végétales riveraines aux
facteurs environnementaux et à l’aménagement des berges.
Maxime Tisserand, Département de phytologie, Université Laval, Québec, Québec, G1V 0A6, CANADA
Par leur caractère écotonal et leur exposition aux perturbations, les communautés végétales des milieux riverains sont
diversifiées et distinctes de celles des milieux terrestres. En dépit d’une grande diversité d’espèces et de fonctions, ces
écosystèmes figurent parmi les milieux naturels subissant les plus fortes pressions anthropiques. Si les contraintes
d’espace ne permettent pas la restauration écologique, le génie végétal offre une alternative intéressante pour stabiliser
les berges dégradées tout en augmentant leur naturalité. Ce projet vise à caractériser les assemblages d’espèces selon un
gradient de naturalité, soit des berges stabilisées par enrochement ou par des techniques de génie végétal aux berges
naturelles. Les variables environnementales agissant à l’échelle de la berge et du paysage sont prises en compte pour
expliquer la composition spécifique et fonctionnelle des différentes communautés. Au regard de la contribution des sites à
la diversité régionale, le phénomène d’homogénéisation biotique est également étudié. Les communautés d’une centaine
de berges sont échantillonnées à cet effet. Les résultats préliminaires montrent une augmentation de la richesse spécifique
en fonction de la naturalité des berges et une distinction nette des communautés selon le type de berge. Alors que les
communautés de berges naturelles et de berges aménagées par le génie végétal sont composées d’espèces inféodées aux
milieux riverains, les enrochements abritent plutôt un cortège d’espèces rudérales indigènes ou exotiques et d’espèces de
milieux humides.
VALDÈS (DECOCQ) et al. : communication orale
Altérations de la distribution des espèces végétales herbacées forestières induites par la
fragmentation
Alicia Valdès, Jonathan Lenoir, Émilie Gallet-Moron, Guillaume Lecocq, Unité Écologie et Dynamique des Systèmes
Anthropisés (EDYSAN), Université de Picardie Jules Verne, 1, rue des Louvels, Amiens, Somme 80037, FRANCE
Consortium smallFOREST
Dans la plupart des régions tempérées du globe, les habitats forestiers sont réduits à des fragments inclus dans une
matrice paysagère agricole. La taille et l’âge de ces fragments, la distance qui les sépare et la nature de la matrice
paysagère sont susceptibles d’influencer la composition floristique des communautés forestières en filtrant les espèces en
fonction de leur autoécologie et de leurs traits d’histoire de vie. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés à la
végétation de fragments forestiers des paysages agricoles plus ou moins intensément cultivés, le long d’un gradient
latitudinal de 2 500 km s’étendant du sud de la France au centre de la Suède. Nous avons cherché comment la qualité de
l’habitat et le degré de fragmentation influençaient la répartition des espèces herbacées parmi ces fragments. Nous
montrons que bien que la fragmentation ait un effet moins important que la qualité de l’habitat forestier, la distribution
des espèces spécialistes de l’habitat forestier est significativement biaisée vers les fragments les plus grands ou anciens.
Les effets de l’isolement et de l’intensité de gestion de la matrice varient beaucoup d’une espèce à l’autre et dépendent des
traits d’histoire de vie associés à la persistance, à la dissémination et à la compétitivité des espèces. Les mauvais
colonisateurs ou faibles compétiteurs sont les espèces les plus affectées par la fragmentation. Ces résultats plaident pour
une conservation prioritaire des fragments forestiers les plus grands et anciens, et une restauration de leur connectivité.
 6
6
1
/
6
100%