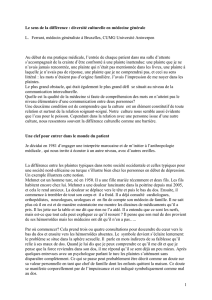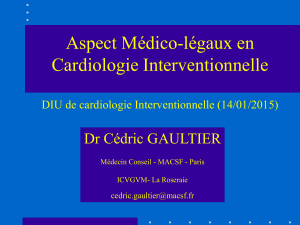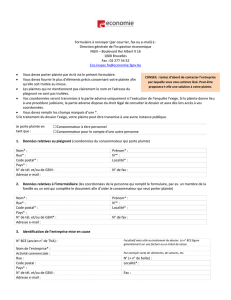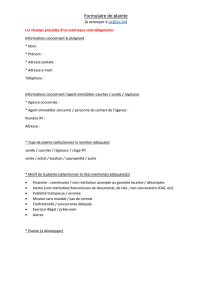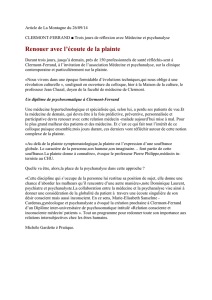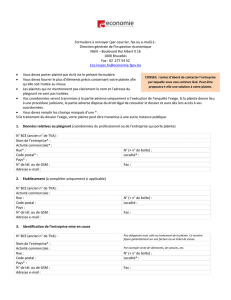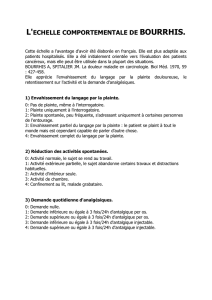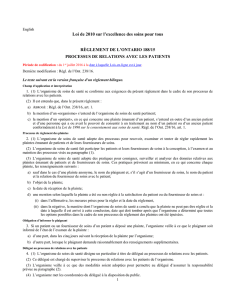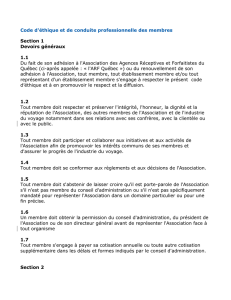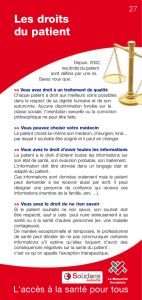critiquer et faire valoir ses droits en tant que patient - chu

Sciences Sociales et Santé, Vol. 33, n° 2, juin 2015
«Inacceptable!»: critiquer
et faire valoir ses droits
en tant que patient
Commentaire
Fabrizio Cantelli*
Ce que critiquer en tant que patient veut dire
En parcourant quelques ouvrages francophones de synthèse de la
sociologie de la santé (notamment Adam et Herzlich, 2007; Carricaburu
et Menoret, 2004; Drulhe et Sicot, 2011) et de santé publique (Fassin et
Hauray, 2010),plusieurs éléments, sans doute vécus par les lecteurs de
cette revue, paraissent négligés: le sens critique du patient, les modalités
d’expression d’une plainte par un patient, les modes d’argumentation
d’une demande par un patient, les modes selon lesquels le patient, ses
proches et sa famille signalent le non-respect de ses droits, par contraste
avec les modes d’énonciation des droits du patient dans la loi, sans
oublier l’ensemble des outils de médiation, dispositifs d’indemnisation,
institutions et politiques de santé qui cherchent à répondre aux patients
dont la confiance est érodée, dont l’expérience d’une situation probléma-
doi: 10.1684/sss.2015.0206
*
Fabrizio Cantelli, maître de conférences, Université libre de Bruxelles, Institut de
sociologie (CP 124), avenue Jeanne 44, 1050 Bruxelles, Belgique ; [email protected]

108 FABRIZIO CANTELLI
tique aiguise une souffrance et motive une demande à l’adresse des
professionnels et des institutions de santé.
Il faut pourtant nuancer ce tableau. Ces ouvrages de synthèse
rendent compte du rôle des associations de patients, des groupes d’en-
traide et de pairs, de la démocratie sanitaire à la française et des trans-
formations héritées des mouvements sociaux dans le domaine de la santé.
Sur ces points, des travaux importants permettent de mieux analyser la
portée des acteurs collectifs et leur place dans les reconfigurations de la
science, de la médecine et des politiques de santé. Il n’en demeure pas
moins que la critique ordinaire du patient, qu’il convient de resituer dans
un contexte plus général, reste peu investiguée. Parler de critique ordi-
naire du patient ne consiste pas à séparer des types de critique mais à
prendre au sérieux toute manifestation du sens critique des patients: celle
qui s’exprime à bas bruit comme celle qui s’exprime à haute voix, celle
qui prend forme à travers des non-dits comme à travers un courrier, celle
qui énonce des questions obliques comme des demandes de réparation et
d’indemnisation, celle qui se partage entre proches, sur les réseaux
sociaux comme celle qui va vers les médias, celle qui est mise en forme et
présentée dans un discours « qui convient» comme celle qui est à vif,
éruptive et désignant des problèmes de différentes natures. Ces manifes-
tations du sens critique du patient sont en relation les unes avec les
autres, un patient peut combiner différentes formes de critique de la même
manière que son activité critique peut connaître des alternances et des
passages.
Dans le domaine de la santé, un point reste sensible : les façons
d’argumenter du patient et de ses proches pointant des contradictions,
signalant des défauts, des défaillances, des préjudices sont susceptibles de
rompre définitivement la relation de soins et le lien thérapeutique.
Critiquer en tant que patient n’est pas un acte léger, sans conséquences
ni répercussions. La critique du patient ne peut pas être détachée de l’as-
signation d’une place à chacun et de la structure de l’interaction patient/
soignant où parler, échanger et interagir signifient, souvent, autre chose
de chaque côté du colloque singulier. Ce point est également riche de sens
quand il s’agit de questionner ce qui peut faire exister et faire valoir les
droits du patient en pratique. C’est d’autant plus important que la critique
du patient doit aussi, comme c’est souvent le cas en situation de tensions
et de conflits, faire face à une gamme de reproches, de jugements, d’im-
putations formulés à son égard ou ses proches par les professionnels de
la santé.
Critiquer en tant que patient comporte des enjeux à la fois spéci-
fiques (propension à retenir la formulation d’une critique le plus long-
temps en raison d’une délégation d’expertise et de confiance, façons de

FAIRE VALOIR SES DROITS EN TANT QUE PATIENT 109
questionner en amortissant et arrondissant les angles lors des interac-
tions en temps réel, etc.) et transversaux par rapport au sens critique se
déclinant dans d’autres domaines. Ce commentaire peut être lu comme un
appel lancé à la communauté francophone des chercheurs à mettre en
débat ce que critiquer en tant que patient veut dire. Cet appel est d’autant
plus vigoureux qu’il existe des travaux ethnographiques anglo-saxons très
importants et largement sous-utilisés — sur les patients afro-américains,
voir Zola (1966), sur les patients cardiaques, voir Millman (1976), sur les
plaintes et procès en milieu hospitalier, voir Press(1984) —, ayant mis en
lumière ce qui se passe, tant du côté des professionnels et des institutions
que du côté d’instances tierces, quand un problème est signalé, quand un
énoncé critique est formulé par un patient et à travers quels genres d’ar-
gumentaires et d’opérations ce dernier s’engage sur cette voie.
Se plaindre dans le cadre d’un dispositif institutionnel
L’article « Imputer, reprocher, demander réparation. Une sociologie
de la plainte en matière médicale » témoigne d’un renouveau dans les
sciences sociales et politiques, renouveau qui gagnerait à être plus nette-
ment présenté et discuté dans les futures rééditions des ouvrages de
synthèse. La loi du 4 mars 2002, précisant les principes de la démocratie
sanitaire en France, ouvre un nouveau droit à l’indemnisation des
victimes d’accidents médicaux « non fautifs» et crée des commissions
régionales traitant les plaintes des patients concernant les accidents
«non fautifs » et « fautifs » (1). J. Barbot, M. Winance et I. Parizot
étudient trois types d’opérations critiques (imputer, reprocher, demander
réparation) réalisées par les patients eux-mêmes ou par leurs proches
dans le cadre de ce dispositif de règlement amiable. Ces opérations
critiques sont étudiées en prenant appui sur une centaine de plaintes
déposées entre 2003 et 2009 par les personnes en vue d’obtenir une
indemnisation des dommages qu’elles estiment avoir subis. L’article
examine des plaintes de patients ayant des issues différentes: avis positif
(1) Ces commissions comprennent également des représentants d’usagers, conformé-
ment à la loi stipulant des droits collectifs, avec une participation des usagers à diffé-
rents niveaux. Le Collectif inter-associatif sur la santé (CISS) a rédigé une fiche
thématique (n°12, 2015) sur le « Droit des malades – Les commissions régionales de
conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infec-
tions nosocomiales », en précisant plusieurs revendications qu’il porte sur cette ques-
tion.

110 FABRIZIO CANTELLI
d’indemnisation au titre de la solidarité et au titre de la faute, avis négatif
avant et après expertise médicale. Si le titre de la contribution signe une
filiation évidente avec Felstiner et al. (1980), les auteurs soulignent une
divergence avec ces travaux qui considèrent la plainte selon un processus
trop linéaire.
Le sous-titre «Une sociologie de la plainte en matière médicale»
désigne un programme à poursuivre ; les rapports complexes et ténus
entre plainte et critique (2) restent encore à interroger par de futures
enquêtes dans le domaine de la santé. Étant donné que l’article porte sur
des demandes de patients, demandes elles-mêmes inscrites dans un
dossier administratif et dans un formulaire officiel d’indemnisation, la
singularité du cadre au sein duquel s’exprime ce genre de plainte mérite
une réflexion approfondie. Ainsi, considérer les différentes conditions
d’accès au dispositif d’indemnisation est inséparable de l’étude du travail
de ce qui est fait par les patients dans leurs courriers : la date du
dommage doit être postérieure au 4 septembre 2001 et le dommage doit
être supérieur à un seuil de gravité. Ce seuil de gravité renvoie à
plusieurs situations:
- soit un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique
(AIPP, ex-IPP) supérieur à 24 % ;
- soit une durée d’arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP,
ex-ITT) supérieure à 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur
une période d’un an ;
- soit la personne est déclarée définitivement inapte à exercer son activité
professionnelle (celle exercée avant l’accident) ;
- soit un déficit fonctionnel temporaire (DFT) au moins égal à 50 % sur
une durée de 6 mois consécutifs ou 6 mois non consécutifs sur une
période d’un an ;
- soit l’accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les
conditions d’existence.
Porter attention aux critères, aux seuils (3) et aux conditions ne
détermine pas la plainte ni le type de raisonnement qui sera conduit par
les patients. Mais ce point est fondamental pour permettre au lecteur de
savoir à quel type de plaintes il a affaire et le cadre dans lequel les
patients écrivent et formulent leurs demandes et leurs critiques lorsqu’ils
cherchent à exercer en pratique leurs droits. Il ne s’agit pas ici d’un cour-
rier dans lequel s’exprime librement le patient sur sa situation probléma-
tique, sur ce qui l’indigne et le fait souffrir, ne fût-ce que par les
(2) Cette piste d’analyse résulte d’échanges croisés avec V. Rabeharisoa.
(3) Par exemple, il existe en France un régime spécifique d’indemnisation des victimes
d’infections nosocomiales.

FAIRE VALOIR SES DROITS EN TANT QUE PATIENT 111
différentes questions et sections à remplir en tant que patient ainsi que par
les procédures précises régissant les conditions d’envoi de la demande
(«formulaire de saisine», courrier recommandé, etc.). Il ne s’agit pas
non plus d’une plainte, entendue du côté médical, comme synonyme de
symptôme sur lequel un travail et une expertise s’exercent (Dodier, 1993).
La signature de la plainte est différente en quelque sorte. Et c’est là un
des enseignements forts de ce papier : ce cadrage administratif de la
plainte, renforcé par des critères de référence et des seuils d’incapacité,
n’agit pourtant pas — pas autant que prévu sur le papier — sur l’expres-
sion de la plainte ni sur les modalités de perception et de catégorisation
de la plainte et du dispositif par les patients eux-mêmes. Certains patients
formulent des demandes et ont des attentes de réparation de nature très
variée (sanction de coupables, reconstruction de soi, etc.), qui se situent
en dehors de ce que peut le dispositif d’indemnisation. Pour le dire à
travers une formule, il y a là non pas un seul mais plusieurs types de
rendez-vous manqués entre les usagers et les dispositifs institutionnels qui
demandent à être élucidés.
Dans cette perspective, la discussion engagée par les auteurs à la fin
de leur article tire plusieurs enseignements, notamment sur les ajuste-
ments/désajustements entre les plaintes et les dispositifs liés à la respon-
sabilité médicale. Cette piste trace des chantiers de recherche novateurs
sur la critique du patient et les institutions ainsi que sur les malentendus,
équivoques, écarts entre les catégorisations du patient et les catégories
administratives et juridiques. Les auteurs soulignent, de façon pertinente,
que «pour certains, ceci témoigne d’une méconnaissance de ce que le
dispositif est effectivement capable de faire ». Cette question incite à
développer des études futures sur ce qui est fait par les institutions de
santé, par les administrations publiques et par les acteurs de la santé pour
informer pleinement le patient quand il rencontre une situation devenue
grave et pour faciliter le partage d’une perception commune du dispositif,
de ses règles, critères et procédures (« rares sont les plaignants qui s’ap-
puient sur un soutien de leur médecin pour faire valoir l’existence d’un
accident médical “non fautif” », indiquent les auteurs, ouvrant le chemin
à des études riches sur la place des acteurs et des appuis médicaux dans
le type d’opérations critiques des patients). Une telle sociologie de la
plainte réinterroge vigoureusement la capacité de l’État à favoriser pour
tous les patients un recours confortable aux droits, aux outils administra-
tifs (un formulaire d’indemnisation) et aux catégories juridiques, une
approche plus hospitalière envers l’expérience ordinaire du patient qui a
subi un problème, encaissé un choc, éprouvé une situation handicapante
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%