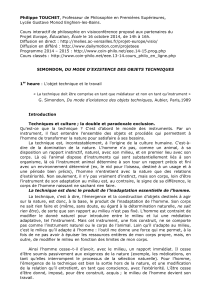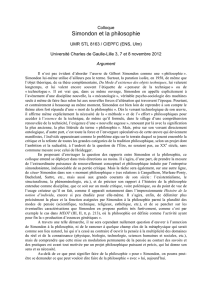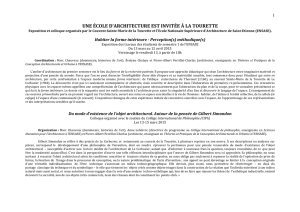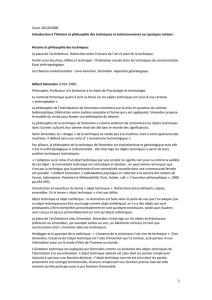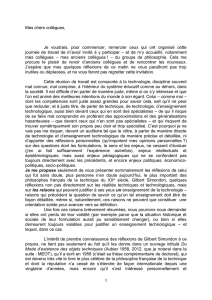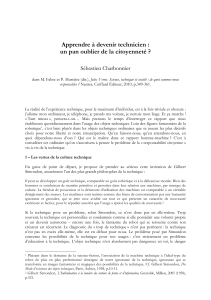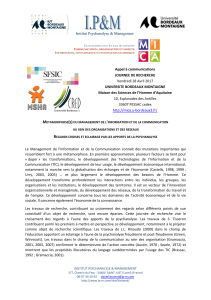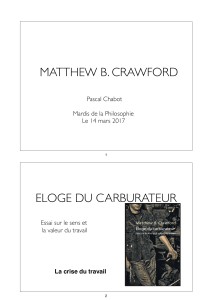(Gilbert), Simondon et la philosophie de la "Culture Technique"

5
COMPTE RENDUS D'OUVRAGES
HOTTOIS.(Gilbert), Simondon et la philosophie de la
"Culture Technique" De Boeck Université. Coll. le point
philosophique - Bruxelles 1993.
Gilbert Simondon fait partie, avec Jacques Ellul, Jean Brun et
Leroy Gourhan des grands noms français de la philosophie de la
technique.
Mais son oeuvre reste mal connue du public voir même
difficilement accessible, faute de rééditions. Espérons que le livre
que Gilbert Hottois vient de consacrer à Simondon contribuera à la
sortie du "purgatoire" de cet auteur dont l'oeuvre puissante et
originale se situe en marge des courrants intellectuels qui ont
dominé la scène intellectuelle française depuis la dernière guerre.
Né en 1924, mort en 1989, Gilbert Simondon a peu publié. Il nous
laisse trois livres :
- Du mode d'existence des objets techniques Aubier 1958
- L'individu et sa guerre physico biologique PUF 1964
- L'individualisation psychique et collective Aubier 1969.
A côté de ces trois livres la bibliographie dressée par Gilbert
Hottois à partir de celle établie par Michel Simondon pour les
Cahiers Philosophiques n
0 43 fait état de 19 textes publiés (articles,
cours et études) et de 19 non publiés.
Le livre de Gilbert Hottois est le
premier
ouvrage consacré au
philosophe. Pour reprendre les termes de la présentation du livre,
son oeuvre cristallisée tout d'un coup à la fin des années cinquante
était à l'époque trop prospective pour la pensée philosophique
dominante. Elle s'inquiétait en effet de mettre en communication
vivante des composantes de notre civilisation qui tendent à
s'ignorer ou à s'opposer radicalement. Elle affrontait le problème
crucial de la dissociation culturelle entre les sciences, les
techniques, les humanités littéraires et inventait pour le résoudre
de nouveaux outils conceptuels. Elle élaborait une authentique
"philosophie de la technique" sans concession ni banalisation. Le
souci de développer une "culture technique" est au coeur de
l'entreprise simondonienne". Pour bien faire comprendre ce projet,
G. Hottois l'a resitué dans l'ensemble de la pensée de Simondon,
mettant en relation sa philosophie de la technique avec sa
philosophie de la vie et avec son ontologie, qui forment un
ensemble très cohérent.
*
* *
Gilbert Hottois a très bien réussi cette tâche difficile en
choisissant comme angle de lecture le thème de la "culture

6
technoscientifique". Il s'en explique dans un chapitre liminaire où il
développe cette problématique indépendament de la
pensée
simondonnienne. Nous sommes d'emblée avertis : ce livre est plus
que l'exposé accadémique d'une pensée philosophique ; il nous fait
participer à une confrontation et à la mise à l'épreuve critique
d'une pensée par une autre pensée qui ne s'efface pas. Simondon
n'y perd rien. On sent d'ailleurs la sympathie d'Hottois pour la
démarche de Simondon (un article ultérieur sur RORTY e n
témoigne) et il se sent suffisament proche de Simondon pour se
permettre de reformuler certaines de ses idées dans une
terminologie Hottoisienne (ainsi p. 92 lorsqu'il introduit le concept
de "technoscience", que Simondon n'utilise
pas).
De cette
confrontation à la fois critique et respectueuse, l'oeuvre de
Simondon émerge dans toute son actualité et sa richesse.
*
* *
Hottois montre comment Simondon
s'est
consacré à une tâche
difficile. D'un côté il a voulu penser l'autonomie de la Technique, sa
radicale altérité qui fait qu'on ne peut pas la penser sous la
catégorie de l'instrumentalité. Pour cela dans le mode d'existence
des objets techniques il a développé une technologie générale qui
reste à ce jour la meilleure
elucidation
de l'autonomie des objets
techniques et plus généralement des systèmes techniques dont il
met en lumière la nature relationnelle, réticulaire, obéissant à des
nécessités
fonctionnelles propres, étrangères aux considérations
psychologiques, économiques, sociales et politiques. Selon les mots
d'Hottois
"//
y a dans l'existence et le devenir objectif technique une
dynamique, une concrétude, un mode d'être auxquels les hommes
-s'ils sont techniciens et comme tels seulement- contribuent, mais
qui présentent, cependant, quelque chose d'absolument résistant à
la réduction philosophique anthropologocentrique classique. Cette
résistance (...) est, par de nombreux penseurs, ressentie comme
inhumaine, anti humaniste." (p. 106)
D'un autre côté, Hottois montre comment et pourquoi
Simondon considère qu'au fond la résistance de la technique peut
être décrite comme humaniste par excellence. Car c'est précisément
"dans le réseau que Simondon entrevoit la possibilité d'une
réconciliation de l'humanité, de la nature et de la technique, sous le
signe de la nouvelle culture". Nouvelle culture qui doit être "culture
technique" : "la pensée philosophique doit réaliser l'intégration de
la réalité des techniques à la culture, ce qui n'est possible qu'en
dégageant le sens de la des techniques, par la fondation d'une
technologie ; alors s'aténuera la disparité qui existe entre la
technique" et les autres registres symboliques (religieux,

7
scientifiques, esthétique, philosophique) de l'être au monde humain.
Ainsi il y a complémentarité entre philosophie et technologie. Selon
les mots d'Hottois
"la
philosophie est là pour nous dire qu'il est
possible, bon, et donc nécessaire, d'être technologue, que le sens du
devenir est celui d'une coévolution métastable du collectif humain
et des technosciences" p. 67. "La technique bien comprise va dans le
sens de la liberté et de la raison à condition que sa propre
autonomie, sa spécificité irréductible, avec son devenir
d'individualisation propre soient reconnus" (p. 106). Ainsi s'annonce
un avenir "profondément humain, parce que fait d'autonomie, de
solidarité, de synergie universelle" (p. 105).
Toutefois au fur et à mesure que progresse sa présentation,
Hottois souligne tout autant que la force et l'exigence radicale de la
pensée de Simondon certaines ambiguïtés qui le laissent réservé
quant à la compatibilité de fond entre culture humaniste et
technique. En effet "on peut se demander dans quelle mesure ces
effets positifs viennent bien de la technique elle même et non de sa
présentation symbolique telle qu'elle est articulée par G. Simondon"
(p.
106), le problème étant pour Hottois de savoir jusqu'à quel point
une "culture technique universelle" peut elle réellement symboliser
la
technique.
Dès lors les quarante dernières pages du livre d'Hottois
serrent de plus en plus près la pensée de Simondon et remontent
de sa technologie à son ontologie et aux présupposés existentiels
d'une démarche qui s'appuie sur l'analogie généralisée (Hottois
parle "d'ontologie transductive généralisée") et qui finit par
dissoudre les différences radicales qu'elle pose au départ.
Simondon, en effet n'hésitait pas à écrire
"//
y a en quelque
manière identité entre la méthode que
j'emploie
qui est une
méthode analogique, et l'ontologie que je suppose qui est une
ontologie de l'opération transductive dans la prise de forme" (cité p.
122).
On pense ici à Hegel et au monisme des philosophie
émanatistes et hermétistes qui intéressaient beaucoup Simondon,
La fascination pour l'unité de l'Etre et de ses manifestations finit
par rendre la mal (l'Autre)
impensable.
Là est une des sources de la
technophilie.
Hottois rejoint les analyses de Jean Brun lorsqu'il écrit
"le fait que le problème de la dissociation a, probablement,
constitué pour G. Simondon d'abord un problème existentiel
personnel
projette
sur la question technique-culture, explique le
mouvement de sublimation qui traverse le mode d'existence des
objets techniques (...) le monde technique réel et ses potentialités
propres, sa spécificité irréductible, passe tout à fait à l'arrière plan
(...). A mesure que la pensée analogico spéculative s'autonomise et
gagne en assurance, la référence au réel, à sa résistance,
son
indépendance, son altérité, qui avait mis la pensée en branle, se
perd"
(p, 124). Il en résulte un certain angélisme et un irénisme

8
technophiie qui fait que le discours simondonnien contient une
ambivalence de fond et un risque radical : "symbolique, il
encourage, sans réserves, les technosciences, y compris dans leurs
fonctions d'objectivation croissante de l'humain, de telle sorte que
le manipulable en l'homme sera de moins en moins exclusivement
symbolique".
*
*
*
Au terme de cette traversée de l'oeuvre de Simondon, ce n'est
pas l'idée de culture technique que recuse Hottois. Il le précise au
terme du chapitre liminaire
"si
nous ne croyons pas du tout à la
possibilité d'une telle culture, différente à la fois d'un projet
encyclopédiste et d'un retour simple à la tradition, nous cesserions
de penser à une philosophie de la technique" (p. 31). C'est plutôt sur
la convergence entre humanisme et technique qu'il s'interroge "la
coévolution
réele
de l'homme et de la technique est infiniement
plus chargée d'inconnues, d'opacités et de virtualités vertigineuses
que l'optimisme universaliste, humaniste et technophiie de G.
Simondon ne semble vouloir le reconnaître. Mais en se la
représentant ainsi il y engage plus
sûrement
l'humanité, dans la
confiance d'une belle aventure, toujours subordonnée à l'idée
-l'illusion philosophique ?- qu'il s'agit de l'aventure de la pensée"
(p.
135).
*
*
*
Pour conclure, quelques mots sur la forme. Hottois a choisi de
faire un livre court, qui va à l'essentiel, c'est à dire aux idées de
Simondon et à leur discussion. Il n'a donc pas restitué en les
résumant les descriptions et analyses concrètes qui justifient ces
idées et qui occupent une part importante des livres de Simondon.
Ce choix semble judicieux et facilite le débat philosophique. Par
contre on aurait aimé que les concepts simondonniens, parfois
déconcertants (transduction, métastable etc) soient définis dès leur
première introduction dans le texte. Je suis également
gêné
par le
procédé qui consiste à renvoyer aux ouvrages discutés par des
initiales (MEOT,
IG,
IPC), plutôt que par le rappel du titre complet.
Cela facilite peut être le travail de l'imprimeur mais pas celui du
lecteur. Ceci dit le livre est à la fois dense et clair, constament
intéressant.
Il donne envie de mieux connaître l'oeuvre de
Simondon, et de lire les prochains livres d'Hottois,
Daniel CEREZUELLE
1
/
4
100%