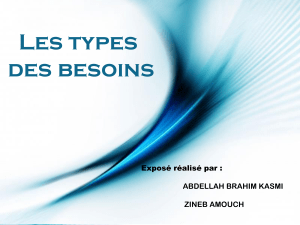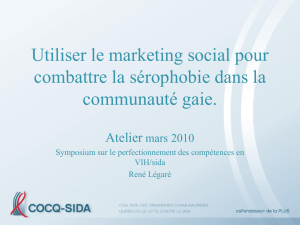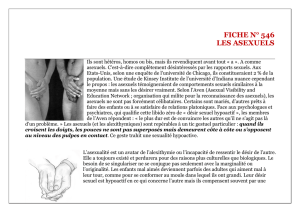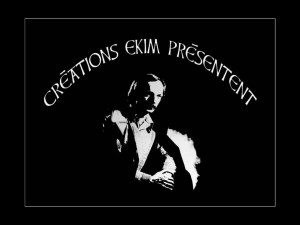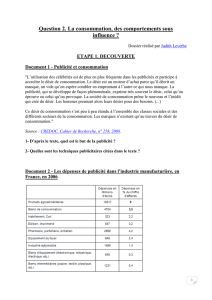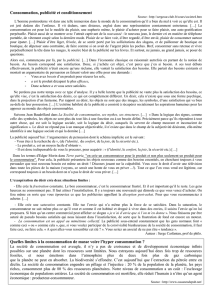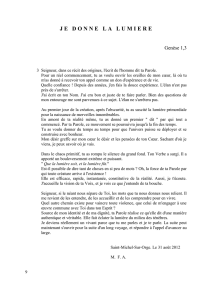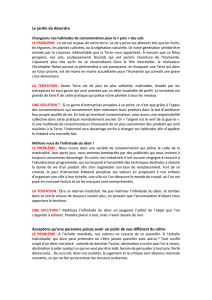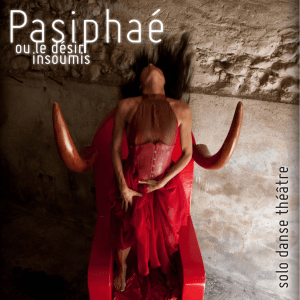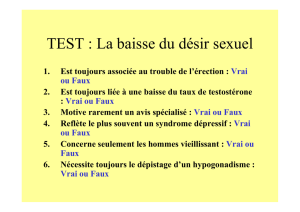Qu`est-ce que le désir aujourd`hui?

Qu’est-ce que le désir aujourd’hui?
Bettina Bergo, Université de Montréal
Le désir, par où commencer une approche du désir? Vous allez écrire sur le désir l’année
prochaine, en essayant d’en dire quelque chose qui n’aura pas été dit ; quant à moi, je ne saurais le
faire.
Je n’ai jamais écrit sur le désir, et souvent je suis Emmanuel Kant dans sa discussion des
passions; là où il assimile les passions à une sorte de désordre, ou de grippe, dont il faut se relever
après s’être cloîtré… Mais cela n’est pas sans ridicule, parce qu’on sait, aussi, que sans passion,
sans le, ou du, désir, on ne fait rien. Se pose donc la question : d’où vient le désir? Est-ce corporel,
hormonal ; est-ce un phénomène qui fait partie de toute intersubjectivité, de toute situation
intersubjective? Le désir est-il donc intentionnel au sens phénoménologique : a-t-il nécessairement
un objet? Et que serait le désir sans objet? Désir d’un dieu? Désir d’apothéose? Désir flottant,
mouvant ; pure passion à la recherche d’un objet ou d’un moyen de se réaliser ? Et qu’est-ce que
réaliser un désir? Se limite-t-il à un passage à l’acte? Auquel cas, pour ma part, je suis déjà ennuyé
par le concept.
Passons brièvement à la science du désir, ou du désirement (comme on a traduit le terme si
étrange de Schelling « Sehnsucht », ou souhait qui fait souffrir). Quelle est cette science? Eh bien,
est-ce la psychanalyse? La psychanalyse est-elle une science? La question est complexe; elle est
bien une thérapie… du désir. Freud a observé que le désir passe d’objet en objet, parce que l’origine
du désir se trouve dans le corps, elle est pulsionnelle. De ce fait, puisque la finalité de toute pulsion
est sa ‘décharge’, le désir—qui est la manifestation socialisée de la pulsion qu’on expérimente—
le désir change d’objets; il peut s’avérer presque indifférent aux objets : on adorait son père, ou sa
mère, et on passe sa vie à rechercher quelqu’un de semblable, ou de ressemblant. C’est intéressant,
cela, parce qu’on voit ici que le désir peut entrer en conflit avec bien des normes sociales, voire
mettre en danger un ordre social, ou économique, donné. Cela ouvre une question nouvelle : le
rapport entre le désir et la résistance… sociale, politique; voire celui entre le désir et l’utopie, ou
ce qu’on appelle l’eschatologie : une doctrine concernant la fin, ou la finalité, du temps de l’homme,
disons. On n’est pas loin de Nietzsche et de son Zarathoustra. Pour ne pas parler de la résistance
structuraliste de Michel Foucault, qui a fini dans une recherche, auprès des grecs, d’une akrasie,
d’une autonomie par rapport au désir, pour faire de sa vie « une œuvre d’art ».
Je retombe toujours dans l’histoire de la philosophie, sauf que mon « histoire » est aussi
une contre-histoire. Par exemple, si le thème du désir se trouve chez Gilles Deleuze dans la forme
des gestes et rapports qu’il appelle « les machines désirantes », qui est aussi sa définition de notre
manière d’être dans le monde fondamentale, j’ai découvert que ce discours sur le désir remonte
bien plus loin. Arrêtons-nous, par exemple, à la réception de Nietzsche dans les années 1910.
Ludwig Klages, dans le sillage de Nietzsche, va créer une philosophie de la vie. Il publie un petit
tome qui s’intitule « Eros cosmogonique ». Dans ce livre, il prétend que la volonté, et notamment
la volonté de puissance chez Nietzsche est mal conçue, mal pensée : la volonté, dit Klages, ne meut
rien; elle est comme une faculté kantienne, mais elle est aussi pure fiction. Seul le désir motive ;
seul le désir meut l’être humain… le reste, c’est de la construction philosophique. Klages, en un
sens précurseur de Deleuze (avec bien d’autres, comme Bergson), se voit récupéré par les national-

socialistes. Il n’est pas lui-même Nazi; sa philosophie de la vie, et du désir, alimentait leur propre
rêve, ou fiction d’un peuple en mouvement, d’un sang en ébullition, etc. On voit que lorsque vous
commencez à parler du désir, il faut faire attention à ce qui se trouve impliqué dans et par votre
discours. Quelle philosophie sous-tend votre discours? Comment concevez-vous un être humain;
comment envisagez-vous nos raisons d’être, s’il y en a?
Bref, le désir ouvre la porte à des questions larges, importantes ; et il peut aussi vous révéler,
à vous (et aux autres), le dessous de votre pensée, des aspects d’un non-conscient, qui sont
empreints de valeurs et de jugements. Cela est bien, et en soi c’est tout une expérience.
Sachez, enfin, que désir et désastre sont liés étymologiquement. Comment cela? Un d’entre
ces termes est bon, l’autre… désastreux.
L’infinitif latin derrière notre “désirer” est “desiderare”: c’est espérer, souhaiter, s’attendre
à, anticiper, etc. À l’origine, cela impliquait aussi ce désir ouvert dont je parlais au début : c’était
s’attendre à ce que les étoiles nous montrent, nous donnent un signe; cela vient de « sidere » ou
encore de « sidus » le génitif pour « sideris » ou les corps célestes.
Dans un monde où le dieu de bien des monothéismes est largement décédé, on se trouve
dans la situation curieuse d’attendre, encore, avec “désirement” ce que les étoiles nous montreront.
Bon gré mal gré, cela implique aussi une passivisation, une certaine passivité. Après tout, nous
divinités humaines… que voulez-vous qu’on attende d’eux? L’arrêt du changement climatique?
Bref, de nos jours, il me semble qu’on est là, parfois, à espérer que quelque chose nous soit indiqué
… d’ailleurs… sans métaphysique. Un signe, des étoiles… comme les romains. Mais rappelons la
parenté entre désir et désastre. Si sidere dénote ce qui relève des événements ‘dans le ciel’, l’appel
d’une étoile… le mot dés-astre montre encore plus clairement sa parenté avec les étoiles. Maurice
Blanchot, qui mérite d’être lu par des gens en philosophie, a écrit un texte qui s’appelle L’écriture
du désastre, où il nous rappelle que nous avons, depuis quelques 70 années environ, perdu le nord,
l’étoile du matin. Blanchot veut simplement dire que les directions, les agendas,… le sens même
ne s’impose plus d’en haut ou d’ailleurs. On serait, depuis les catastrophes du XXe siècle, sans
astre; dans un dés–astre.
Ce qui m’amène à ma question du début: qu’est-ce bien que le désir aujourd’hui ? Je ne
parle pas des désirs inculqués artificiellement en nous, les désirs de publicité, ou d’évasion. Ils ne
sont pas mauvais… surtout ce désir d’évasion qui jamais ne se meurt… (on est bien vendredi et on
sait que : « the eagle flies on Friday » -- plus beau moment pour l’évasion, dont on croit qu’elle
durera longtemps).
Mais à part ces désirs, le désir en tant que tel, en tant que souhait, espoir, pure mouvement
passionnel, survit-il? Nécessairement, mais en quelles formes? Quels sont ses objets… quels
peuvent être ses objets dans un monde où tout passe en objet-commodité ? Voilà quelques
questions, peut-être, à méditer sur le thème du désir.
1
/
2
100%