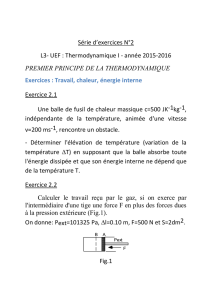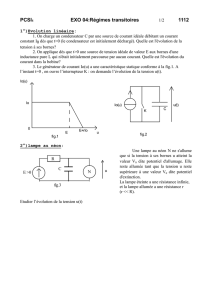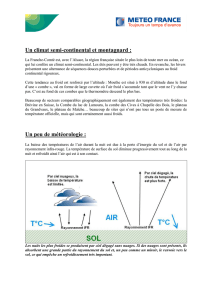decouverte d`un village celtique et d`un petit etablissement gallo

DECOUVERTE D’UN VILLAGE CELTIQUE ET D’UN PETIT ETABLISSEMENT GALLO-
ROMAIN SUR LE TRACE DE LA LINO DANS « LA PEUTE COMBE »
Les travaux d’aménagement de la liaison routière nord (LINO) de l’agglomération dijonnaise, sur
notre commune et celle de Talant, ont été l’occasion de mettre au jour, dans la Peut Combe, des
vestiges archéologiques qui ont conduit à écrire de nouvelles pages de l’histoire de notre cité.
La fouille, réalisée sur une surface de 8000 m² par une équipe d’une vingtaine d’archéologues de
l’INRAP en 2009, a été prescrite par les services de l’Etat (Drac Bourgogne) à la suite d’un
diagnostic réalisé en 2008, ayant révélé une importante concentration de vestiges protohistoriques
et gallo-romains.
Monsieur Régis LABEAUNE et Stéphane ALIX nous retracent ici les résultats avancés des analyses
réalisées depuis ces découvertes.
1. Cadre général
Situées à l'ouest de Dijon, les découvertes d’un petit établissement gallo-romain et d’un habitat du
V
ème
siècle av. J.-C, s'étendent sur les communes de Plombières-lès-Dijon et de Talant au creux de la
« Peute Combe » et s’inscrivent dans le cadre des travaux d’aménagements de la liaison routière Nord
de l’agglomération dijonnaise. Cette opération, réalisée en 2009, sur une surface de 8000 m² par une
équipe d’une vingtaine d’archéologues de l’INRAP, a été prescrite par les services de l’Etat (Drac
Bourgogne) à la suite d’un diagnostic réalisé en 2008, qui avait révélé une importante concentration
de vestiges. La « Peute Combe » est un vallon étroit orienté nord/sud, dont les versants sont abrupts,
incisant les plateaux calcaires et débouchant sur la vallée de l’Ouche. La végétation sur les pentes est
caractérisée par de nombreux arbustes comme des buis et son exposition ensoleillée lui donne un
aspect de paysage méditerranéen. L’érosion des pentes et le ruissellement constituent les facteurs
principaux de l’accumulation de sédiments qui a permis une préservation exceptionnelle des deux
sites les protégeant ainsi des labours ou de toutes autres destructions postérieures. En effet, cette
sédimentation atteint une moyenne de 60cm depuis l’époque gallo-romaine (fig. 1), à plus de 1,50m
depuis le V° siècle avant notre ère. Avec une telle épaisseur de colluvions entre les deux occupations,
le site protohistorique n’est perturbé que par de rares structures fossoyées gallo-romaines profondes.
2. Le village celtique (-500 à -450 av. J. –C.)
Son organisation est fortement conditionnée par le cadre géographique. En effet, la combe ne
mesurant qu’une quarantaine de mètres de large, les constructions se sont installées dans sa
longueur formant ainsi un « village rue » qui était composé de quatorze bâtiments (fig. 2). Sept
d’entre elles possédaient un sol en terre battue. Cet aménagement intérieur soigné laisse supposer
que nous sommes dans des maisons d’habitation. Les sept autres bâtiments, qui ne possédaient pas
d’aménagement au sol ou simplement un plancher en bois, devaient correspondre soit à des granges
soit à des hangars. Au centre du village, se trouvait un atelier métallurgique dans lequel étaient
fabriquées des fibules, des trousses de toilette ou encore des agrafes de ceinture. La spécialisation de
la forge associée à la faible capacité de stockage alimentaire du site, laisse supposer que ce village

n’est pas totalement autonome et ferait partie d’un habitat aggloméré installé dans le secteur du
Dijonnais mais qui pour l’instant n’a pas encore été découvert.
Les plans des maisons sont difficiles à observer car, même si la majorité des trous de poteaux
porteurs subsiste grâce à leur profondeur, les cloisonnements internes et périphériques restent
lacunaires, en particulier dans la partie ouest des bâtiments, soumise à une érosion importante.
Trois catégories de bâtiments ont ainsi pu être identifiées :
- les plus grands mesurent environ douze à quatorze mètres de long pour 6 mètres de large. Les
espaces sont divisés en trois travées inégales. La travée centrale abrite un foyer placé sur l’axe de
symétrie. Au nord, une abside ferme les bâtiments, tandis qu’au sud une travée égale à la moitié de la
travée centrale pourrait soit constituer une toiture en pavillon, soit former un « porche » couvert. La
structure de construction est mixte, c'est-à-dire qu’elle associe des sablières porteuses pour les parois
avec un encadrement de poteaux porteurs pour l’ossature interne (fig. 3). Les sols sont aménagés en
argile damé.
- les bâtiments de taille moyenne conservent les mêmes proportions mais leur longueur est d’environ
une dizaine de mètres et le sol est aménagé avec des planchers dont il ne subsiste que les
lambourdes.
- les bâtiments dont le plan rectangulaire est centré ; ils présentent un sol en « cuvette » de type fond
de cabane. Un plancher est envisageable, en raison de la présence d’une couche charbonneuse sur
toute la surface et sous cette couche, d’une tranchée pouvant constituer une lambourde.
4. La forge au centre du village : une découverte exceptionnelle
Au centre du village, un bâtiment avait une structure et une fonction particulière. Une bipartition de
ce bâtiment en deux travées proche du carré semble nette : la moitié sud, caractérisée par les murets
de pierres sèches et par deux poteaux, serait en grande partie abritée par des cloisons pleines, alors
que la moitié nord, plus légère, pourrait être ouverte sur trois côtés. C’est dans cette seconde partie
qu’a été mise au jour une plaque foyère aménagée d’une sole d’argile et bordée sur un côté par trois
pierres sur champ (fig. 4). Les battitures de fer et les coulées de bronze qui ont été découvertes sur le
foyer prouvent que ces deux métaux étaient travaillés au même endroit.
Les scories de fer retrouvées nous démontrent que nous ne sommes pas sur un lieu de transformation
du minerai en métal mais plus sur un endroit ou le produit arrivait en barre et était épuré puis
travaillé. De nombreuses chutes de barre, des tiges et des tôles découpées attestent d’une activité
importante du travail du fer. A travers l’ensemble des vestiges métalliques, il est possible d’évoquer
les productions qui ont été réalisées à la Peute Combe. Parmi les plus remarquables, on peut noter la
confection d’éléments de vêtement : fibule à timbale (fig. 5), crochet de ceinture ou encore trousse de
toilette.
Le bronze était fondu dans des creusets en terre cuite puis coulé dans des moules. Les traces de cette
activité sont très ténues car les déchets de bronze sont rares, car recyclés, et les creusets ou les
moules sont très fragiles et résistent mal au temps. La présence sur le site d’une boule d’étain (Sn :

96%) et d’une plaque de plomb (Pb : 94%), qui servent de matière première pour la fabrication des
alliages cuivreux, restent des découvertes exceptionnelles pour la période.
La présence de nombreux outils (ciselets, limes (fig. 6), martelets...) nous apportent également de
nombreux renseignements sur le travail réalisé sur le métal.
5. Les activités de la vie quotidienne
La céramique abondante présente sur le site se caractérise par la présence de toute la gamme des
vases culinaires : céramiques de grande taille destinées au stockage et à la cuisson des aliments,
céramiques fines destinées à la préparation et au service de table. Certains récipients sont décorés de
motifs géométriques peints à la barbotine beige ou noire (argile liquide permettant de réaliser des
dessins sur le vase) (fig. 7). A cette époque, apparaissent les premières céramiques tournées dans le
monde celtique et la présence d’un fragment d’un vase réalisé au tour est une découverte
exceptionnelle car c’est la première fois qu’une telle céramique est mise au jour dans le dijonnais.
Le matériel de filage, de tissage et de couture et tout ce qui concerne la fabrication des vêtements est
une activité difficile à repérer lors des fouilles car la plupart des matériaux sont en matière périssable.
La première étape consiste à filer la fibre textile à l’aide d’un fuseau terminé par une fusaïole en terre
cuite (fig. 8). Ensuite vient la transformation du fil en produit fini (toile, drap…) avec des métiers à
tisser verticaux en bois, avec des poids en terre cuites, des pesons. Enfin, la dernière étape, est la
couture qui est réalisée avec les aiguilles.
La parure représente la part la plus importante des mobiliers métalliques découverts dans « La Peute
Combe » avec pratiquement 94 objets. Plus de 12 types différents de fibules (fig. 9) (broches servant à
maintenir les vêtements) en bronze et en fer, des bracelets, des anneaux de chevilles, des boucles
d’oreilles et des bagues sont révélateurs de la diversité de la production métallique destinée aux
femmes.
Enfin, les ustensiles de toilette se divisent en deux grands types, les pinces à épiler et les scalptoriums.
Ces derniers se caractérisent par une extrémité bi-pointe se prolongeant par un manche. La fonction
de cet objet n’est pas réellement définie il pourrait servir de tire-tiques ou de cure-ongle. Dans les
sépultures ils sont reliés aux pinces à épiler, constituées de deux bras et d’un ressort, par un petit
anneau pour former une trousse de toilette. Un rasoir est également présent complétant la panoplie
de la trousse de toilette. La lame est courbée et la soie rectangulaire est enroulée sur elle-même
formant un anneau qui permettait de le rattacher aux trousses de toilette.
6. Que mangeaient-ils ?
Les silos découverts se concentrent dans la partie nord de la combe. Ces structures étroites en surface
et très évasées à la base permettent de stocker une grande quantité de graines qui, protégées en
milieu clos, peuvent se conserver plusieurs années (fig.10). Ils sont peu nombreux et leur taille est
réduite. Sur le site, les restes végétaux sont exclusivement conservés car ils sont entièrement
carbonisés. Les premiers résultats d’analyses témoignent d’une agriculture caractérisée par la grande

diversité d’espèces de céréales et légumineuses. Parmi les céréales, l’orge vêtue polystique et le millet
commun sont les plus fréquents. On doit notifier aussi la culture de trois blés vêtus : l’épeautre,
l’amidonnier et l’engrain. Les principales légumineuses cultivées sont la lentille, l’ers et le pois. Les
résultats des analyses carpologiques suggèrent une agriculture caractérisée par une polyculture de
céréales et légumineuses. La cueillette de fruits sauvages a fourni des compléments alimentaires,
nutritifs et riches en vitamines : noisettes, prunelles et pommes sauvages. Les adventices – les
mauvaises herbes qui accompagnent les cultures – suggèrent déjà une rotation des cultures et des
champs en jachère pour préserver la fertilité du sol. La mise au jour de meules en grès ou en granite
atteste d’une activité de transformation des céréales dans un cadre domestique.
L’étude des os d’animaux (archéozoologie) nous révèle également une multitude d’informations sur
l’élevage et sur les modes alimentaires des personnes qui vivaient à la « Peute Combe ». Les espèces
les plus représentées sont les caprinés suivis par les suidés puis par les bovidés. Nous sommes dans un
environnement de basse-cour d’élevage, de petits animaux et non dans celui d’une exploitation
agricole. Les animaux sauvages sont également représentés avec la présence de cerf, de chevreuil et
même de castor. Une lame de couteau dont la morphologie peut être comparée à celle d’un couteau
à désosser, donc plutôt associé à des activités de boucherie, a été mis au jour. Cette découverte
associée aux traces de découpes observées sur des os de chien, de cheval ou encore de cerf attestent
la consommation de ces animaux sur le site.
7. L’occupation gallo-romaine (0 à 70 ap. J.-C.)
Un petit établissement agricole gallo-romain s’installe dans la combe plus de 400 ans après
l’abandon du village celtique.
Crée au tout début du I
er
siècle après J.-C., il a une brève période d’activité : il est abandonné
aux alentours de la fin du règne de Néron (69 ap. J.-C.). Pourtant, durant ce laps de temps voient se
succéder 4 phases architecturales bien distinctes sur le corps du bâtiment principal et toute une série
de réaménagement dans sa périphérie. Au regard de leur nature (modeste exploitation agricole), les
vestiges gallo-romains se sont révélés étonnamment complexes et relativement en bon état de
conservation.
L’établissement occupe une surface tout en longueur d’environ 2500 m² (100 x 25). Il s’organise
autour d’un corps de bâtiment principal, situé en amont d’un espace correspondant à une cour
empierrée (à partir du second état). Les évolutions les plus marquées concernent le bâtiment principal
(fig. 11).
La première phase d’occupation (phase A : 0-15 ap. J.-C. ?) voit l’installation d’un bâtiment à
plateforme sur poteaux inclinés d’environ 6 m de côté. Il reste peu de vestiges de cette première
époque. De plus, pour une partie d’entre eux, il est difficile de comprendre leur agencement avec le
bâtiment principal. Ce type d’architecture s’inscrit dans une tradition qui a été bien mise en évidence
pour la période de la Tène finale dans le nord-est de la Gaule.
Dans un second temps (phase B : 15-30 ap. J.-C.), le bâtiment est reconstruit complètement. Il
change d’architecture, s’appuyant désormais sur des sablières basses et des poteaux (env. 9 x 7m). Il

reste toutefois sur le même emplacement avec orientation identique. Une vaste cour empierrée est
aménagée en aval du bâtiment.
Par la suite (phase C : 30-50 ap. J.-C.), le bâtiment principal est à nouveau reconstruit (env. 10 x
7m) : il change alors d’orientation et sa localisation se déplace légèrement. Son architecture
commence d’utiliser – modestement – la pierre : il repose en effet sur des poteaux porteurs qui
s’appuient sur des plots en pierre. Une terrasse, limitée par un muret, est aménagée au sud du
bâtiment, le séparant formellement de la cour. Un petit bâtiment fonctionnel en bois est construit au
sud de la cour. Un puits est creusé au centre de la cour durant cet état ou le suivant.
Dans une quatrième phase (phase D : 50-70 ap. J.-C.), l’architecture du bâtiment principal
évolue une nouvelle fois. Englobant les plots en pierre de l’état précédent, une série de murs le
ceinture. Toutefois, il ne s’agit que de murs bahut, la construction continuant de s’appuyer sur des
poteaux porteurs. L’autre modification marquante de cet état concerne la cour qui se structure un
peu plus à l’est par la construction d’un muret de terrasse.
Enfin, la bordure ouest du site accueille une série de structures, parmi lesquelles les vestiges
d’un grenier sur poteaux, qui ne peuvent être placés avec certitude dans l’une ou l’autre des phases.
Ce petit établissement constitue un excellent exemple de ces petites exploitations qui
constituent une des bases du tissu agraire gallo-romain (fig. 12). Les exploitations de cette taille sont
rarement aussi bien conservées et finalement assez peu étudiées. Son évolution montre modestement
le passage d’une architecture en bois, de tradition gauloise, vers une utilisation plus marquée de la
pierre. Elle témoigne également d’un dynamisme relatif tout au long de sa courte durée de vie.
NB : Les travaux ont donné naissance à une plaquette dans la série « ARCHEOLOGIE EN
BOURGOGNE : Des gaulois dans la combe, Plombières-les- Dijon, Talant (Côte d’Or) ». Cette
brochure, dont Plombières est le maître d’ouvrage, est publiée par le Service Régional de
l’Archéologie de la DRAC de Bourgogne.
Cette plaquette a été remise à tous les foyers de la commune.
1
/
5
100%
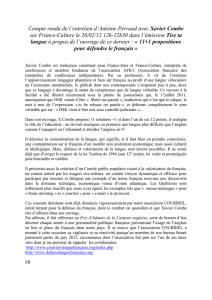




![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)