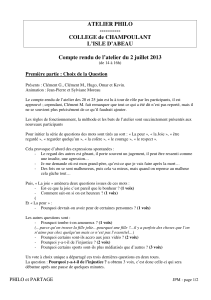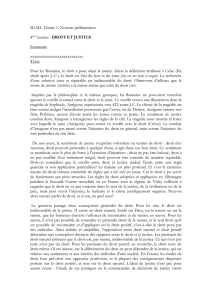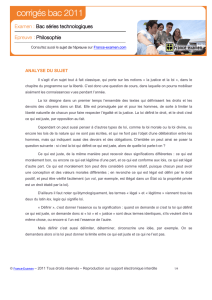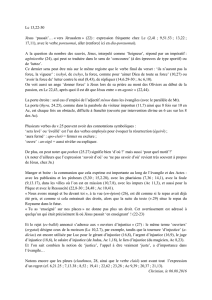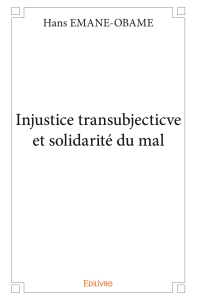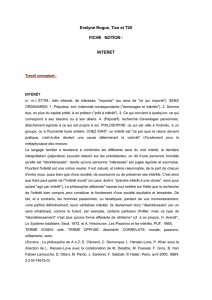Justice / injustice

Corinne Roux-Lafay
Professeure de philosophie – ESPE de Saint-Etienne
1
Justice / injustice
En rouge : tout ce qui dénote une confusion conceptuelle
En vert : toutes les remarques qui articulent la thématique de la justice à celle du
respect.
En bleu : les réactions qui répondent effectivement à la possibilité d’être juste « Peut-
on toujours... », et non à la nécessité morale, au devoir d’être juste ? « Doit-on
toujours… »
Est-ce qu’on peut toujours être juste ?
- être juste c’est être poli (confusion conceptuelle justice/politesse sans doute sous-
tendue par l’analyse préalable du respect, dans le sens de l’attention portée à
l’autre.)
- oui parce que c’est bien pour les autres (respect d’autrui sans lequel nulle vie en
commun ne serait possible)
- pas tout le temps, ça arrive d’être injuste (constat de l’injustice qui n’en analyse
pas les causes).
- non, on ne peut pas donner d’ordres tout le temps (confusion avec l’autorité, voire
l’autoritarisme, de ceux qui rappellent les valeurs en vue de les faire respecter :
parents et professeurs sans doute. Expression qui laisse à penser que les valeurs de
justice se décrètent, de manière plus ou moins arbitraire, par ceux qui ont le
pouvoir, d’où la question effectivement essentielle de savoir « qui décide du juste
et de l’injuste ? »)
- on ne peut pas être juste avec les choses sur lesquelles on n’est pas d’accord
- on peut être juste si on respecte les gens (on ne ment pas et on n’est pas méchant)
(articulation intéressante entre les 2 thèmes de la justice et du respect, à travers un
critère commun : se mettre à la place de l’autre)
- Non, parce qu’on fait des erreurs (confusion, facile à dissiper, entre justice et
justesse, due aux annotations dans les copies).
- Non parce que ça peut être juste pour moi et pas juste pour quelqu’un d’autre (est
ici en jeu l’idée d’un relativisme des valeurs)
- Non parce que personne ne sait tout (là encore, la justice est confondue avec le
savoir, ce qui appelle la question de savoir si l’on peut être juste et ignorant ou, au
contraire, cultivé et profondément injuste, voire inhumain : exemple des officiers
nazis, culturellement raffinés)
- Oui, parce que lorsqu’on est méchant avec vous, vous n’êtes pas obligé de réagir
(idée très pertinente d’un rapport moral aux valeurs non conditionné par la
situation ; voir Kant : le propre de la morale est de valoir inconditionnellement)
- Non parce qu’il y en a qui n’ont pas envie d’être juste (est posée là la question
d’une éducation aux valeurs qui ne sont pas soumises à mon bon vouloir, tout
comme le respect de toute personne, par essence inconditionnel)
- Non parce que, des fois, la colère nous rend injuste (est vraiment posée là la
question de la possibilité d’être juste, de la nécessité d’une maîtrise de soi pour
rendre effective cette exigence de justice, idée déjà rencontrée dans le débat sur le
respect).
- Non parce que la vie est injuste (idée sociologiquement pertinente de savoir
comment être juste lorsque l’on est confronté quotidiennement à l’injustice sociale,
économique, etc. Là encore, idée déjà analysée : comment respecter les autres, et
soi-même, lorsqu’on a régulièrement affaire au mépris des autres ?)

Corinne Roux-Lafay
Professeure de philosophie – ESPE de Saint-Etienne
2
- Non parce qu’on n’a pas toujours raison (il s’agit là de savoir si les normes de
justice qui valent pour soi peuvent être universalisables : combien de crimes
effectivement commis au nom de la justice ou au nom de Dieu !)
- Ça dépend si l’autre est juste avec toi (fait à nouveau surface l’idée du relativisme
des valeurs, à interroger, mais aussi le problème de critères de justice susceptibles
d’être partagés pour faire autorité))
- Oui, ce n’est pas parce que tu n’aimes pas quelqu’un que tu ne dois pas être juste
(idée de l’universalité des principes moraux qui ne le sont qu’à la condition de
valoir pour tout homme)
Pour toi, c’est quoi être injuste ?
- c’est de ne pas respecter ce qu’on a dit
- c’est quand on est méchant avec les autres
- c’est de décevoir quelqu’un
- c’est être jaloux
- c’est avoir tort (on peut présupposer qu’il s’agit ici d’une personne qui ne
reconnaîtrait pas ses torts et ferait alors acte d’injustice à l’égard de la victime)
- c’est faire punir quelqu’un à ta place.
Dans tous ces exemples, la justice est comprise comme une sorte de vertu morale consistant à
respecter autrui selon une norme absolue de réciprocité
- c’est être puni pour ce qu’on n’a pas fait
- c’est quand on nous ment
Ces deux derniers exemples témoignent d’une interprétation de la question (injustice subie,
mais toujours en référence à l’idée de respect de normes et valeurs morales, susceptibles
d’être universalisées)
- c’est être incorrect (confusion avec l’impolitesse)
- c’est faire faux (confusion justice/justesse ; injustice/erreur)
En violet : valeurs du juste et de l’injuste décidées par ceux qui exercent des responsabilités
du fait de leur statut d’adulte ou de leur mission éducative, ou de par leurs fonctions politiques
(représentants de l’Etat).
En orange : référence à des lois transcendant les intérêts particuliers (idée de Bien Commun
ou de Volonté Générale émanant du peuple, dans les démocraties, et incarnée par les
représentants de l’Etat et institutions)
En gris : justice qui se réfère à l’autorité de ses propres normes (idée pertinente si de telles
normes et valeurs sont dictées par la raison et non par l’arbitraire de la subjectivité : on parle
alors d’autonomie morale).
Qui décide de ce qui est juste ou pas ?
- Les parents
- Les grands
- Les lois du pays
- Les maires, Le président
- Les maires, Le président
- Tout le monde

Corinne Roux-Lafay
Professeure de philosophie – ESPE de Saint-Etienne
3
- Toi-même, c’est à toi de gérer ce qui est juste ou pas
- La justice, le juge, la police
- La justice, le juge, la police
- Les maîtres
- Les gens qui ont de l’expérience
Suggestions pour préparer la séance :
1° Partir des représentations des élèves pour opérer une discrimination conceptuelle :
*ce que la justice n’est pas (la politesse ; la justesse ; le caprice du désir : serait juste
ce qui serait à même de servir mes intérêts ; l’obéissance non critique à des lois, normes et
valeurs contraires, par exemple, au respect de la personne)
* ce que la justice est : une vertu morale irréductible à l’utilité (à articuler avec le
respect qui ne sert pas toujours mes intérêts), comme au respect des lois (problème d’une
attitude trop légaliste ; exemple des lois injustes comme la législation antijuive sous Vichy,
mais nombre d’exemples plus actuels abondent !). Problème de la désobéissance civique. Il
peut être ici intéressant de distinguer ce qui est seulement légal de ce qui est légitime
moralement, en référence à des principes de justice (ainsi, les droits de l’homme sont rappelés
dans le préambule de la Constitution et servent de référence en cas de vide juridique). La
justice est aussi la norme du droit. Le problème est alors celui de la dissonance pouvant
exister entre certaines normes personnelles de justice et celles qui sont en jeu dans la société,
de l’articulation entre la justice morale et la justice sociale. Exemples de conflits de valeurs
proposés sous forme de dilemmes moraux par Galichet, Pratiquer la philosophie à l’école.
2° Pour déterminer les critères de la justice, partir plutôt des situations d’injustice
vécues par les élèves, de manière à dégager le critère de l’universalité.
- Critère de l’universalité avancé par les élèves à travers l’idée de se mettre à la
place de l’autre. La justice doit valoir pour tous les hommes. A référer aux droits
de l’homme, en leur prétention à l’universalité. Exemple donné de la
discrimination raciale dans Goûters philo mais aussi sexiste, etc.
- Problème des valeurs culturellement déterminées : l’excision n’est-elle pas « juste"
« dans les pays où elle se pratique ? Mais alors au regard de quels critères ?
En ce qui concerne la justice sociale, il convient de distinguer une justice purement
arithmétique (« à chacun la même chose ») d’une justice proportionnelle qui a pour
nom l’équité (« à chacun selon ses besoins »), d’où l’idée de discrimination positive
(donner plus à ceux qui ont moins). Possibilité d’exploiter, pour ces problèmes de
distribution/répartition, le dilemme de la famille Gustard reproduit par Galichet p.59
3° Qui décide du juste et de l’injuste ?
Prendre ici appui sur les représentations des élèves et sur la partie « Qui décide du
juste ? » des Goûters philo. A articuler avec une réflexion sur le fait que les maîtres sont aussi
soumis aux règles qui ont force de loi (à distinguer des règles de vie négociables). Exemple
des punitions injustes parce que prises sous le coup de la colère, de la vengeance ou parce que
s’affranchissant de valeurs respectueuses des droits de l’enfant (exemple de l’oubli du maillot
de bain). Ceux qui incarnent les valeurs de justice ne sont pas nécessairement justes !
4° Pourquoi être juste ?
Exemple de l’anneau de Gygès exposé par Platon, République II (légende rappelée par
Galichet). Outre la dimension utilitariste (être juste pour rendre possible la vie sociale)
pourquoi doit-on être juste moralement (idée que la justice est avant tout un idéal).
1
/
3
100%