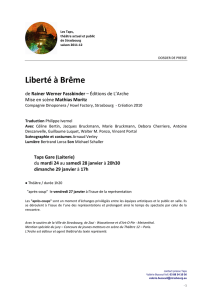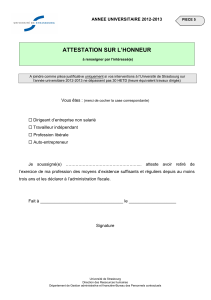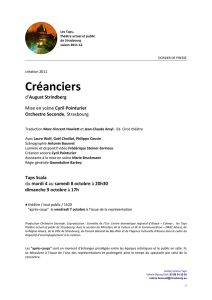Les Bâtisseurs d`Empire ou le Schmürz - Le Taps

LES BATISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMURZ
Contact presse TAPS Valérie BUSSEUIL 03 88 23 79 32 va[email protected] 1
SAISON 2012-13 / DOSSIER DE PRESSE
LES BATISSEURS
D’EMPIRE
OU LE SCHMURZ
de BORIS VIAN, Editions de l’Arche
Mise en scène PAULINE RINGEADE
Compagnie L’Imaginarium Collectif
Strasbourg, création 2012
TAPS SCALA,
DU MERCREDI 23 NOVEMBRE AU SAMEDI 1
er
DECEMBRE À 20H30
+ DIMANCHE 2 DEC. À 17H
Illustration Kathleen Rousset

LES BATISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMURZ
Contact presse TAPS Valérie BUSSEUIL 03 88 23 79 32 va[email protected] 2
Avec
JEAN-CHRISTOPHE QUENON
MARIE SEUX
CLAIRE RAPPIN
STELLA COHEN HADRIA
NILS OHLUND
JULIEN GEFFROY
Scénographie CLAIRE SCHIRCK - Lumière et Régie Générale FLORENT JACOB
Son GÉRALDINE FOUCAULT - Costumes AUDE BRETAGNE
Maquillage JUSTINE DENIS - Construction CAMILLE FAURE, FLORENT JACOB
Stagiaire scénographie ANNA JACOB - Production et diffusion LUCIE VAUTRIN
Avec le concours de PIERRE CHAUMONT de LA MACHINERIE pour la construction
et de MARC PROULX pour le travail physique.
Production L’iMaGiNaRiuM Collectif, coproduction Comédie de l’Est – Colmar.
Avec la participation artistique du Jeune Théâtre National. Avec le soutien du Ministère de la Culture et de la Communication
– DRAC Alsace, de la Ville de Strasbourg et de la Région Alsace.
LA PIÈCE
Papa, maman, leur petite Zénobie, la bonne. Un petit appartement avec bibelots et buffet
Henri II. Voilà qui ne promet guère l’aventure.
Seulement voilà : il y a le schmürz ; c’est un homme qui vit avec eux, assis dans un coin.
Son rôle ? Recevoir des coups en silence. Papa et maman s’en donnent à cœur joie ; la bonne
frappe de temps en temps, un peu à contrecœur.
Zénobie s’y refuse, cherche à entrer en contact avec lui. Rien à faire.
Il y a aussi le Bruit : la rumeur qui, de temps à autre, monte dans l’escalier. Aussitôt, la
famille effrayée déménage à l’étage au-dessus. Mais l’appartement est toujours plus petit.
Jusqu’où cela ira-t-il ?
Dans la dernière pièce de Boris Vian, on trouve à la fois les merveilles du théâtre de
l’absurde – avec les jeux sur le langage, l’alliance entre cocasse et cruauté – et une
représentation de l’oppression.
Qui est le schmürz ?
Quel est cet être à qui la société bourgeoise fait violence sans le voir ?
Dans la France de 1957-1959, et en pleine guerre d’Algérie, on ne peut s’empêcher de
penser à la figure du travailleur immigré…
Les Bâtisseurs d’empire ou Le Schmürz, Boris Vian, éd. De L’Arche.

LES BATISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMURZ
Contact presse TAPS Valérie BUSSEUIL 03 88 23 79 32 va[email protected] 3
NOTES DE PAULINE RINGEADE, METTEUR EN SCÈNE
« Cette pièce me fait penser à une banquise, à un glacier. Sur lequel on avance doucement,
car on pourrait tomber au fond du gouffre à chaque instant. Les crevasses sont là tout
autour mais on ne les voit pas avant d’être dessus. On entend le son sourd de l’eau sous la
surface qui pourrait ouvrir une nouvelle brèche à tout moment. La surface est mince, fragile,
c’est creux dessous et à la fois il y a là tout un monde - les conversations sont pour la plupart
superficielles, on fait toujours bonne figure mais surtout on ne va pas trop avant dans la
réflexion, l’introspection.
C’est dans le creux que résonnent les non-dits, le refoulé, le refus de considérer les
problèmes. La pièce parle d’une absence à soi-même. L’art de tourner autour du pot, autour
de sa propre existence.
Pour découvrir des mondes aussi splendides que les mondes souterrains ou sous-marins, il
faut oser affronter la peur, la sensation de claustrophobie que ce genre d’expérience peut
déclencher.
Je parlerais d’abord de la dimension privée, intime, celle du cercle familial. On y tient des
conversations fausses, sans écoute réelle. On y est dans des codes de comportements établis
par la société, censés permettre la cohabitation des êtres - la politesse - et qui ne font que
créer un isolement de chacun par rapport aux autres, comme s’il fallait s’en protéger.
Ainsi, tout ce dont on ne se parle pas, dont on ne peut pas se parler, est refoulé.
Face à ces codes-là, très « sociaux », apparaît dans la pièce la possibilité de l’expression
d’une extrême violence : le Schmürz.
Père (n’écoute pas). - C’est tout de même en famille qu’on est le mieux.
(Il cherche dans les paquets et trouve une cravache. Il retire son veston et commence à
cravacher le schmürz avec une sauvagerie incroyable.)
Le Schmürz est un personnage muet sur lequel on se défoule, que l’on roue de coups, lacère
avec des ciseaux dès que l’on est gêné, en colère, mal à l’aise ou contraint par les autres. Il
est finalement l’expression de ce qu’on refoule.
Ces deux pôles comportementaux si opposés nous font dériver entre cocasserie et noirceur,
toutes deux plus féroces l’une que l’autre, et si chères à Boris Vian. Elles proposent ainsi un
évènement théâtral formidable de contradictions, et absolument pas manichéen.
C’est une matière à penser qui, je crois, met le spectateur en position très active tout au
long du spectacle car on ne nous dit pas quoi penser de chacun de ces personnages, les
pistes sont brouillées. On s’attache à cette famille à la fois tout à fait banale et tout à fait
monstrueuse. Et c’est déroutant. On ne sait jamais précisément qui ils sont, quel « type » de
gens ils pourraient être, car chez Vian on ne rentre pas dans des cases. Même aux moments
où il s’amuse le plus avec les clichés et les codes sociaux.
Sait-on bien qui l’on est soi-même pour écrire ou jouer des personnages « cernables » ?
Cette espèce d’exagération des comportements appelle la dimension théâtrale, qui est très
revendiquée par le texte.
Père, à la mère. – Qu’est-ce je dis, maintenant, en principe ?

LES BATISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMURZ
Contact presse TAPS Valérie BUSSEUIL 03 88 23 79 32 va[email protected] 4
Les didascalies indiquant la prise de posture ou de « ton » de l’un ou l’autre personnage sont
extrêmement nombreuses, on a parfois la sensation qu’ils « jouent » ces tableaux très
régulièrement. Tableaux dont le texte s’improvise à chaque fois mais dont le canevas est
connu de tous. La représentation fait vraiment partie du quotidien de ces personnages. Les
parents nous rejouent par exemple leur mariage, et le père donne des titres à ses
interventions.
Père. – Si je mimais notre aventure ?
Mère. - Chéri, tu mimes si bien. Mais parle, ne te borne pas à mimer. À quoi bon te priver
d’un moyen d’expression dont tu as la maîtrise complète ?
Père. – Reconstitution. (Il commence son récit : ) On se présente un beau matin de printemps,
la ville en fête, les oriflammes en train de claquer au vent et le vacarme des véhicules à
moteur couvrant la rumeur joyeuse qui montait de cette énorme fourmilière humaine. Moi, le
cœur traversé de décharges électriques, je comptais les heures à l’aide d’un abaque chinois
légué par mon grand-oncle, celui qui avait participé au pillage du Palais d’Été à Pékin.
(il s’interrompt, réfléchit.)
Où est-il passé cet abaque ? (à la mère) Tu ne l’as pas vu récemment ?
[…]
Ils continuent à danser une sorte de ballet, mimant toute la journée du mariage.
Nous accompagnons cette famille, cloisonnée dans des espaces toujours plus petits, fuyant
un bruit venu dont ne saura jamais où.
Les gens disparaissent les uns après les autres, et il y a un homme qu’on torture au milieu de
la pièce, tout du long.
Le père lui-même fini par mourir en disant «Pardon… je ne savais pas ».
Tant de signes qui font écho pour nous à cette Histoire si proche et dont on parle encore
peu. Il y a donc la dimension politique.
Tout d’abord le contexte de l’écriture de la pièce : elle est écrite en 1957, en pleine guerre
d’Algérie, et il me semble intéressant de le mettre en lumière, ou du moins de l’évoquer
dans l’esthétique du projet, les costumes… non pas qu’il soit question de faire un spectacle
sur une famille pendant la guerre d’Algérie, - ce n’est pas le propos de la pièce et pas ce que
je souhaite explorer à travers ce projet -, mais bien d’utiliser ce qu’un tel contexte politique
peut engager d’extrême intimement et socialement pour interroger nos propres
comportements dans une France supposée moderne et en paix.
Cette pièce pose des questions anthropologiques et sociologiques. Comment l’espèce
humaine apprend de son Histoire, qu’est-ce que cette dernière modifie dans les
comportements humains ?
Et en amont, d’où vient l’absence d’hommes à eux-mêmes, d’un état à lui-même ?
Où se perd la considération de l’humain qui est à côté de soi ;
Est-ce dans cette perte que nous bâtissons nos empires, qu’ils soient individuels ou
nationaux ? Les empires individuels deviennent l’empire de toute une nation. Faut-il
affronter son propre Schmürz pour se construire en conscience ?
Les questions de la conscience et de la mémoire sont très présentes dans la pièce en tant
que vecteurs de responsabilité civique.
Pièce éminemment intime, interrogeant l’espèce humaine, et de ce fait éminemment
politique. Qui sont ces humains qui peuplent notre Terre ?

LES BATISSEURS D’EMPIRE OU LE SCHMURZ
Contact presse TAPS Valérie BUSSEUIL 03 88 23 79 32 va[email protected] 5
D’ailleurs, si ce n’était que moi, il y a longtemps que les fausses valeurs auraient disparu au
profit de ces valeurs beaucoup plus sûres que sont la morale, les idées en marche,
l’avancement des sciences physiques, l’éclairage des rues et la mise au pilon des résidus
pourris d’une démagogie toujours plus croulante, à l’instar…heu… à l’instar des grands
bâtisseurs de jadis qui fondaient leurs travaux sur le sens du devoir et de la chose commune…
Le choix de ce texte s’inscrit pour moi dans la continuité d’une recherche s’intéressant de
près aux comportements humains, et ce qu’ils traduisent, trahissent de ces mécanismes
fous dont est capable l’inconscient.
Après Hedda Gabler et Le Conte d’Hiver - où les personnages d’Hedda et Léontes, pour ne
citer qu’eux, traversent chacun des situations familiales, intimes et sociales extrêmes -
explorer les comportements de cette famille vivant dans une société proche de la nôtre, la
France au milieu du XXe, est une nouvelle étape. Ne pas « décontextualiser » le texte donc,
comme dans mes précédents spectacles, mais s’intéresser surtout à cet animal étrange et
fascinant qu’est l’humain.
Vian nous offre, dans ce texte où les personnages refusent l’analyse, refusent le fait de
s’appesantir sur un mal-être ou une situation dérangeante, un objet déroutant où l’on est
tellement dans « l’anti-analyse » que s’en devient un texte psychanalytique, comme peuvent
l’être ceux de Kafka.
BORIS VIAN, AUTEUR
Mort prématurément à l’âge de 39 ans, Boris Vian (1920-1959) aura été dans sa courte vie
ingénieur, auteur, poète, parolier, critique et musicien de jazz. Adepte du sarcasme, il laisse
une œuvre variée où s’exprime le caractère désespéré de l’existence. L’écume des jours,
J’irai cracher sur vos tombes et Le déserteur comptent parmi ses plus grands succès.
C’est en 1957 qu’il écrit sa dernière pièce de théâtre : Les Bâtisseurs d’empire ou le Schmürz,
publiée en février 1959 par le Collège de Pataphysique.
En savoir + :
www.borisvian.org/
(site officiel)
L’iMaGiNaRiuM COLLECTIF
Collectif artistique implanté à Strasbourg, L’iMaGiNariuM regroupe des gens qui se sont
rencontrés au gré de leurs formations ou de projets avec d’autres compagnies, et qui
décident aujourd’hui de donner une structure à leur envie de recherche commune et de
maintien de liens de confiance quant au regard qu’ils portent sur leurs travaux respectifs.
Ils se définissent comme « collectif » pour plusieurs raisons : il s’agit de travailler
collectivement à l’intérieur des projets mais aussi de proposer différents projets artistiques :
théâtraux bien sûr car la plupart d’entre eux sont issus du spectacle vivant, mais aussi
photographiques, plastiques, sonores...
Le collectif est pour nous un projet artistique donc politique.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%