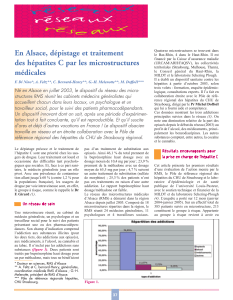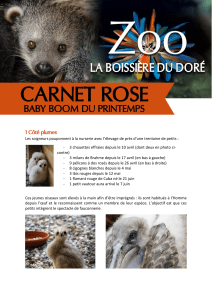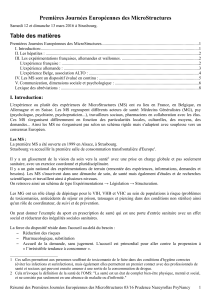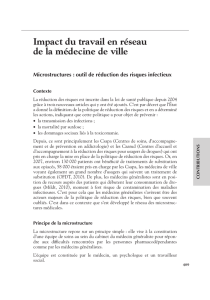Lire l`article complet

87
“Tout le monde l’appelle Hermès… Ce petit
Dieu aux pieds et au couvre-chef ailés ‘protè-
ge’ les messagers, les médecins… et (ne le
dites pas !) les voleurs !…”. Le Pr Jean-
Louis Imbs, président de l’association stras-
bourgeoise Espace Indépendance, Centre de
soins spécialisé aux toxicomanes (CSST) est
en verve. Si Espace Indépendance a initié le
projet, depuis juillet 2004, le réseau RMS a
pris son autonomie. Bien entendu, le curseur
de la roue de la fortune ne s’est pas arrêté sur
la case des voleurs, mais bien sur celle des
“agitateurs d’idées”. Des messagers d’innova-
tion à l’échelle d’une région et, demain peut-
être, de l’hexagone, voire de l’Europe.
D’ailleurs, soutenu depuis le départ par
Marie-Hélène Gillig, députée européenne
présente encore lors de cette journée, RMS a
reçu des confrères allemands et anglais, très
intéressés par l’expérience qu’il a su mener à
bien. Et, côté français, le réseau de soins Aix-
Marseille a déposé un projet de réseau de
microstructures, signe que l’innovation est
devenue “reproductible” car porteuse d’une
vraie mutation des pratiques de soins. “Les
microstructures sont la mise en œuvre d’une
nouvelle conception de la médecine. Elles
préfigurent ce que peut être l’exercice médical
au XXIesiècle”, résume le Dr George-Henri
Melenotte, président du RMS. Une innova-
tion médico-sociale d’autant plus intéressante
(et surprenante) “qu’elle s’est construite sur la
volonté de prendre en charge des patients en
situation de précarité et d’exclusion particuliè-
rement avancée”. De fait, par ses implications
de santé publique, les nouvelles façons de tra-
vailler de ce dispositif léger méritent de faire
des adeptes au-delà du Haut-Rhin et du Bas-
Rhin. En effet, son objectif est bien de réduire
la disparité existant en matière d’accès aux
soins selon que les patients habitent en milieu
urbain ou rural. Son équipe polyvalente asso-
ciant un médecin libéral à un psychologue et
un travailleur social salariés par le RMS, voire
un pharmacien d’officine, permet d’intervenir
efficacement dans l’initialisation des traite-
ments de substitution et celui des hépatites C,
servant ainsi d’interface entre la ville et l’hô-
pital.
De l’expérimentation à la péren-
nisation : une belle partie !
Retour en arrière. Sur la “case” départ de
l’expérience, en 1999, un projet, “un peu fou”
peut-être, lancé par Espace Indépendance,
CSST de Strasbourg, pionnier dans bien
d'autres domaines (unité mobile de première
ligne, mission raves, ateliers artistiques, entre-
tiens de délivrance de méthadone…).
“La mise” : déplacer dans les cabinets de
médecins généralistes du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin, tous bien évidemment volon-
taires pour cette expérience, un psycho-
logue et un travailleur social, consultant
dans des plages horaires délimitées (3 heures
par semaine), pour les patients “addicts” en
traitement “en ville”.
“La règle” : les différents acteurs de ces
microstructures, rejoints parfois par un phar-
macien d’officine (voire par des patients), se
réunissent pour “faire la synthèse” des cas
traités ; chaque cabinet prend en charge au
moins 16 patients ; chaque microstructure pré-
voit, en amont, l’évaluation de son travail par
l’utilisation des questionnaires Addiction
Severity Index, à l’entrée, à 12 et à 24 mois
(T0, T12, T24), afin de pouvoir évaluer les
résultats de cette nouvelle modalité de prise en
charge (comparaison à T0, T12 et T24 de 8
patients “vus”, classiquement, par le seul
médecin généraliste et de 8 par celui-ci et les
autres intervenants) ; cette évaluation est trai-
tée par Guy Hédelin, responsable du labora-
toire d’épidémiologie et de santé publique de
l’université Louis-Pasteur de Strasbourg.
Le “coup de dé” : après une période d’explo-
ration pour évaluer la faisabilité du projet,
l’expérience est lancée en 2000, financée
essentiellement par la MILDT et par le Fonds
d'aide de la qualité des soins de ville (FAQSV)
(géré par les Unions régionales des caisses
d'assurances maladie [URCAM]), avec le sou-
tien de la municipalité et du département.
Autour du “tapis” : outre, au départ, 18 mé-
decins généralistes, le “jeu” a réuni 14 psycho-
logues et 5 travailleurs sociaux, éducateurs ou
travailleurs sociaux, salariés pour leur part jus-
qu’en juillet 2003 par Espace Indépendance, le
généraliste restant bien sûr payé à l'acte ; 176
patients ont été suivis dans ce cadre. Depuis
janvier 2000, 3 889 entretiens psychologiques
et 3 045 sociaux ont été dispensés.
En janvier 2004, cinq mois après la fin de sa
“vie” expérimentale, le réseau des microstruc-
tures compte 24 médecins généralistes (dont 5
dans le Haut-Rhin), 12 psychologues et 5 tra-
vailleurs sociaux, répartis dans une vingtaine
de cabinets en Alsace. Depuis le 1er juillet, les
microstructures alsaciennes ont dispensé
1 136 entretiens psychologiques et 843 entre-
tiens sociaux, pour un nombre de patients pris
en charge qui a presque doublé puisqu’il est
passé à 300 !
Le “pari” : “nous comptons pouvoir réunir 25
cabinets médicaux et prendre en charge 400
voire 500 patients, d’ici 2005”, dit le président
du RMS. “Cet accroissement de notre file
active signifie bien que ce dispositif répond à
un vrai besoin et souligne la force du concept
des microstructures, qui se sont révélées
capables d’importer, hors d’une institution
(Espace Indépendance), un modèle de travail
centré autour du patient. En retour, l’institu-
tion en question a été favorablement
“contaminée” par les microstructures…”,
commente, à son tour, Danièle Ledit,
membre du comité de direction du RMS .
Depuis la pérennisation de l’expérience, les
financements viennent, en première ligne, de
Les microstructures médicales d’Alsace, dispositif innovant de suivi
sanitaire, psychologique et social pour les usagers de drogues au
cabinet du médecin généraliste, expérimentées entre 2000 et juillet
2003, ont atteint l’âge de raison. Initiées par l’association Espace
Indépendance, désormais “pérennes”, elles sont organisées aujour-
d’hui en réseau indépendant : Réseau des microstructures médicales
d’Alsace (RMS). Après trois années de travail, RMS a tenu, le 14
février dernier, la deuxième journée de bilan du dispositif.
Les microstructures médicales d’Alsace :
trois ans après
Florence Arnold-Richez
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
MAQ ADDICT 2 juin bon pour imp 1/01/04 1:25 Page 87

88
Le Courrier des addictions (6), n° 2, avril-mai-juin 2004
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
l’URCAM et de l’Agence régionale d’hospi-
talisation, en deuxième ligne, des collectivités
territoriales (la ville de Strasbourg, le conseil
général du Bas-Rhin), enfin, de la DDASS du
67 et de la MILDT pour la partie évaluation
du projet et des laboratoires Schering-Plough
et Bouchara.
Un vrai réseau de soins
ouvert sur les autres
Outre la proposition de soins diversifiés aux
patients présentant une ou plusieurs addic-
tions (y compris l’initialisation de traitements
par la méthadone, par délégation de signature
du CSST), cet Hermès-là assure également la
formation de ses intervenants (au quatrième
trimestre 2003, tous ses membres ont pu béné-
ficier d’une formation sur l’hépatite C). Il par-
ticipe à la recherche sur la clinique, mène des
enquêtes épidémiologiques (celle en cours
concerne aussi l’hépatite C), et travaille en
partenariat avec tous les autres acteurs concer-
nés : les autres réseaux de soins, les parte-
naires sociaux et institutionnels, les structures
hospitalières, celles de soins en addictologie,
les collectivités territoriales, les équipes des
maisons d’arrêt… “L’avenir et le développe-
ment des microstructures dépendent de leur
capacité à travailler dans le maillage des dis-
positifs sanitaires et sociaux : prison, CHU,
centre hospitaliers, CSST…”, dit encore le
Président de RMS. “Le médecin généraliste,
censé être doté de toutes les compétences,
n’est plus seul dans son cabinet à dispenser
des soins, mais il se rend capable de s’entou-
rer de compétences autres, de solliciter celles-
ci, pour pouvoir analyser le contexte particu-
lier de ces patients et les prendre en charge de
façon globale”.
Côté cour : “L’arrivée de thérapeutes qui ne
sont pas médecins, c’est une révolution cultu-
relle dans le cabinet médical”, dit, pour sa part
le Dr Alexandre Feltz, médecin généraliste,
coordinateur médial du RMS.
Côté jardin (ou vice-versa !) : “Le plus
important, pour le patient, c’est que le méde-
cin lui offre la possibilité de parler à d’autres
intervenants, chez lui. Cette invitation est alors
très souvent reçue favorablement. Le patient
s’en empare à sa manière et nous indique quel
espace particulier créer avec lui”, dit Pascale
Hannon, psychologue.
Et, au “centre de la pièce” : “La micro-
structure, c’est la possibilité d’avoir une
écoute. Comme on connaît les personnes, les
contacts se font plus aisément et j’ai
confiance. C’est quelque chose qui tient dans
la durée”, résume un patient.
Réseau vivant, toujours mouvant
Et de l’autre côté de “la maison” ? Au sein
du RMS, persiste encore un certain nombre
d’interrogations : travailler en utilisant le ques-
tionnaire ASI, est une procédure lourde, forte-
ment “chronophage” (une heure au minimum
par passation de questionnaire qui com-
prend 600 items !). “Il fallait vraiment être
militants !”, dit ce médecin généraliste.
“C’est le questionnaire lui-même qui devenait
un outil thérapeutique”, corrige cet autre
médecin. “Ça nous a demandé un travail très
fatigant de mémoire sur nous-mêmes, sur 20 à
30 ans de nos vies !”, rappelle ce patient. “Oui,
mais l’outil lui-même a modifié les résultats
de l’étude”, ajoute Arnaud Zeman, psycho-
logue… “Certains se sont sentis un peu remis
en cause par l’introduction de cette procédure
d’évaluation, d’autres s’en sont servis comme
d’une balise, disant aux patients : alors on se
reverra, un an après, pour faire l’inventaire du
contenu ?”, disait Danièle Ledit. Les micro-
structures, trois ans après, sont loin d’être des
prototypes, prêts à susciter la production de
modèles en série : ici, le médecin est un peu
autoritaire et ne laisse pas vraiment toute la
place qu’il devrait accorder au psychologue et
au travailleur social. Là, il impose au patient
une prise de rendez-vous à l’avance avec
ceux-ci, alors qu’ailleurs, ces consultations
sont vraiment “open”. Ici, un bureau est lais-
sé libre (voire dans la cuisine), là, le travailleur
social ou le psychologue doit transporter son
bureau dans son dos ou son coffre de voi-
ture… Bref, les plâtres essuyés, le boulot se
poursuit globalement dans la bonne humeur :
“Comme on n’est plus crispés sur la tâche de
recruter des patients susceptibles d’être inclus
dans l’étude, on respire… Et le boulot, plus
ouvert, est plus intéressant”, dit encore ce
médecin .
Et après ? “Moi je suis choqué que ce service
ne soit ouvert qu’aux patients “addicts”, alors
que des personnes âgées, des diabétiques, des
obèses, des parkinsoniens, des déprimés, en
auraient grand besoin également…”, dit cet
autre. Une réflexion partagée par bien des par-
ticipants mais dont la prise en compte se
heurte, pour le moment, aux contingences de
financements, nécessairement spécialisés.
“Pour les obtenir, il faut être clairement iden-
tifiable sur une action précise, concernant une
pathologie donnée”, objecte George-Henri
Melenotte. Et pour finir, “coup de gueule”
– attendu ! – du Dr Claude Bronner : “Je
ne trouve pas normal qu’il soit plus facile et
rapide de faire des primo-initialisations de
traitements méthadone en microstructure
qu’ailleurs !” “Oui, mais en microstructure,
on peut mener des entretiens préalables à la
mise sous traitement et on peut alors, après
consultation du CSST, par délégation de sa
signature, le commencer. En effet, en France,
c’est la qualité de la structure qui détermine la
prescription (méthadone en CSST, centres
hospitaliers ; buprénorphine haut dosage en
ville…), alors qu’il faudrait que ce soit l’état
du patient lui-même qui le justifie… En adop-
tant ce mode de fonctionnement en réseau,
nous pouvons rééquilibrer le pourcentage de
nos patients traités par l’un et l’autre de ces
médicaments de substitution (dans mon cabi-
net, ils représentent fifty-fifty)”, répondait le
Dr Alexandre Feltz. Le débat reste ouvert…
Le bon “bras” :
celui des microstructures
Pour continuer à caboter entre différents
écueils possibles, restent les résultats de l’éva-
luation qualitative, très rigoureuse, menée par
le laboratoire d’épidémiologie et de santé
publique de l’Ulp de Strasbourg. Depuis le
départ de l’expérience, celle-ci repose sur la
comparaison de deux “bras” d’un même cabi-
net, soit 349 patients à T0, mais 232 à l’arri-
vée, à T24 : l'un, “conventionnel”, englobe les
patients pris en charge par le médecin seul,
l’autre, “microstructure”, par le médecin, le
psychologue, le travailleur social. Au total,
seulement 155 dossiers ont pu être analysés,
conformément à la méthodologie très stricte
définie d’entrée de jeu.
Le principal score retenu était l’évolution des
consommations de drogues dans l’un et
l’autre “bras” (nombre de jours d’utilisation
d’héroïne, méthadone, opiacés, barbituriques,
tranquillisants, cocaïne, amphétamines, can-
nabis, hallucinogènes, polyconsommations ;
nombre de jours “à problèmes” de drogues ;
estimation par le patient lui-même de la néces-
sité d’un traitement…). Et, de ce point de vue,
les microstructures ont montré, de façon signi-
ficative, leur efficacité sur le suivi convention-
nel : les patients ainsi pris en charge, surtout
lorsqu’ils ont bénéficié d’entretiens psycholo-
giques, ont nettement diminué leurs consom-
MAQ ADDICT 2 juin bon pour imp 1/01/04 1:25 Page 88

89
mations (de 40 %). Les autres scores, com-
posites (score légal, médical, relations
sociales, emploi, psychiatrique, consom-
mation d’alcool), ont donné des résultats
beaucoup moins nets. Toutefois, le “score
relations sociales” (nombre des conflits
familiaux et autres ; préoccupations que
ceux-ci ont provoquées pour le patient ;
estimation du besoin d’aide…), détérioré
pour l’ensemble des patients, a été nette-
ment amélioré dans “le bras microstructu-
re”, sans qu’on puisse attribuer ce résultat
favorable au travailleur social ou au psy-
chologue. Quant au “score emploi”
(nombre de jours payés dans les 30 derniers
jours ; revenus liés à l’emploi y compris au
noir, deal exclu…), il s’est trouvé amélioré
également par la reprise de confiance
conférée par l’entretien avec le psycho-
logue, tout comme le “score psychia-
trique” (dépression grave dans les 30 jours,
hallucinations, anxiété, tentatives de suici-
de, sérieuses idées de suicide…).
En revanche, le suivi “microstructure” n’a
pas apporté un plus en ce qui concerne le
“score médical” (ce qui semble normal
puisque le suivi de ce point de vue est assu-
ré par un seul et même médecin dans les
deux “bras”), de même pour ce qui est du
“score alcool” et “légal” (mais peut-on
enregistrer un mieux en 24 mois de ce point
de vue, compte tenu de l’extrême lenteur de
la justice ?).
“Pour finir, il est acquis que ces modalités
de prise en charge offrent un environne-
ment favorable aux initialisations de traite-
ments méthadone en médecine de ville”,
concluait Guy Hédelin.
Les microstructures alsaciennes peuvent donc
poursuivre leur chemin, et prêter main forte
à ceux qui, en région parisienne ou en Paca
notamment, ou même en Europe, ont la
tentation, heureuse… de les copier. Or, on
parle déjà de la constitution possible d’une
fédération européenne des microstructures
médicale. Affaire à suivre… De très près.
Réseau des Microstructures médicales d’Alsace,
(RMS), 21, bd de Nancy, 67000 Strasbourg.
Tél. : 03 88 22 94 23. E-mail : [email protected].
Internet : http://www.rms.fr. Président : Dr George-
Henri Melenotte. Coordination médicale : Drs
Claudine Bernard-Henry, Alexandre Feltz.
Coordination administrative et technique : Jean-
Jacques Dietrich.
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
R
é
s
e
a
u
x
La BPCO gagne beaucoup de terrain
La bronchopneumopathie chronique obstructive
est responsable d’un taux brut de décès de 26 pour 100 000 en
France et celui-ci pourrait doubler d’ici à 2020.La BPCO pourrait donc
alors devenir la troisième cause de mortalité. Elle en est actuellement
la sixième. Objectifs prioritaires : l’arrêt du tabac encore et toujours
et aussi le développement de programmes de réhabilitation pluridis-
ciplinaires, en nombre très insuffisant en France.
L’inserm le reconnaît :
la nicotine n’est pas seule en cause !
Le Pr Robert Molimard en a fait son cheval de bataille, l’expertise de
l’Inserm, préconisant des recherches supplémentaires, “l’enfourche”
également : parmi les quelques 4 000 et plus substances contenues
dans la fumée du tabac, la nicotine a été la plus étudiée et la seule
incriminée dans l’installation de la dépendance au tabac alors qu’il fau-
drait en analyser bien d’autres. Le besoin de fumer vient, en effet,
aussi des sensations procurées (goût, arômes, chaleur…) qui ne
dépendent pas de la nicotine. Autre constat des experts : le tabac
n’est pas l’automédication du stress et de l’anxiété que l’on a trop
souvent invoquée et l’hypothèse actuellement “en cours” est celle de
la prédisposition génétique et psychologique non seulement aux
troubles dépressifs et anxieux, mais également au tabagisme.
Promouvoir la consommation faible d’alcool
Voici les principaux axes de la communication de l’INPES pour cette
année, qui utiliseront les médias traditionnels mais aussi la presse
spécialisée masculine, familiale et parentale :
•Amener les buveurs excessifs réguliers à prendre conscience de leur
abus et ainsi promouvoir la notion de consommation faible d’alcool :
dans un premier temps, il s’agit “d’interpeller” et “déstabiliser” les
buveurs excessifs réguliers afin qu’ils prennent conscience de la réa-
lité de leurs consommations. L’accent sera mis
sur les risques sanitaires, entre autres le rôle
“accélérateur” de cancers et on expliquera l’im-
portance de se connaître soi-même par des mécanismes d’auto-éva-
luation et d’atteindre une consommation faible.
•Faire évoluer les représentations masculines sur l’alcool : en utili-
sant les ressorts culturels, psychologiques, identitaires qui favorisent
l’excès, on leur expliquera que le prétendu sentiment de maîtrise de
sa consommation est illusoire.
•Prôner l’abstinence pendant la grossesse : les femmes enceintes
recevront une information sur les risques encourus par le fœtus et la
démarche globale consistera à leur prodiguer des conseils d’hygiène
de vie (tabac, alcool).
L’alcool toujours en tête des addictions
Nous comptons toujours en France 5 millions de buveurs excessifs
et 45 000 décès sont imputables chaque année à l’alcool. L’usage quo-
tidien,au cours de l’année écoulée,est le fait de 20,3 % des 15-75 ans,
l’usage hebdomadaire (au moins une fois par semaine), de 41,1%, la
consommation de verres occasionnels de 30,1 %. L’abstinence n’est,
elle, que de 7,9 % pendant la période considérée, seuls 3 % des 15-75 ans
n’ayant jamais bu une boisson alcoolique ! Ceux qui boivent tous les
jours sont plus souvent les hommes (29,2 %) que les femmes (11,7 %)
et des personnes âgées de 65 à 75 ans (64,9 % des hommes et 33,1 %
des femmes de cette tranche d’âge). C’est dans le Sud et sur la côte
Atlantique que l’on boit le plus quotidiennement. Bonne nouvelle : la
part des 20-25 ans dans cette catégorie de buveurs quotidiens n’est
que de 3 %. En revanche, à 17 ans, 55,8 % des jeunes gens et 38,2 %
des jeunes filles ont connu l’ivresse, dont 10,1 % et 2,5 % dix fois ou
plus dans l’année.
Enfin, l’usage problématique de l’alcool touche l’ensemble de la
France et affecte 14 % des hommes et 4,1% des femmes.
In :Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire 2004 ;13/23.
F.A.R.
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
B
r
è
v
e
s
MAQ ADDICT 2 juin bon pour imp 1/01/04 1:25 Page 89
1
/
3
100%