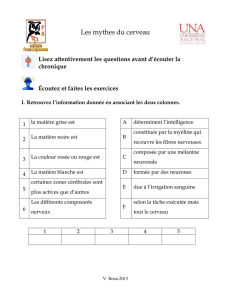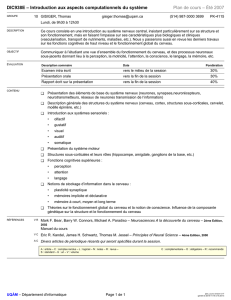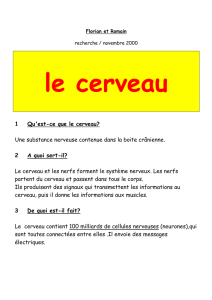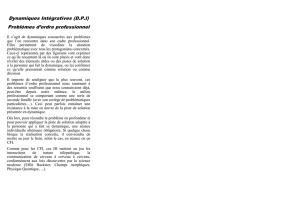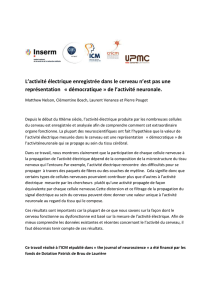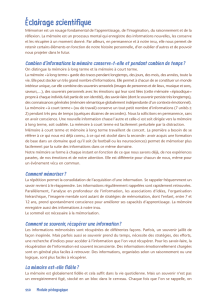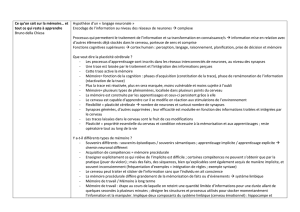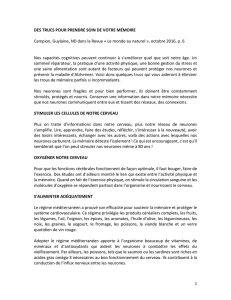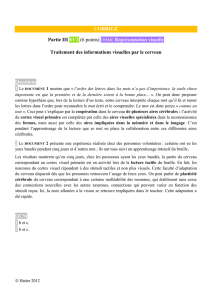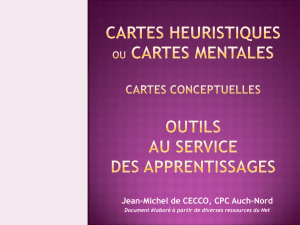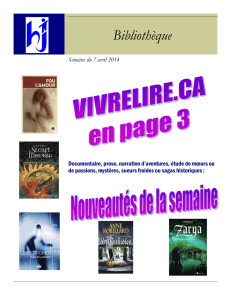La mémoire - Dessiner, organiser, intégrer ses apprentissages

La mémoire
La mémoire est l'une des fonctions les plus importantes et l'une des propriétés les
plus passionnantes du cerveau. Pascal disait déjà : "La mémoire est nécessaire a
toutes les opérations de l'esprit". Il est bien vrai qu'elle régit l'essentiel de nos
activités qu'elles soient scolaires, professionnelles, quotidiennes ou de loisirs. Elle
construit aussi bien l'identité, les connaissances, l'intelligence, la motricité et
l'affectivité de chacun de nous.
Qu'est-ce que la mémoire ?
C'est la fonction qui permet de capter, coder, conserver et restituer les stimulations et
les informations que nous percevons. Elle met en jeu aussi bien les structures
physiques que psychiques.
Il n'existe pas une, mais des mémoires. En effet, en première analyse, on peut
distinguer la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme et la mémoire à long
terme.
Quel est le rôle de ces différentes mémoires ?
La mémoire sensorielle
Extrêmement brève, elle correspond pratiquement au temps de perception d'un
stimulus par nos organes sensoriels. La mémoire sensorielle visuelle (on dit aussi
iconique) a une persistance comprise entre 300 et 500 millisecondes. La mémoire
sensorielle auditive (ou échoïque) n'est guère plus longue.
A ces stimuli visuels et auditifs, peuvent s'ajouter des perceptions captées par les
autres sens mais qui semblent jouer un rôle moins important. Ainsi en est-il de la
mémoire sensorielle tactile (mémoire haptique).
C'est la combinaison de ces différentes perceptions qui permet l'identification de
l'information.
La mémoire à court terme
Également baptisée mémoire de travail (MT), nous la sollicitons en permanence;
c'est une mémoire immédiate qui nous offre la capacité de retenir, pendant une durée
comprise entre une et quelques dizaines de secondes, jusqu'à 7 éléments
d'information en moyenne.
La mémoire à long terme
Contrairement aux précédentes qui effacent les données aussitôt après leur
traitement, la mémoire à long terme (MLT) stocke les informations pendant une
longue période et même pendant toute la vie. D'une capacité considérable, la MLT

est dépositaire de nos souvenirs, de nos apprentissages, en résumé, de notre
histoire.
"La Mémoire " (1945) par René Magritte - Huile sur toile 45 X 54 cm
.
Comment ce système est-il organisé ?
Evidemment, les informations que nous percevons ne sont pas déversées en vrac
dans une sorte de mémoire "réservoir". Elles sont organisées et régies par des
systèmes qui fonctionnent en relation permanente. On fait une distinction entre la
mémoire épisodique et la mémoire sémantique, d'une part, et entre la mémoire
procédurale et la mémoire déclarative, d'autre part.
La mémoire épisodique permet de se souvenir des événements, des noms, des
dates et des lieux qui nous sont propres. Elle est très liée au contexte affectif (par
exemple: hier, Julien, en voyant un documentaire à la télévision, a appris que "Quito"
était la capitale de l'Equateur).
La mémoire sémantique concerne les concepts, le sens des mots et des symboles
(par exemple : Julien sait, sans se souvenir où et quand il a acquis cette
connaissance, que "Paris" est la capitale de la France).
Il existe également une mémoire qui concerne la forme des mots, sa "carrosserie", sa
prononciation... c'est la mémoire lexicale (ex: "Quito" est composé de deux syllabes,
commence par la lettre "Q", se termine par une voyelle etc ... ). La mémoire
sémantique et la mémoire lexicale sont regroupées sous le terme "mémoire verbale".
La mémoire procédurale correspond au savoir-faire. Elle sert à réaliser des
opérations complexes souvent motrices (conduire une voiture, faire du vélo ... ) et
entre probablement en jeu dans l'apprentissage "par coeur".
La mémoire déclarative est celle du savoir dire. Elle permet d'évoquer de façon
consciente des souvenirs sous la forme de mots.
Existe-t-il une région anatomique, siège de la mémoire ?

On sait aujourd'hui qu'il n'existe pas de "centre de la mémoire", mais plusieurs sites
du cerveau impliqués dans le traitement et la conservation des informations.
La mémoire répond ainsi au même schéma que les autres fonctions supérieures du
cerveau (la motricité, le langage, la perception, l'intelligence...)
Pour simplifier, on peut préciser que :
- la mémoire à court terme fait intervenir le cortex* préfrontal,
- la mémoire sémantique met en jeu le néocortex,
- les corps striés* et le cervelet* sont très impliqués dans la mémoire procédurale,
- la mémoire déclarative intéresse l'hippocampe*,
- l'hippocampe est également sollicité par la mémoire épisodique (en même temps
que le thalamus* et le cortex préfrontal).
Les neurobiologistes s'accordent pour conférer à l'hippocampe un rôle essentiel.
Situé au coeur du cerveau, il assure la mise en relation des informations stockées en
différentes zones cérébrales. Son intervention est nécessaire pour faire passer les
souvenirs de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme.
*Voir lexique ci-dessous
Quel est le support de la mémoire ?
Un souvenir est stocké dans un réseau de plusieurs milliers ou millions de neurones*
connectés les uns aux autres.
Sur le plan chimique, les neurones communiquent entre eux ou avec des cellules
spécialisées (musculaires, hormonales ... ) par le biais de molécules appelées
neurotransmetteurs ou neuromédiateurs*, Dans le cas de la mémoire, c'est
l'acétylcholine* qui joue un rôle essentiel. Son déficit est à l'origine de troubles
mnésiques ; c'est d'ailleurs l'une des causes de la maladie d'Alzheimer.
*Voir lexique ci-dessous
"NEURO-LEXIQUE"
(D'après "La mémoire du cerveau à l'école"
A. Lieury - Editions Flammarion)
Acétylcholine : neurotransmetteur essentiel qui assure notamment la "commande"
des muscles. Son déficit est une des causes de la maladie d'Alzheimer.
Corps striés : ensemble de systèmes sous-corticaux qui, avec le cervelet,
commandent notre vie motrice.
Cortex : écorce enveloppant le cerveau et composée de myriades de neurones. Le
cortex humain est si grand qu'il forme des plis, les circonvolutions, et des "canyons",
les scissures, qui permettent de cartographier le cerveau.
Hippocampe : structure du cerveau basal dont la destruction provoque l'incapacité
quasi totale de mémoriser des informations nouvelles (mots, visages, images).
Neuromédiateur : substance chimique permettant à l'information de passer d'un
neurone à l'autre.
Neurone : cellule spécialisée ayant des prolongements d'entrée (les dendrites) et de
sortie (l'axone) qui permettent de communiquer à distance avec d'autres neurones ou
cellules.

Thalamus : ensemble de systèmes sous-corticaux qui traitent de façon élémentaire
les perceptions (brillance, couleur, etc ... ) avant leur traitement au niveau du cortex
pour plus d'élaboration.
La mémoire a-t-elle des limites ?
Si les mémoires sensorielles et à court terme ont des capacités limitées au traitement
de l'information, la mémoire à long terme possède de prodigieuses facultés de
conservation.
Il nous arrive pourtant d'avoir des défaillances et d'oublier, sans pour autant que nous
ayons à nous alarmer. L'oubli n'est pas un phénomène anormal. Alfred Jarry écrivait
même : "L'oubli est la condition indispensable de la mémoire".
Quand l'oubli se manifeste-t-il ?
L'oubli intervient parce que notre cerveau est organisé pour éliminer tout ce qui
pourrait l'encombrer inutilement ou lorsque l'information n'a pas subi le traitement
approprié. Le processus d'organisation est essentiel dans le travail et le succès du
rappel : les chances de retrouver un souvenir, dans l'immense bibliothèque qu'est la
mémoire sémantique, dépendent de la qualité avec laquelle on a étiqueté ce
souvenir.
Beaucoup d'oublis ont également une cause affective. Les psychanalystes montrent
bien que l'oubli est souvent associé à des événements ou des intentions associés à
des affects désagréables ou porteurs de stress.
Quels sont les maladies de la mémoire ?
Les troubles de la mémoire se caractérisent principalement par les amnésies. Des
pathologies moins fréquentes sont observées sous le titre de paramnésie et
hypermnésie.
Les amnésies
Certaines sont dues à des lésions cérébrales : les amnésies neurologiques; d'autres
ont des causes psychologiques : les amnésies psychiatriques.
Selon les cas, la forme de l'amnésie varie. On distingue :
- l'amnésie antérograde
ou amnésie de fixation. Le malade ne peut plus acquérir de
nouvelles données, mais les souvenirs anciens sont préservés. Ce type d'amnésie
se rencontre notamment chez les alcooliques chroniques (syndrome de Korsakoff),
- l'amnésie rétrograde
empêche le patient d'évoquer des souvenirs antérieurs à sa
maladie,
- l'amnésie lacunaire
est une perte de mémoire se rapportant à une période bien
déterminée (période d'une perte de conscience, d'une crise d'épilepsie, d'un épisode
psychiatrique ... ),
- l'amnésie globale
qui touche aussi bien les faits récents et anciens et qui se
rencontre dans les démences.
La paramnésie

C'est l'illusion du déjà vu ou du déjà vécu.
Isolé et en dehors d'un tableau clinique psychotique (schizophrénie), il s'agit d'un
défaut d'interprétation, d'un trouble de la perception parfois lié à la fatigue.
L'hypermnésie
Elle est évoquée dans les cas de troubles psychiatriques où les souvenirs du patient
occupent une place obsédante, exagérée et même invraisemblable.
MESUREZ VOTRE MÉMOIRE IMMÉDIATE
Voici une liste de chiffres. Lisez-les lentement à haute voix. Après chaque séquence,
fermez les yeux et essayez de les répéter dans le même ordre.
Vérifiez que la séquence est correcte. Si elle l'est, vous pouvez passer à la séquence
suivante. Si elle est incorrecte, essayez la deuxième séquence de même longueur
jusqu'à ce que les deux séquences soient correctes. L"'empan" correspond à la
dernière liste répétée sans erreur.
Source : "Vivre avec sa mémoire" Christian Derouesné - Editions du Rocher, 1996
Qu'est-ce que la maladie d'Alzheimer ?
De plus en plus fréquente chez les sujets âgés (après 45 ans, mais surtout après 65
ans), la maladie d'Alzheimer affecte le cerveau.
Elle se manifeste par une perte de la mémoire à court terme, une confusion mentale
et, finalement, par une détérioration physique et intellectuelle totale.
Malgré des recherches intensives, la cause précise de cette affectation reste
inconnue et on ne sait pas encore la soigner.
D'autres maladies dégénératives, moins répandues touchent le cerveau et
s'attaquent aux facultés intellectuelles (syndrome de Pick, Chorée de Huntington,
Maladie de Steel-Richardson, syndrome amnésique).
En quoi le vieillissement perturbe-t-il la mémoire ?
On a longtemps cru que la perte progressive des neurones expliquait, à elle seule,
les difficultés mnésiques des personnes âgées.
A présent, on sait que notre capital de neurones est tellement important et sous
employé que nous pouvons aller au terme de notre existence avec des potentialités
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
1
/
73
100%