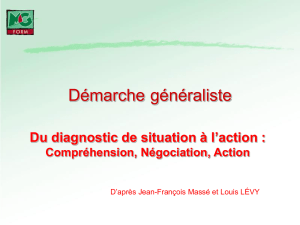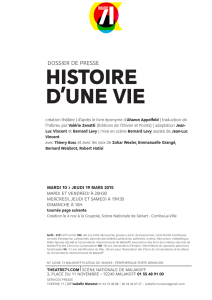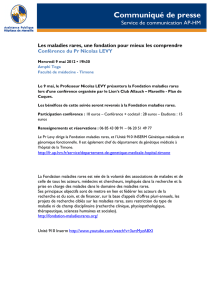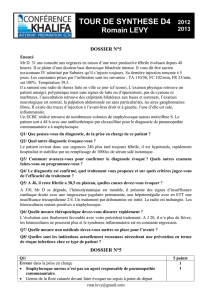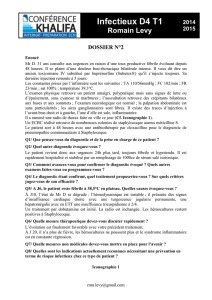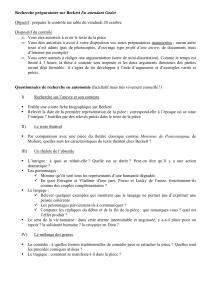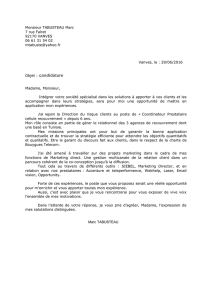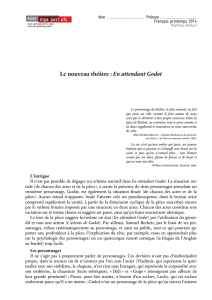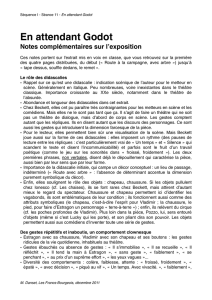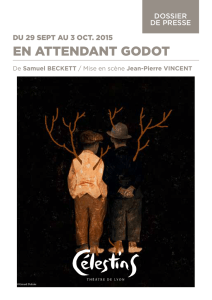dossier pedagogique

DOSSIER PÉDAGOGIQUE
HISTOIRE
D’UNE VIE
création théâtre | texte Aharon Appelfeld | traduction Valérie Zenatti (Éd.
de l’Olivier) | mise en scène Bernard Levy
MARDI 10 › JEUDI 19 MARS 2015
MARDI ET VENDREDI À 20H30,
MERCREDI, JEUDI ET SAMEDI À 19H30
DIMANCHE À 16H
THEATRE71.COM SCÈNE NATIONALE DE MALAKOFF
3, PLACE DU 11 NOVEMBRE – 92240 MALAKOFF 01 55 48 91 00
SERVICE RELATIONS PUBLIQUES rp@theatre71.com
Béatrice Gicquel 01 55 48 91 06 | Solange Comiti 01 55 48 91 12 | Émilie Mertuk 01 55 48 91 03
M° LIGNE 13 MALAKOFF-PLATEAU DE VANVES - PÉRIPHÉRIQUE PORTE BRANCION

SOMMAIRE
› Générique page 1
› Une quête universelle page 2
› Le passé, même le plus dur, n’est pas une tare ou une honte,
mais une mine de vie page 3
› Regards sur Aharon Appelfeld page 4
› L’équipe artistique page 5
› Extraits page 6
› Pour aller plus loin page 8

HISTOIRE D’UNE VIE
l’équipe artistique
création théâtre | texte Aharon Appelfeld | traduction Valérie Zenatti (Éd. de l’Olivier) | mise en
scène Bernard Levy assisté de Jean-Luc Vincent
avec Thierry Bosc
adaptation Jean-Luc Vincent et Bernard Levy | scénographie GIulio Lichtner | lumières Christian
Pinaud | costumes Séverine Thiébault | son Xavier Jacquot | vidéo Romain Vuillet
durée env. 1h10
âge conseillé à partir de 16 ans
production déléguée Scène Nationale de Sénart | coproduction Compagnie Lire aux éclats, MC2:
Grenoble, L’Espace des arts Scène Nationale de Chalon-sur-Saône, Scène Nationale d’Albi, La
Passerelle Scène Nationale de Saint-Brieuc, Scène Nationale de Sénart | La Compagnie Lire aux
éclats est subventionnée par la DRAC Île-de-France
1

UNE QUÊTE UNIVERSELLE
Ce sont différents lieux de vie qui se sont enchaînés les uns aux autres dans la mémoire, et
convulsent encore. Une grande part est perdue, une autre a été dévorée par l’oubli. Ce qui
restait semblait n’être rien, sur le moment, et pourtant, fragment après fragment, j’ai senti
que ce n’étaient pas seulement les années qui les unissaient, mais aussi une forme de sens.
J’ai découvert l’ œuvre d’Aharon Appelfeld il y a plus de dix ans. La complexité de son
univers fictionnel, la simplicité de sa langue et la sensibilité de ses interrogations me
touchent à chaque nouveau livre que je lis. En 2004, paraissait
Histoire d’une vie
(Prix Médi-
cis étranger), son premier livre explicitement autobiographique. Je fus frappé par la force du
combat qu’il y décrit : son combat pour devenir écrivain en acceptant ce qu’il est et d’où il
vient. C’est ce parcours que je désire aujourd’hui mettre sur scène. Je ressens une proximité
unique avec cet écrivain. Ce qu’il écrit fait sans doute écho à ma propre vie, non dans les
faits bien sûr, mais dans cette volonté farouche de s’arracher à tout déterminisme en
écrivant sa propre histoire. Lui par la littérature, moi par le théâtre. Le parcours d’Aharon
Appelfeld est unique : orphelin à 8 ans, il va s’échapper d’un camp ukrainien et errer seul
dans les forêts jusqu’à la fin de la guerre. À 13 ans, il débarque en Israël. Commence alors la
lente et douloureuse prise de conscience de sa vocation littéraire. Il est aujourd’hui l’un des
plus grands écrivains
israéliens vivants. Il a 80 ans et vit à Jérusalem. Cette trajectoire est pour moi celle d’un
véritable héros.
Histoire d’une vie
, c’est le récit à la première personne d’une lutte. Une lutte
pour reconstituer sa mémoire, pour accepter de trouver le silence qui l’a entouré pendant la
guerre et le faire revenir vers lui, car « dans ce silence était cachée mon âme ». Une lutte
pour ne pas perdre sa langue maternelle tout en acceptant d’en faire sienne une autre,
l’hébreu. Un combat permanent entre le présent, celui de l’homme nouveau israélien, et le
passé, celui de l’enfant juif rescapé des camps. L’écriture est simple, économe. Elle mêle
fragments de mémoire et réflexions sur la langue, la mémoire et l’identité, avec une grande
finesse et une grande émotion. J’ai le sentiment que le théâtre peut naître de cette parole,
de ce drame constitué par la lutte d’un homme pour devenir lui-même. À travers la voix d’un
acteur, la musique, si présente dans l’ œuvre d’Appelfeld, le mélange des sons et des lan-
gues, on pourra faire entendre et amplifier cette écriture unique et donner à voir le combat
d’un homme traversé par des forces contradictoires. Paradoxalement, du récit d’une vie si
singulière se dégage l’universalité de la quête menée par tout homme : la quête d’une his-
toire individuelle et personnelle que l’on construit à la fois avec et contre les déterminismes
historiques et culturels.
Bernard Levy, Jean-Luc Vincent
2

LE PASSÉ, MÊME LE PLUS DUR, N’EST PAS UNE
TARE OU UNE HONTE MAIS UNE MINE DE VIE
Aharon Appelfeld est né en 1932 à Czernowitz en Bucovine (alors rattachée à la Roumanie). Ses
parents, des juifs assimilés influents, parlaient l’allemand, le ruthène, le français et le roumain. La
spiritualité simple de ses grands-parents, paysans, le marque à jamais. Il se souvient des villégiatures
pastorales et des vacances d’été dans les Carpates, et évolue dans un véritable bain langagier :
l’allemand, sa langue maternelle, le yiddish de ses grand-parents, le ruthène de cette Bucovine où il
grandit, le roumain imposé par le gouvernement, plus tard l’ukrainien, un peu de russe, d’autres
dialectes encore glanés ici et là. « Ma tête bourdonnait de langues, mais à la vérité je n’en avais pas
une à moi. ».
Quand la guerre éclate, sa famille est envoyée dans un ghetto. En 1940 sa mère est tuée, son père et
lui sont séparés et déportés. À l’automne 1942, Aharon Appelfeld s’évade du camp de Transnistrie. Il a
dix ans et se réfugie durant trois années dans les forêts ukrainiennes, trompant la vigilance
antisémite (« Heureusement pour moi j’étais blond. ») et souffrant la brutalité obtuse des paysans
qui l’exploitent il travaille. « Des années aveugles pour les enfants. »
En 1944, il est finalement libéré par l’Armée Rouge, pour laquelle il fait le coursier, puis vagabonde
avec un groupe d’adolescents orphelins, jusqu’en 1946, dans toute l’Europe, notamment les côtes
italiennes, royaume du marché noir, mais aussi, enfin, de l’air et de l’eau. Grâce à une association
juive, il embarque clandestinement pour la Palestine où il arrive en 1946. Sur les plages de Tel-Aviv, il
est parqué par les Anglais dans le camp d’Atlit. Le jour, il travaille dans les kibboutzim, les camps de
jeunesse, les écoles agricoles, la nuit, il se soumet à la rude discipline de l’hébreu, de la Bible, des
poèmes de Bialik. Il arpente ce pays fébrile où chacun tente de renaître comme Juif : « À tous les
coins de rue, des haut-parleurs tonnaient : « Plus jamais comme des moutons à l’abattoir ». Je
désirais très fort trouver ma place dans cet élan grandiose, prendre part à l’aventure qu’est la
naissance d’une nation. » Les années de service militaire, de 1950 à 1952, Hatzerim, furent des
années de solitude et de désolation. Il se réfugie dans son journal.
De 1952 à 1956, Appelfeld étudie à l’Université hébraïque, où enseignent notamment Martin Buber
ou Gershom Scholem. Il s’initie à Kafka et Camus, aux classiques hassidiques, à la littérature
hébraïque. Il est l’élève de Dov Sadan, Ernest Simon, Yehezkiel Kaufman, ou du poète yiddishisant
Leib Ruchman, et se rapproche d’Agnon, futur prix Nobel de littérature. Il enseigne à son tour. À la fin
des années 1950, il décide de se tourner vers la littérature et se met à écrire, en hébreu, sa « langue
maternelle adoptive ».
Son premier livre,
Fumée
, reçut en 1962 un accueil critique favorable : « Appelfeld n’écrit pas sur la
Shoah mais sur les marges de la Shoah. Il n’est pas sentimental, il est tout en retenue. ». Et quand
parut son court roman
Comme la pupille de l’œil
, Gershom Scholem en personne lui dit : « Appelfeld,
tu es un écrivain. ».
À la fin des années 1980, Philip Roth découvre son œuvre avec émerveillement et fait de lui l’un des
personnages de son roman,
Opération Shylock
. Un demi-siècle plus tard, Aharon Appelfeld est
devenu l’un des plus grands écrivains juifs de notre temps. Il vit aujourd’hui près de Jérusalem, avec
sa femme et ses trois enfants. « Les gens de ma génération ont très peu parlé à leurs enfants de leur
maison, et de ce qui leur était advenu pendant la guerre. L’histoire de leur vie leur a été arrachée
sans cicatriser. Ils n’ont pas su ouvrir la porte qui menait à la part obscure de leur vie, et c’est ainsi
que la barrière entre eux et leurs descendants s’est érigée. » À ce jour, ila publié une trentaine de
livres, principalement des recueils de nouvelles et des romans. Il a reçu le prix Médicis étranger en
2004 pour
Histoire d’une vie
et le prix Nelly-Sachs en 2005 pour l’ensemble de son œuvre. 3
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%