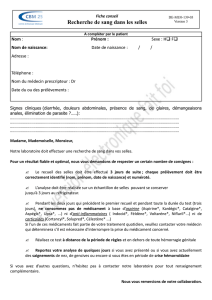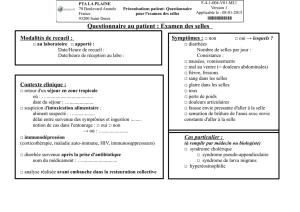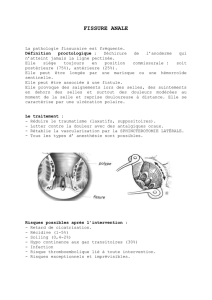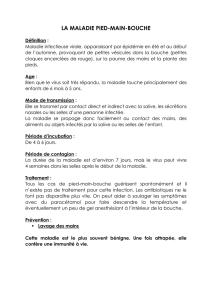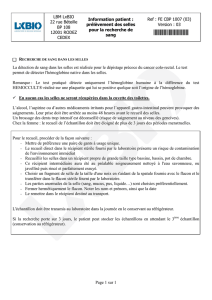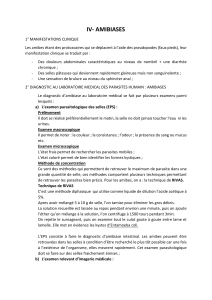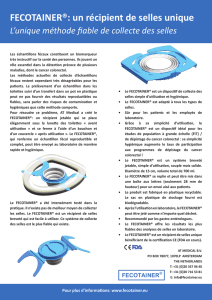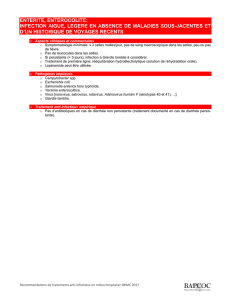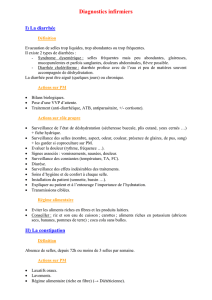Voir/Ouvrir

1
INTRODUCTION
Les parasitoses intestinales touchent surtout l’enfant et exposent ce dernier
à une morbidité et une mortalité très élevées. Le diagnostic de ces parasitoses
exige donc un examen parasitologique des selles bien codifié aussi bien sur le
plan technique que sur le choix de la méthodologie appliquée.
Selon la nomenclature des actes de biologie médicale, un examen
parasitologique des selles doit comprendre un examen direct plus deux
techniques d’enrichissement, une standard concentrant toutes les formes
parasitaires (forme végétative ; kyste ; œuf et larve) et l’autre spécifique pour la
concentration des œufs. Le recours à d’autres techniques de concentrations
comme celles utilisées en cas des ankylostomose ne sera justifié que par la
présence des signes cliniques et épidémiologiques évoquant ce type de
parasitose.
Le but de ce travail, est de réaliser une étude prospective dans le domaine
du diagnostic des parasites intestinaux chez l’enfant hospitalisé à l’hôpital
d’enfants de Rabat et de comparer les différentes techniques d’enrichissement
ayant servi pour ce type de diagnostic afin de tirer des conclusions qu’en au
choix de la technique la plus rentable et la plus efficace.

2
HISTORIQUE [1]
La véritable révolution de la coprologie parasitaire est sans doute liée à la
construction du premier microscope par le naturaliste hollandais
LEUWENHOEK. Ainsi, et parallèlement aux progrès acquis dans le domaine de
la microbiologie, la coprologie se développa par la découverte successive des
différents œufs et kystes de parasites.
C’est sous l’impulsion de grands cliniciens, comme à Paris, LETULLE et à
Lyon, GARIN, que l’examen des selles devient enfin une pratique courante.
Seul l’examen direct était alors pratiqué. Les possibilités très limitées de ce
procédé firent rapidement recherche des techniques de meilleure efficacité.
Le but était de rassembler sous la lamelle, le plus grand nombre de
parasites possible tout en la débarrassant des résidus alimentaires non digérés.
L’idée de l’enrichissement était alors née.
La première technique qui apparut a été mise en œuvre en Amérique par
STILLES, elle ne constituait en fait qu’une application particulière des
techniques de concentration jusqu’alors utilisées en micrographie générale.
La multiplicité des techniques apparues dans les années suivantes et sans
doute liée aux programmes de lutte contre l’Ankylostomiase entrepris à ce
moment au sud de l’Union sous l’égide de la fondation Rockefeller.
En Europe, la première publication revient à TELEMANN en 1908. Sa
méthode consistait à triturer la selle avec un mélange à volumes égaux d’acide
chlorhydrique et d’éther puis à centrifuger l’emulsion.Originale par son
mécanisme, cette méthode a néanmoins été l’objet de nombreuses critiques.

3
Les nombreuses techniques apparues dans les années suivantes se sont
données pour objectif de pallier aux nombreux inconvénients de l’acide
chlorhydrique :
-MIYAGAWA en 1913 : usage de Hcl à 50%.
-LANGERON en 1925 : usage de Hcl à 50%.
-ROBIN en 1925 : Hcl à 25%.
-LOUGHLIN et STOLL en 1916 : Hcl à 25%.
-CARLES et BARTHELEMY en 1916 : acide citrique à 12%.
-RODENHUIS en 1921 : acide acétique à 6,6%.
-DERIVAS en 1928 : acide acétique à 5%.
-THEBAULT en 1930 : acide trichloracétique à 1%.
Les années suivantes ont vu la naissance de nombreuses autres techniques
qui sont, pour la plupart, dérivées de la fameuse méthode de TELEMANN.
Ces dernières décennies, on a assisté à une tendance nouvelle avec les
travaux de MANSOER et LARMANN (1959), de RITCHIE et collaborateurs
(1960), qui essayent de dégager l’influence d’un certain nombre de facteurs sur
la concentration parasitaire.
En 1962, BAILENGER émet la théorie diphasique. Il énonce : le principe
responsable de la concentration parasitaire réalisée par la méthode de
TELEMANN et par celles qui en dérivent, réside dans la mise en présence de
deux phases non miscibles, l’une aqueuse, l’autre éthérée qui permettent la
réalisation d’un coefficient de partage dont la valeur est conditionnée pour
chaque élément fécal par sa balance hydrophile-lipophile.

4
PREMIERE PARTIE :
RAPPEL DE LA PHYSIOLOGIE DE LA
DIGESTION

5
INTRODUCTION :
Pour bien interpréter un examen macro ou microscopique des selles, il faut
comprendre les mécanismes complexes de la digestion qui permettent l’équilibre
du milieu intestinal.
Il est aussi nécessaire de bien intégrer la notion que l’intérieur du tube
digestif est en continuité avec le milieu extérieur et que, par conséquent,la
muqueuse digestive est en continuité avec la peau et sert,comme la peau,de lieu
d’échanges entre l’organisme et le monde qui nous entoure.
Ainsi donc un parasito-coprologiste devra exercer son métier en ayant
suffisamment de notions médico-physiologiques pour réorienter éventuellement
le malade qui lui aura été confié vers d’autres explorations cliniques.
I- DIGESTION ET ABSORPTION DES GLUCIDES [2] :
Les glucides représentent environ 50 % de la ration calorique quotidienne
de l’adulte (200 à 300 g/j), essentiellement sous forme d’amidon (55 à 65 %) et
de saccharose (20 à 30 %), auxquels s’ajoutent d’autres disaccharides (lactose,
maltose) et des quantités faibles de monosaccharides (fructose, glucose).
L’amidon et les disaccharides peuvent être hydrolysés dans l’intestin grêle et
absorbés ensuite par l’entérocyte sous forme de monosaccharides. D’autres
structures glucidiques, présentes dans les produits végétaux, telles que la
cellulose (polymère de glucose avec liaisons b1-4), les hémicelluloses
(arabinose, xylose, mannose), les matières pectiques (polymère d’acide
galacturonique), ne peuvent pas être hydrolysées dans l’intestin grêle et sont
dégradées dans le côlon par des enzymes de la flore bactérienne.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
1
/
130
100%