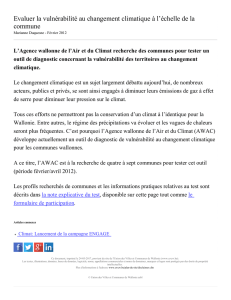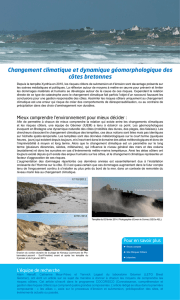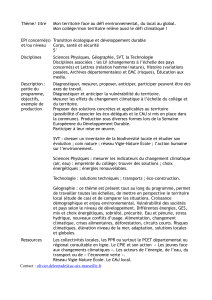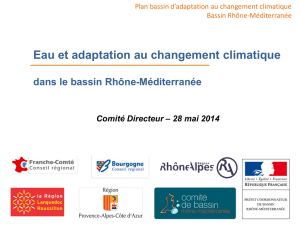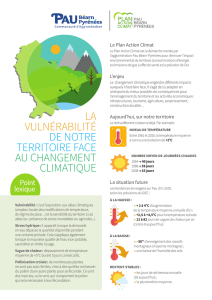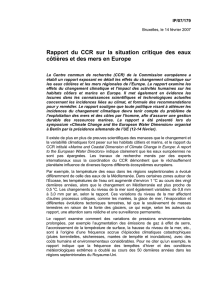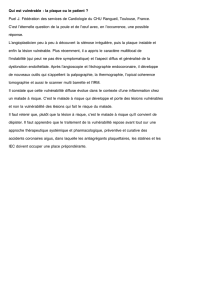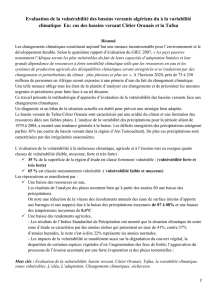zones côtières

ZONES CÔTIÈRES
LES NOTES
DU PLAN BLEU
#28
Edition Révisée
NOVEMBRE 2016
Dynamiques de territoires
Construisons ensemble l’avenir de la Méditerranée
Les communautés côtières et
les principaux secteurs socio-
économiques en danger en raison
des changements climatiques
Observations et projections
Des changements physiques dans le climat méditerranéen
ont été largement observés et ces tendances devraient
se poursuivre dans le futur. Les changements importants
sont liés à une hausse exceptionnelle de la température
atmosphérique par rapport à la moyenne européenne
et mondiale de l’ordre de 2 à 6,5 °C d’ici la n du siècle
[Travers et al., 2010]. Cette hausse devrait s’accompagner
d’une baisse particulièrement importante de la moyenne
annuelle des précipitations, surtout en été, et d’une hausse
du taux d’évaporation. Une augmentation de 7 à 12 cm du
niveau général de la mer Méditerranée, par rapport aux
décennies précédentes, est prévue d’ici 2050 [Gualdi et al.,
2013] et des hausses plus importantes sont prévues sur les
côtes est et sud de la Méditerranée.
Les dangers liés aux changements climatiques vont de pair
avec des processus socio-économiques existants associés à
l’exposition et à la vulnérabilité bio- géographique croissante
dans les zones côtières de la région méditerranéenne.
L’un des principaux impacts du changement climatique
concerne les ressources en eau, dont les usages sont
présents dans tous les principaux secteurs socio-
économiques. Des situations de pénurie d’eau combinées
avec les phénomènes liés au changement climatique
projetés réduiront à leur minimum le ruissellement et
la recharge des nappes phréatiques. Par conséquent la
qualité et le volume d’eau seront également réduits dans
certains pays. Une baisse du niveau des précipitations et
une hausse des températures dans le sud et l’est de la
Méditerranée vont amplier l’aridité, la dégradation des
sols et la désertication.
OUTILS DE GESTION DES RISQUES CLIMATIQUES
Bientôt un indice des risques
côtiers en Méditerranée
La région méditerranéenne est un « hot spot » climatique. Pour étudier le rôle des facteurs climatiques
et non climatiques sur les zones côtières, il est essentiel de comprendre les risques sous-jacents et
d’identier les mesures d’intervention appropriées. Les incertitudes scientiques existantes exigent
une certaine exibilité lors de la planication pour l’adaptation aux changements induits par le climat
ou non. L’élaboration d’une méthode pour évaluer les vulnérabilités actuelles et futures et les risques
de catastrophes touchant les côtes reste complexe pour les chercheurs et les décideurs. Un indice
multi-échelle des risques côtiers présente alors plusieurs avantages qui rendent cette méthodologie
particulièrement adaptée pour aider à la prise de décisions en dépit des ressources et des données locales
limitées, ainsi que des informations incertaines concernant l’avenir. Cet indice apporte des informations
complémentaires aux services climatologiques (Voir Notes du Plan Bleu 27).

ZONES CÔTIÈRES
Dynamiques de territoires
La hausse du niveau de la mer et les inondations causées par les
tempêtes rendront les activités des zones basses du littoral et
des zones côtières en général de plus en plus vulnérables à la
submersion marine et les plages seront vulnérables à l’érosion. Ces
changements impliquent également la perte d’habitats côtiers et
marins et représentent une menace pour les écosystèmes.
Le besoin d’une adaptation et d’une action
coordonnée de GIZC pour faire face au changement
climatique
Les effets du changement climatique représentent un danger
pour les communautés et les biens côtiers. Les autorités en
charge sont encouragées à prendre des mesures d’adaptation
en ligne avec le protocole de GIZC (gestion intégrée des
zones côtières) de la Convention pour la Protection de la Mer
Méditerranée contre la Pollution (convention de Barcelone)
et des stratégies nationales de GIZC. Dans cette optique, le
PNUE/Plan d’Action pour la Méditerranée a développé un
Cadre Régional d’Adaptation aux Changements Climatiques
pour la mer et les côtes méditerranéennes qui vise à assurer
le renforcement de la coordination régionale sur ce thème.
Ainsi, les parties prenantes et les décideurs bénécieront d’une
assistance à tous les niveaux concernant la Méditerranée pour
prendre des mesures an de renforcer la résilience des systèmes
côtiers naturels et des systèmes socio-économiques aux impacts
des changements climatiques. Les scientiques et les praticiens
recommandent que la détermination des mesures d’adaptation
soit faite ad hoc en se basant sur l’évaluation des conditions
locales des impacts et des risques (ou de la vulnérabilité) et
sur l’analyse coût-bénéce des options d’adaptation choisies.
Les inventaires consolidés des mesures d’adaptation possibles,
tout comme les mesures consultables sur la Plateforme
méditerranéenne intégrée d’information sur le climat (MedICIP)
et sur le portail européen Climate-ADAPT sont des outils pour
l’adaptation qui participent à l’élaboration de réponses ad hoc.
La méthode de l’indice multi-échelle des
risques côtiers se base sur l’approche
du GIEC centrée sur le «risque »
Dans son 5ème rapport d’évaluation, le Groupe de travail
II du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat) a introduit des éléments nouveaux
à l’égard de l’approche adoptée pour soutenir la prise
de décisions dans le contexte du changement climatique.
L’accent est désormais mis sur le risque alors que le concept
de vulnérabilité est perçu comme un facteur y contribuant
(Fig. 1). Ici, le risque des effets induits par le climat résulte de
l’interaction des dangers liés au climat avec la vulnérabilité et
l’exposition des systèmes humains et naturels. Les dangers
sont des événements et des tendances dangereuses liés
aussi à la variabilité et au changement climatique naturels. La
vulnérabilité et l’exposition sont les résultats de trajectoires
socio-économiques et d’aspects sociétaux, y compris les
mesures d’adaptation et d’atténuation. Les changements dans
le système climatique et dans les processus socio-économiques
sont les moteurs essentiels des différents composants
(vulnérabilité, exposition et dangers) qui constituent un risque.
Selon le GIEC, les risques sont la « clé » lorsque les sociétés
et les systèmes exposés sont touchés par un grand danger ou
caractérisés par une grande vulnérabilité, voire les deux [IPCC,
2014].
L’indice de risque spatial qui regroupe
plusieurs couches de données
représente divers aspects de risques
pour reconnaître les « hot spots » côtiers
Un indice multi-échelle de risque côtier a été développé sur la
base de l’indice multi-échelle de vulnérabilité [McLaughlin and
Cooper, 2010] en intégrant l’approche révisée du GIEC et en
se basant sur les risques. L’indice de risques côtiers utilisé pour
évaluer le risque lié à la variabilité climatique et au changement
climatique à l’échelle régionale dans la zone méditerranéenne
est appelé CRI-MED [Satta et al., 2015].
Figure 1: Concept de base à propos du risque (GIEC AR5)
Le CRI-MED se compose de trois sous-indices :
1. le forçage côtier : il caractérise les variables liées aux dangers
climatiques (tempêtes, sécheresse, hausse du niveau de
la mer) et au forçage non climatique (croissance de la
population, arrivée du tourisme) ;
2. la vulnérabilité côtière : elle intègre les variables de résilience
(âge de la population, niveau d’éducation) et la variabilité de
la vulnérabilité côtière (forme du relief, altitude) ;
3. l’exposition côtière : elle décrit les cibles de la côte
potentiellement à risque (couver ture terrestre, densité de
population).
Les variables choisies contribuent de manière différente aux
risques qui affectent les zones côtières méditerranéennes et
doivent être pondérées en conséquence pour le calcul précis
du CRI-MED. Comme base de cette étude, il est considéré que
la hausse du niveau de la mer, l’activité des tempêtes ainsi que
le relief ou l’altitude des côtes jouent le rôle le plus important
dans la détermination des risques côtiers.
Une méthodologie permettant une
analyse comparative des régions
côtières
La méthode CRI-MED a été initialement appliquée pour mesurer
les risques dans 11 pays dans le cadre du projet ClimVar et GIZC
« Intégration de la variabilité et du changement climatique dans
les stratégies nationales pour mettre en œuvre le protocole
GIZC en Méditerranée », et a été étendue aux autres pays
méditerranéens. La mise en œuvre a donné lieu à un classement
du risque relatif de chaque région côtière par rapport aux
risques côtiers potentiels générés et/ou accentués par le forçage
climatique ou non climatique.
Source : GIEC, 2014

ZONES CÔTIÈRES
Dynamiques de territoires
Dans l’étude du CRI-MED [Satta et al., 2015], l’équation des
risques et les variables pondérées ont été appliquées à chaque
cellule (300 m X 300 m) de la grille de la zone d’étude côtière.
Les sites côtiers à risque ont été identiés grâce à une analyse
statistique en regroupant les cellules caractérisées par des
valeurs de risque similaires. Pour être considéré comme un
«hot spot » statistiquement signicatif, un site (cellule) doit
être caractérisé par la valeur « risque élevé » et doit également
être entouré d’autres sites (cellules) aux valeurs de risque
élevées. Les cellules de 300 m de résolution ont été agrégées
en cellule de 3 km de résolution.
L’analyse statistique (Fig. 2) présente très peu de cellules
caractérisées par des valeurs relativement élevées qui
pourraient être regroupées. Les résultats du CRI (CRI>0,32)
ont permis d’identier les « hot spots ». Le seuil pour être
caractérisé comme « hot spot » a été déni de manière à
mettre en évidence seulement les zones exceptionnellement à
risque selon la distribution statistique des cellules.
Figure 2 : Distribution statistique des classes de risques
utilisées pour la méthode CRI-MED
Cartes des risques permettant de visualiser et de
hiérarchiser les risques
La carte régionale de l’évaluation des risques côtiers, au forçage
climatique et non climatique, afche les résultats en termes de
catégories de risques dans les zones côtières étudiées (Fig. 3).
La carte indique les valeurs de risque pour chaque site (cellule)
en appliquant l’équation de la méthode CRI-MED. Les sites
comportant des valeurs de « risque extrêmement élevé » sont
indiqués en rouge et dans le contexte de l’étude, ils sont dénis
comme des « hot spots ».
Les zones à risque extrêmement élevé sont relativement
peu nombreuses et principalement situées dans la région
sud méditerranéenne. Le Maroc, l’Algérie, la Libye, l’Égypte, la
Palestine et la Syrie sont les pays principalement concernés par
les risques côtiers.
Notons que les zones à risque extrêmement élevé sont
principalement situées dans la région du sud et de l’est de
la Méditerranée. Les pays concernés par le risque côtier très
élevé et présentant au moins un point chaud (indiqué entre
parenthèses) sont le Maroc (2), l’Algérie (4), la Tunisie (2), la
Libye (4), l’Egypte (5), Israël (1), la Palestine (1), le Liban (3), la
Syrie (2), la Turquie (4), Chypre (2), la Grèce (3), l’Albanie (2),
l’Italie (6) et la France (1).
Grande vulnérabilité et forte exposition ne veulent
pas nécessairement dire risques élevés
L’approche d’évaluation du risque met en évidence certaines
différences importantes par rapport aux méthodes traditionnelles
d’évaluation de la vulnérabilité.
Le risque dépend de l’interaction entre la vulnérabilité, le
forçage et l’exposition. Si la vulnérabilité est élevée mais que le
forçage et/ou l’exposition sont faibles, alors le risque est faible.
Le principal enseignement que l’on peut tirer de l’évaluation du
risque au niveau régional basée sur le CRI-MED indique que les
« hot spots » sont également des zones présentant une très
forte vulnérabilité. À l’inverse, toutes les zones qui présentent
une très forte vulnérabilité ne sont pas toutes considérées
comme des « hot spots » car les valeurs correspondant au
forçage et à l’exposition peuvent être extrêmement faibles ou
modérées.
Figure 3 : Carte d’évaluation du risque régional basée sur la méthode CRI-MED
Source : Satta et al., 2016
Source: Satta et al., 2016
ZOOM

3. présence de trois sous-indices indépendants pour représenter la
vulnérabilité, l’exposition et le forçage ;
4. possibilité d’étendre l’indice pour inclure des ensembles de
données supplémentaires ;
5. intégration du concept de risque tel que proposé par l’IPCC AR5 ;
6. les cartes de risques et de vulnérabilité peuvent également être
créées ;
7. potentiel de reproductibilité et d’application à plusieurs échelles.
Ces méthodes sont complexes lorsqu’il s’agit de pondérer
les variables, car ce choix affecte nalement la visualisation et
l’interprétation des résultats. La participation d’un panel d’experts
pour pondérer les variables du CRI-MED peut améliorer la précision
de la méthodologie. Avoir la possibilité de modier la pondération
des variables et de montrer les changements aux politiques et au
grand public est utile en terme d’adaptation.
Des améliorations méthodologiques peuvent être obtenues en
augmentant le nombre de variables pour les sous-indices et en
dénissant des bases de données normalisées à référence spatiale
plus précises, validées au niveau régional et local.
PLAN BLEU
Centre d’Activités Régionales du PNUE/PAM
15 rue Beethoven - Sophia Antipolis
06560 Valbonne - FRANCE
Tél. : +33 4 92 38 71 30
Fax : +33 4 92 38 71 31
e-mail : [email protected]
www.planbleu.org
Editeur : Plan Bleu
Directeur de la publication : Anne-France Didier
Auteurs : Sara Venturini, Alessio Satta, Manuela Puddu, John Firth, Antoine Latte
Comité de lecture : Julien Le Tellier, Jean-Pierre Giraud
Conception graphique et réalisation : Hélène Rousseaux
Impression : Nis Photoffset
Dépôt légal : novembre 2016 - édition révisée (1ère édition : août 2015) - ISSN 1954-9164
Bibliographie
GIEC, 2014. Summary for policymakers. In: Climate Change 2014: Impacts, Adaptation,
and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the
Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Field, C.B., & al.
(eds.)]. Cambridge University Press, pp. 1-32.
Gualdi S., Somot S., May W., .[..,] and Xoplaki E., 2013. Future Climate Projections. Chapter
3. Volume 1: Air, Sea and Precipitation and Water. Regional Assessment of Climate Change in
the Mediterranean. Antonio Navarra and Laurence Tubiana (Eds).
McLaughlin, S. and Cooper J.A.G., 2010. A multi-scale coastal vulnerability index: A tool
for coastal managers? Environmental Hazards, Volume 9, Number 3. pp. 233-248(16).
Satta A., Venturini S., Puddu M., Firth J., Latte A., 2015. Strengthening the Knowledge Base
on Regional Climate Variability and Change: Application of a Multi-Scale Coastal Risk Index at
Regional and Local Scale in the Mediterranean. Plan Bleu Report.
Travers A., Elrick C. and Kay R., 2010. Position Paper: Climate Change in Coastal Zones of
the Mediterranean. Split, Priority Actions Programme (PAP/RAC).
ZONES CÔTIÈRES
Dynamiques de territoires
Source : Satta et al., 2015
Figure 4 : Cartes de Forçage (a), Vulnérabilité (b), et Exposition (c) de Tetouan, Maroc
Note : Ce travail est basé sur les résultats de l’étude effectuée par le Plan Bleu dans
le cadre de la Composante 2 du projet ClimVar et GIZC intitulée « Renforcer la base
de connaissances sur la variabilité et le changement climatique » en collaboration
avec Acclimatise, Climalia et leurs associés en 2015. ClimVar & ICZM est un projet
complémentaire du projet FEM / PNUE / Banque mondiale MedPartnership. En
2016, ce travail a été complété par la Fondation MEDSEA et le Plan Bleu, et nancé
par le PNUE / PAM.
L’indice multi-échelle des risques côtiers
appliqué aux échelles régionale et locale
L’application d’un indice multi-échelle des risques côtiers pour
l’évaluation du risque à l’échelle locale est appelée CRI-LS [Satta
et al., 2015]. La ville deTétouan au Maroc qui a déjà été identiée
comme un « hot spot » dans l’évaluation du CRI-MED a été choisie
pour l’étude de cas.
Les différences entre les deux échelles d’application sont la
dénition de l’unité côtière basée sur la zone côtière à risque et le
choix des variables utilisées pour décrire les trois sous-indices. En
outre, une résolution supérieure est nécessaire à l’échelle locale.
Pour obtenir des informations plus détaillées dans le but de dénir
des stratégies appropriées, d’autres variables ont été introduites
pour les sous-indices de vulnérabilité et d’exposition, alors que les
variables du sous-indice de forçage restent les mêmes que celles du
CRI-MED. L’application du CRI-LS conduit à l’identication de trois
« hot spots» côtiers situés dans les plaines inondables deTétouan
(plaines de Restinga, de Smir et de Martil Alila).
Méthodologie de l’indice multi-échelle des risques
pour les décideurs
La méthodologie de l’indice multi-échelle des risques côtiers
proposée pour l’évaluation du risque côtier régional et local, par
l’application du CRI-MED et du CRI-LS, permet une détection
scientiquement able des « hot spots » côtiers. Ces outils
semblent particulièrement ables pour assister les décideurs dans
l’identication spatiale des zones côtières caractérisées par les
différents niveaux de vulnérabilité et d’exposition (Fig. 4) et dans la
réexion vers des options d’adaptation.
Les principaux avantages des méthodes de l’indice multi-échelle
des risques côtiers sont les suivants :
1. processus de calcul facile et économique ;
2. prise en compte des variables physiques et socio- économiques ;
1
/
4
100%