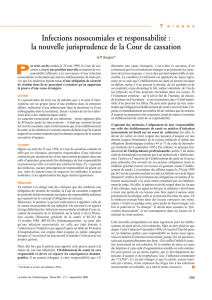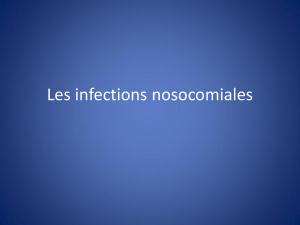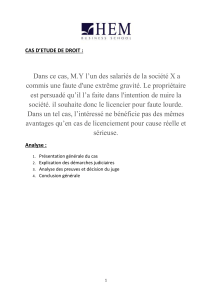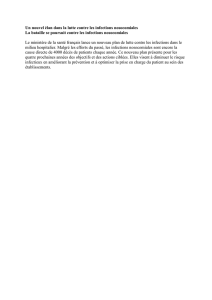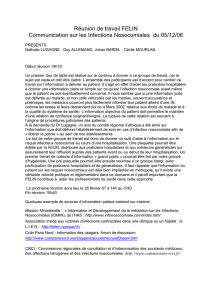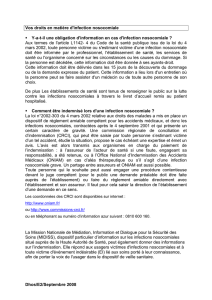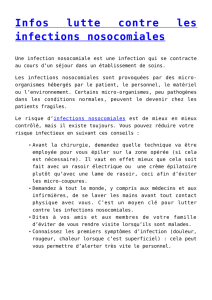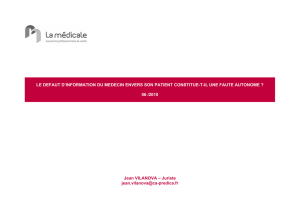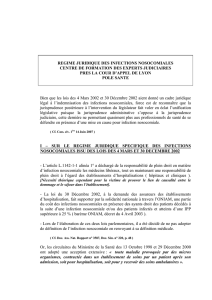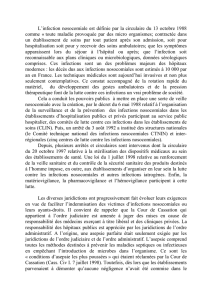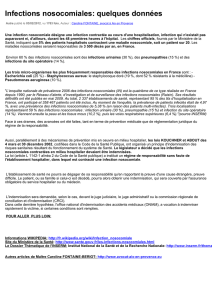Infections nosocomiales et responsabilité

Infections nosocomiales 337
INFECTIONS NOSOCOMIALES ET RESPONSABILITE
G. Decroix. Le Sou Médical, 130 rue du Faubourg Saint Denis, 75466 Paris cedex 10.
INTRODUCTION
L’anesthésiste et surtout le réanimateur sont concernés par le problème des infec-
tions nosocomiales car, outre leur implication dans le fonctionnement général des
services, leur responsabilité personnelle peut être recherchée en tant que praticien auteur
d’actes pouvant être contaminants. Par trois arrêts du 29 juin 1999, la Première Cham-
bre Civile de la Cour de Cassation a fait évoluer la jurisprudence en étendant de manière
considérable les obligations des praticiens puisqu’elle a fait peser sur les trois opéra-
teurs poursuivis une véritable obligation de sécurité-résultat.
Il s’agit de la nouveauté jurisprudentielle la plus inquiétante pour les médecins
depuis celle sur l’obligation d’information en raison du principe semble-t-il catégori-
que qui a été posé, du nombre très élevé d’infections contractées dans les établissements
français et de l’importance des dommages occasionnés.
Nous devons rechercher ce qui a exactement changé et tenter de déterminer quelles
pourraient être les premières conséquences de ces nouvelles jurisprudences. Il s’agit
d’une évolution progressive avec un coup de théâtre final et il convient de la reprendre
sommairement.
1. EVOLUTION ANTERIEURE A 1999
Initialement, les complications infectieuses étaient traitées de la même manière que
tous les autres accidents médicaux et les procédures suivaient les mêmes règles de
droit. Les victimes devaient donc prouver la (ou les) faute(s) ayant occasionné cette
infection, le lien de causalité directe actuel et certain entre une faute et la contamination
et entre la contamination et dommage dont elles demandaient réparation. Elles étaient
souvent confrontées à d’importantes difficultés rendant leur action aléatoire. Tout
d’abord, il était fréquent que le germe ne soit pas identifié, faute de prélèvement ou car
les investigations ou analyses mises en œuvre étaient insuffisantes eu égard au germe
ou à la bactérie concerné parfois difficile à identifier.
En conséquence, l’issue de l’action dépendait de la diligence des médecins dans la
recherche des germes incriminés si bien que moins les praticiens agissaient en profes-
sionnels consciencieux dans la recherche et la détermination des risques, moins ils
risquaient d’être condamnés.

MAPAR 2001338
Même si le germe était identifié, la victime devait prouver que la contamination
provenait d’une faute, ce qui était quasiment impossible. En effet, le demandeur devait,
pour cela, se procurer les protocoles d’asepsie du service dans lequel il avait été hospi-
talisé, prouver alors que : soit ils étaient insuffisants, soit qu’ils n’avaient pas été respectés
ce jour là, notamment par l’étude du cahier de bloc, de la feuille d’écologie, des bons de
commande, des certificats de maintenance du matériel…
Mais ce n’était pas tout car une fois la preuve de cette faute d’asepsie rapportée, la
victime devait être en mesure d’établir que c’est bien cette faute-là qui est à l’origine de
sa contamination, face au défendeur qui plaidait que bien d’autres causes de contami-
nation étaient possibles et que la stérilité absolue d’un bout à l’autre de la chaîne de
soins est impossible. Finalement peu de personnes se lançaient dans ce véritable par-
cours du combattant et bien moins encore obtenaient l’indemnisation sollicitée.
Il est vrai néanmoins que certaines juridictions ont été compréhensives face aux
victimes démunies et ont admis l’existence d’une faute et d’un lien de causalité sur la
base d’éléments très faibles, voire erronés. Mais ces jurisprudences favorables aux vic-
times restaient très minoritaires. Il a fallu l’intervention des hautes juridictions civiles
et administratives pour améliorer, par touches successives, le sort des patients contami-
nés. Ceci a permis la construction d’un système juridique d’indemnisation, parachevé,
en matière civile, par les trois arrêts du 29 juin 1999, qui ont probablement été trop loin
pour les professionnels de santé. Si l’objectif poursuivi est légitime, il faut néanmoins
tenir compte des impératifs de toutes les parties et ne pas arriver à un système qui soit
intolérable pour l’une d’entre elles ; nous aurons l’occasion de le détailler ultérieure-
ment.
Les deux ordres de juridiction ont suivi des évolutions parallèles mais décalées
dans le temps, chacun semblant vouloir la première place dans cette course à la moder-
nité. Mais n’oublions pas que, bien que l’objectif commun soit dans les deux cas
indemnitaire, il s’agit en matière administrative de la responsabilité des établissements
publics d’hospitalisation alors qu’en matière civile, outre la responsabilité des établis-
sements privés, c’est celle des praticiens eux-mêmes qui peut être retenue. Dans les
deux cas l’impact économique et psychologie est totalement différent, cet élément sem-
blant avoir été pris en compte jusqu’en juin 1999.
1.1. HOPITAUX PUBLICS : L’ARRET «COHEN»
C’est le Conseil d’Etat qui le premier est intervenu en faveur des victimes d’infec-
tions nosocomiales par l’Arrêt «Cohen» du 9 décembre 1988 inaugurant le principe de
la responsabilité pour faute présumée des hôpitaux publics en cas de dommage dû à une
infection nosocomiale. Ce fut un grand pas vers l’indemnisation qui fut ainsi franchi
puisque les victimes furent alors dispensées de la preuve de la faute et n’avaient plus
qu’à démontrer le caractère nosocomial de l’infection dont elles demandaient répara-
tion. Ceci n’était d’ailleurs pas toujours aisé tant la définition de l’infection nosocomiale
était (et est encore) sujette à controverse. Une définition a été donnée par une circulaire
du ministère de la Solidarité, de la santé et de la Protection sociale (DGS) n°88-236 du
13 octobre 1988 relative à l’organisation de la surveillance et de la prévention des
infections nosocomiales : «on entend par infection nosocomiale :
•Toute maladie provoquée par des micro-organismes.
•Toute maladie contractée dans un établissement de soins par tout patient après son
admission soit en hospitalisation, soit pour y recevoir des soins ambulatoires.
•Que les symptômes apparaissent lors du séjour à l’hôpital ou après.
•Que l’infection soir reconnaissable au plan clinique ou microbiologique, données
sérologiques comprises, ou encore les deux à la fois».

Infections nosocomiales 339
Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France a, en 1992, donné une défini-
tion très large et simple des infections nosocomiales comme étant celles qui étaient
absentes à l’admission à l’hôpital.
Enfin sur le site du ministère de la Santé nous trouvons la définition suivante : «les
infections nosocomiales sont des infections acquises dans un établissement de soins.
Une infection est considérée comme telle lorsqu’elle était absente à l’admission. Lors-
que l’état infectieux du patient est inconnu, l’infection est classiquement considérée
comme nosocomiale si elle apparaît après un délai de 48 heures d’hospitalisation».
Même si les critères varient, ils ont tous pour objet de démontrer que l’infection a
été contractée au sein de la structure de soins (bloc opératoire, service de réanimation,
mais aussi secteur ambulatoire ou cabinet du praticien), peu importe que ce soit au
cours de gestes techniques (médicaux ou infirmiers) ou du seul fait de sa présence dans
la structure. Pour apporter la preuve du caractère nosocomial, la victime va donc pou-
voir utiliser les critères contenus dans ces différentes définitions (absence de signes
cliniques ou biologiques d’infection à l’admission, premiers signes après 48 heures
d’hospitalisation, nature hospitalière du germe retrouvé…).
L’examen de la jurisprudence montre que peu de patients sont déboutés de leur
action du fait de l’absence de démonstration du caractère nosocomial de l’infection
qu’ils ont subi, les magistrats ayant une vision assez souple des critères et utilisant
parfois la preuve par «faisceau d’indices».
Dans cette affaire jugée par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1988, il faut noter que
la haute juridiction administrative n’avait pas suivi les conclusions du Commissaire du
Gouvernement qui avait considéré qu’aucune faute ne pouvait être retrouvée car aucun
acte médical n’était à l’origine du dommage si bien que seule les conditions d’asepsie
étaient en cause. Il avait ainsi conclu : «les précautions rigoureuses d’asepsie doivent
certes être observées en milieu hospitalier, mais il n’est pas pour autant possible d’exi-
ger des hôpitaux une asepsie parfaite, qui n’est d’ailleurs pas réalisable». Cette position
exigeante sur les méthodes d’asepsie à mettre en œuvre et réaliste face à leurs limites
n’a malheureusement pas su contrebalancer la volonté indemnitaire des magistrats. Même
si elle est présumée, c’est bien la faute qui est la condition de la responsabilité des
hôpitaux pour les infections nosocomiales et les juridictions administratives peuvent
alors tenir compte des circonstances de la contamination (urgence ou acte programmé,
âge et état général du patient, nature de la pathologie traitée, activité du service con-
cerné…) pour déterminer son caractère plus ou moins prévisible eu égard aux mesures
de prévention utilisées.
Les décisions ultérieures du Conseil d’Etat ont utilisé la notion de faute prouvée
dégagée par l’Arrêt Cohen. Par exemple, dans son arrêt du 14 juin 1991 il a considéré
que l’introduction d’un germe microbien dans l’organisme lors d’une intervention chi-
rurgicale révèle une faute dans l’organisation ou le fonctionnement du service hospitalier
et, dans son arrêt du 3 février 1992, pour une infection à staphylocoques dorés après
arthrographie a estimé que même si les médecins ont pris les précautions recomman-
dées et si l’aiguille et la seringue étaient à usage unique, le fait qu’une telle infection ait
pu se produire montre une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service.
Le pas entre la responsabilité pour faute présumée et la responsabilité sans faute est
presque franchi avec ce type de raisonnement qui déduit du dommage l’existence
d’une faute.

MAPAR 2001340
1.2. DANS LE SECTEUR PRIVE
Pour les actes réalisés dans des établissements privés, la jurisprudence civile a évo-
lué d’une manière parallèle, à une allure différente mais avec un objectif commun :
faciliter l’indemnisation des victimes d’infections nosocomiales. Le régime de la res-
ponsabilité était initialement, comme en matière administrative, celui de la faute prouvée,
mais dès 1984 (cass. 1e civ. 28 février 1984) la Cour de Cassation a fait peser une forte
exigence d’asepsie sur les praticiens et les établissements. En l’espèce il s’agissait d’un
phlegmon pyogazeux sans lésion cutanée dans les suites de ponctions pour traiter un
hématome du quadriceps. La Cour de Cassation a considéré que «le médecin a manqué
à son obligation de moyens concernant le respect des méthodes d’asepsie moderne
qu’il devait à son patient (…), les notions en cause étant depuis longtemps classiques,
les juges du second degré n’étaient pas tenus de rappeler que la technique, dont il
s’agit, se rattache à une opération consacrée, ni qu’elle faisait partie des données de la
science au moment de l’intervention». La Cour Suprême avait ici considéré (comme
plus tard dans son arrêt du 29 novembre 1989) qu’à partir du moment où il existait des
moyens d’asepsie plus efficaces que ceux mis en œuvre, la responsabilité devait être
retenue. Mais il était bien souvent impossible d’identifier les techniques d’asepsie réel-
lement utilisées, si bien que les victimes étaient dans l’impossibilité de prouver qu’une
obligation de moyens n’avait pas été respectée.
C’est par un arrêt du 21 mai 1996 que la 1echambre civile de la Cour de Cassation
(soit 8 ans plus tard) a mis en place une jurisprudence comparable à l’Arrêt de Cohen.
Dans cette affaire, la victime avait été atteinte d’une infection suite à une intervention
chirurgicale destinée à traiter une hyperlaxité ligamentaire, infection qu’elle imputait à
la clinique qui n’aurait pas respecté son obligation de stérilisation des appareils et d’asep-
tisation de la salle d’opération. Déboutée par la Cour d’Appel, elle saisit la Cour de
Cassation, arguant d’un défaut de base légale. Cette dernière a subtilement utilisé cette
procédure pour poser un nouveau principe tout en ne l’appliquant pas immédiatement
pour ne pas se voir reprocher un revirement jurisprudence trop brutal. C’est ainsi qu’el-
le a considéré «qu’une clinique est présumée responsable d’une infection contractée
par un patient lors d’une intervention pratiquée dans une salle d’opération, à moins de
prouver l’absence de faute de sa part» mais n’a pas fait droit à la demande de la victime
en reprenant les constatations des juges du fond sur le caractère adapté de l’appareil au
formol utilisé et sur le fait que l’utilisation d’un flux laminaire n’était pas obligatoire à
l’époque des faits. Elle a ainsi confirmé que la clinique n’avait pas commis de faute
dans l’aseptisation de la salle d’opération ce qui l’exonérait de la toute nouvelle pré-
somption de responsabilité pesant sur elle. Notons que la Cour de Cassation a ainsi mis
en place une présomption de responsabilité (et non une faute présumée) pesant exclusi-
vement sur les établissements privés non-irréfragables car la preuve contraire,
exonératoire de responsabilité, peut être apportée par tout moyen.
Ce système a été confirmé et complété par l’Arrêt du 16 juin 1998 par lequel la
première chambre civile a eu à statuer sur une infection à streptocoques bêta-hémolyti-
que du groupe A, contractée par une parturiente lors de son accouchement ; l’expertise
avait conclu à une contamination due à une infection au même germe dont était atteinte
la sphère ORL d’un membre du personnel présent dans la salle d’accouchement. La
Cour de Cassation a repris la présomption de responsabilité pesant sur la clinique en
considérant qu’une salle d’accouchement pouvait être assimilée à une salle d’interven-
tion et que du fait de la présence auprès de la parturiente d’un personnel contaminant, la
clinique n’était pas en mesure de prouver qu’elle n’avait commis aucune faute.

Infections nosocomiales 341
Ceci était l’état de la jurisprudence civile jusqu’en 1999, la victime n’ayant qu’à
prouver la relation de causalité entre l’infection et l’hospitalisation pour mettre en œu-
vre la présomption de responsabilité.
2. LES APPORTS DES TROIS ARRETS DU 29 JUIN 1999
Le système ainsi mis en place, pourtant très favorable aux victimes, ne devait pas
être satisfaisant puisque la première Chambre Civile de la Cour de Cassation a cru
devoir le dépasser en modifiant le régime de la responsabilité et en étendant la liste des
civilement responsables. La Cour Suprême a, le même jour regroupé trois affaires d’in-
fection nosocomiale, avec des conclusions communes du conseiller rapporteur,
M. Sargos, ce qui montre l’importance accordée aux nouveaux principes posés par
cette juridiction.
Il s’agit de trois dossiers différents dont il convient de décrire brièvement les faits.
2.1. AFFAIRE N°1
Dans le premier (affaire n°1) le patient (57 ans), artisan, en raison de douleurs des
genoux devenues invalidantes, subit en 1987 une arthroscopie des genoux, qui mettra
en évidence à droite, une arthrose fémoro-tibiale et à gauche une arthrose tricomparti-
mentale. Le 11 janvier 1988, le chirurgien orthopédiste réalisera une ostéotomie du
genou droit et le 29 janvier, il mis en place une prothèse totale du genou du côté gauche.
Huit jours plus tard apparut une forte inflammation avec écoulement de la plaie du côté
gauche due à l’introduction de staphylocoques dorés lors de l’intervention. Pour parer
aux importantes conséquences de cette infection, il a fallu réaliser six nouvelles inter-
ventions chirurgicales avec une prothèse du genou le 27 juin 1990 et une antibiothérapie
maintenue jusqu’au 1er octobre 1990. L’expert judiciaire conclura qu’il s’agit d’une
infection nosocomiale mais qu’aucune faute d’asepsie de la salle d’opération ou du
matériel ne pouvait être retrouvée. Les séquelles sont importantes : ITT 3 ans, IPP 22 %,
inaptitude à sa profession. Sur le fond, le TGI n’a retenu aucune faute ayant provoqué
l’infection à la charge de la clinique et de l’opérateur, mais a considéré que ce dernier
n’avait pas respecté son obligation d’information sur un risque dont la fréquence n’était
pas négligeable. Il a condamné l’opérateur à verser 100 000 F de dommages et intérêts
en réparation de la perte de chance due au défaut d’information et a débouté la CPAM
qui réclamait la prise en charge de son importante créance. La Cour d’Appel a adopté la
même solution en réduisant à 70 000 F la réparation accordée. C’est la CPAM, à nou-
veau déboutée, qui a déposé un pourvoi en Cassation, suivie ensuite par la victime et
l’opérateur.
2.2. AFFAIRE N°2
Le deuxième dossier (affaire n°2) concerne également un problème du genou, mais
cette fois-ci dû à un accident de rugby chez un homme de 30 ans. Le 19 septembre
1989, il a subi une reconstitution du ligament rompu du genou droit qui n’a pas donné
satisfaction, si bien qu’une arthroscopie a été réalisée par le même opérateur dans le
même établissement deux mois plus tard. Quarante-huit heures après, une infection à
staphylocoques dorés se déclare, en rapport avec l’introduction de l’arthroscope dans
le genou. Le patient a mis en œuvre une procédure civile qui a abouti à la condamnation
in solidum de la clinique par le TGI (24/11/1995) qui sera confirmée par la Cour
d’Appel (27 mars 1997). C’est l’opérateur (ou plutôt son assureur) qui régularise le
pourvoi principal arguant qu’il n’est tenu en la matière que d’une obligation de moyens,
qu’aucune faute n’a été relevée à son encontre et que c’est à tort que la Cour d’Appel
lui a appliqué une véritable obligation de résultat. Plus exactement, le TGI avait motivé
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%