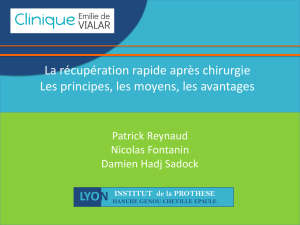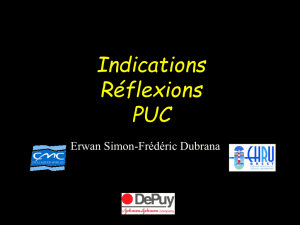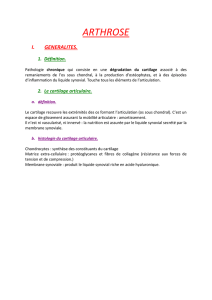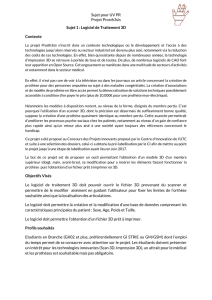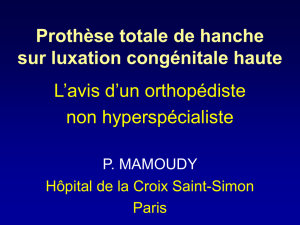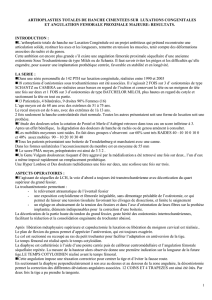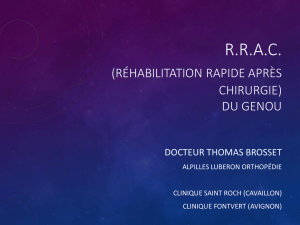Chirurgie de la gonarthrose

Chirurgie de la gonarthrose
G. Bellier, P. Djian
Le traitement de la gonarthrose n’est pas univoque. Il nécessite une prise en charge globale du patient et
doit tenir compte des demandes de celui-ci en terme d’activité ; cela pour choisir de manière pertinente la
solution la plus adaptée. Ce chapitre concerne la chirurgie de la gonarthrose. Il permet de comprendre
qu’il existe plusieurs solutions. Sont abordés les traitements arthroscopiques, les ostéotomies ainsi que les
remplacements prothétiques. Une proposition thérapeutique permet de faciliter l’indication chirurgicale
face à un problème de consultation quotidienne.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Gonarthrose ; Ostéotomies fémorales et tibiales ; Arthroplasties unicompartimentaires et totales
Plan
¶Introduction 1
¶Rappel radioclinique 1
¶Traitement chirurgical 1
Arthroscopie 1
Ostéotomies 3
Prothèses 7
Indications comparatives : ostéotomie-prothèses
unicomportementales-prothèse totale du genou 11
¶Conclusion 11
■Introduction
Le traitement chirurgical des gonarthroses ne se résume pas
à la prothèse totale de genou (PTG), bien que la chirurgie
prothétique ait atteint sa maturité, avec d’excellentes courbes de
survie.
La gonarthrose est la localisation arthrosique la plus fré-
quente ; elle est environ trois fois plus fréquente que la
coxarthrose en Europe occidentale. La fréquence radiologique
est de l’ordre de 40 % au-delà de 70 ans, mais elle est supérieure
à la fréquence clinique
[1]
.
Les gonarthroses sont, dans la grande majorité des cas,
secondaires à un trouble mécanique, soit constitutionnel (genu
varum congénital), soit acquis (cal vicieux diaphysaire fémoral
ou tibial, séquelle d’une fracture intra-articulaire). La
gonarthrose primitive sur genou axé est beaucoup plus rare
(maladie du cartilage, chondrocalcinose).
Il est nécessaire d’utiliser une échelle de score pour apprécier
les résultats de la chirurgie : la plus utilisée est celle de l’IKS
(International Knee Society)
[2]
qui prend en compte différents
paramètres tels que la douleur et la marche (score fonction sur
100) et la mobilité et la stabilité (score genou sur 100). Ce score
est le plus utilisé pour apprécier les résultats de la chirurgie
prothétique. Il est d’utilisation simple, mais ne permet pas une
analyse fine.
Le score de WOMAC
[3]
très prisé des rhumatologues, est
beaucoup plus complet, mais d’utilisation plus compliquée.
Le traitement chirurgical des gonarthroses peut être conser-
vateur (chirurgie arthroscopique, ostéotomies), ou prothétique
(arthroplastie unicompartimentaire ou tricompartimentaire).
■Rappel radioclinique
[4]
Avant d’envisager le traitement proprement dit, il faut
naturellement bien connaître tous les éléments cliniques,
radiologiques, mais aussi étiologiques de cette pathologie.
■Traitement chirurgical
Arthroscopie
Lavage articulaire
Le mécanisme d’action du lavage articulaire dans une
gonarthrose n’est pas très clair. Récemment, plusieurs auteurs
[5,
6]
ont suggéré qu’il avait pour but de retirer « mécaniquement »
les cytokines (interleukine 1 [IL1], tumor necrosis factor alpha
[TNF-a]) et les métalloprotéases de l’articulation ainsi que les
produits de dégradation du cartilage, les débris cartilagineux ou
les cristaux de pyrophosphate de calcium irritant la synoviale.
Dans les stades précoces, l’ablation de telles enzymes permet aux
chondrocytes de réguler leurs activités biologiques. D’autres
mécanismes comme la distension capsulaire ont été invoqués
pour expliquer l’effet bénéfique symptomatique du lavage. Le
renouvellement du liquide synovial peut influencer l’élasticité du
cartilage hyalin en changeant les rapports entre protéoglycans et
sodium et favoriser une augmentation de la perméabilité du
cartilage. Lorsque le cartilage a complètement disparu et qu’il
existe un contact os-os, l’effet bénéfique du lavage articulaire est
minimisé.
Le lavage articulaire a un effet symptomatique réel, mais
transitoire, de quelques moisà1an;ilpeut être éventuelle-
ment répété.
Cependant, par son efficacité transitoire, le lavage articulaire
apparaît avant tout comme un traitement de la gonarthrose en
¶14-326-A-10
1Appareil locomoteur
.
.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 28/07/2010 par BELLIER Guy (282159)

poussée, avec épanchement chronique résistant aux infiltrations
de corticoïdes, sans signe clinique de dérangement mécanique
intra-articulaire (pas d’accrochages, pas de douleurs brèves et
brutales en « éclairs »).
Ablation de corps étrangers libres
Les corps étrangers libres sont souvent présents dans les
gonarthroses évoluées. Les corps étrangers antérieurs sont
responsables de blocages ou de sensation d’accrochage intra-
articulaire. Le but est de faire disparaître ces symptômes. La
douleur n’est que peu diminuée.
Ablation d’ostéophytes
La résection des ostéophytes peut se faire aux instruments
motorisés (fraise) ou à l’aide d’une curette. Certains auteurs
prônent la résection des ostéophytes en conflit avec le cartilage
articulaire ou des berges condyliennes. En fait, le geste le plus
efficace semble être la résection des ostéophytes de l’échancrure
intercondylienne ou de la surface préspinale pour corriger un
flessum.
Méniscectomie
Historiquement, la méniscectomie était faite à ciel ouvert et,
à l’époque, les résultats n’étaient pas à la hauteur des espéran-
ces. Il est intéressant de rappeler cette expérience et de la
comparer à celles obtenues sous arthroscopie. Jones et al.
[6]
ont
montré qu’il y avait une relation entre la méniscectomie totale
et la progression de l’arthrose sur une série de 49 patients à
4 ans de recul. Ainsi, les auteurs recommandent de laisser les
ménisques dégénératifs en place. Lotke et al.
[7]
ont revu une
série de 101 patients d’âge supérieur à 45 ans. Les patients avec
radiographies normales initialement ont 90 % de chance
d’obtenir un bon résultat. Les patients avec des anomalies
radiographiques dégénératives ont seulement 21 % de chance
d’avoir un résultat satisfaisant à terme. L’arrivée de l’arthrosco-
pie a permis de pratiquer une méniscectomie sans la morbidité
peropératoire que l’on connaissait. Jackson et Rouse
[8]
ont été
les premiers à rapporter les résultats de méniscectomie chez des
patients âgés de plus de 40 ans. Ils rapportaient 95 % de bons
résultats chez des patients indemnes de toutes atteintes cartila-
gineuses radiographiques et le résultat tombait à 80 % dès qu’il
existait des anomalies cartilagineuses sur les radiographies
préopératoires. McBride et al.
[9]
ont comparé le résultat des
méniscectomies partielles arthroscopiques sur une population
d’âge moyen de 56 ans entre un groupe présentant une lésion
méniscale a priori traumatique (anse de seau, languette, lésion
radiaire ou oblique) et un groupe dont les lésions étaient
dégénératives (clivage horizontal ou complexe). Ils ont trouvé
un taux de 96 % de satisfaits dans le premier groupe et un taux
de 65 % de satisfaits dans le second groupe. Dans celui-ci, il y a
eu progression des lésions cartilagineuses avec accentuation du
varus et pincement de l’interligne intéressé. Casscells et al.
[10]
ne trouvent pas de corrélation entre le stade radiologique et
l’atteinte méniscale sur cadavres. Cependant, l’auteur pense que
le ménisque, même lésé, peut permettre de répartir la charge et
il préconise de n’enlever qu’une partie du ménisque dans cette
étiologie. Noble et al.
[11]
montrent que l’ablation d’un ménis-
que avec un clivage horizontal réduit de 57,5 % l’absorption à
l’énergie. Rand
[12]
rapporte une série de 84 patients avec un
recul de 2 ans. Tous les patients avaient un stade III ou IV
d’Outerbridge. La présence d’ostéophytes et d’ostéosclérose était
associée à un mauvais résultat clinique. Neuf patients sur 15 ont
vu leur interligne articulaire se pincer après la méniscectomie.
Richard et Lonergan
[13]
trouvent, sur une petite série avec un
recul de 41 mois, que le taux d’amélioration était de 81 % sur
les grades I et II d’Outerbridge et qu’il tombe à 66 % en cas de
grade III ou IV. En 1990, Baumgartner
[14]
signale que la
méniscectomie sur gonarthrose a un meilleur pronostic en cas
de lésion traumatique.
Lorsqu’une arthroscopie est proposée pour une atteinte
méniscale sur un genou arthrosique, les conclusions fondées sur
la revue de la littérature peuvent s’établir ainsi :
• il faut savoir limiter le geste à l’ablation isolée d’une lan-
guette méniscale instable ;
• les patients ayant un antécédent traumatique et une sympto-
matologie de douleurs brèves et brutales peuvent espérer une
amélioration après l’arthroscopie ;
• la présence d’une atteinte cartilagineuse dégénérative impor-
tante est un facteur péjoratif pour le résultat final ;
• la présence d’une déviation axiale importante associée à une
longue histoire de douleurs ne doit pas conduire à une
arthroscopie.
Synovectomie
La synovectomie antérieure est rarement pratiquée à titre
isolé dans la gonarthrose. La synovectomie d’une synovite
inflammatoire n’est pas un geste anodin et peut être responsa-
ble d’une hémathrose postopératoire.
Chondrectomie ou « shaving »
La régularisation d’une chondropathie ouverte fibrillaire n’est
pas à recommander. L’excision d’un clapet cartilagineux post-
traumatique est certainement plus bénéfique que la chondrec-
tomie sur une chondropathie dégénérative.
Technique de stimulation ostéochondrale
Ces différentes techniques cherchent à produire une répara-
tion fibrocartilagineuse en exposant l’os sous-chondral tout en
produisant un caillot de fibrine. Les cellules mésenchymateuses
indifférenciées vont se multiplier et peuvent, en fonction de
facteurs locaux et de facteurs mécaniques, se différencier en
cartilage ou en os. Cependant, le cartilage « reconstitué » est très
loin du cartilage hyalin et il s’agit d’un fibrocartilage constitué
de collagène de type II très fragile. Ces techniques ont histori-
quement été décrites pour le traitement des pertes de substance
cartilagineuse post-traumatique et n’ont été utilisées que plus
tardivement pour le traitement des lésions cartilagineuses
dégénératives.
Perforations de l’os sous-chondral de Pridie
Pridie
[15]
a décrit sa technique de perforation de l’os sous-
chondral en 1956 à l’aide d’une broche de Kirschner.
Les études animales ont confirmé les travaux de Pridie :
Mitchell et Shepard
[16]
ont montré que la stimulation de l’os
sous-chondral aboutissait à une restauration d’une surface
importante à partir du point d’entrée des broches. Il s’agit d’un
tissu de régénération de type fibrocartilage avec une concentra-
tion en protéoglycan inférieure à celle du cartilage normal. La
profondeur de la perforation reste très discutée dans la littéra-
ture. En effet, Hjertquist et Lemberg
[17]
montrent que la
stimulation cartilagineuse n’est possible que si la perforation
reste superficielle avec une corticale intacte.
Cette technique est encore très souvent pratiquée et facile à
réaliser sous arthroscopie. Dans une étude faite par Tipett
[18]
,le
groupe de patients qui a bénéficié d’une ostéotomie tibiale
associée à des perforations de Pridie a un résultat meilleur que
le groupe ayant eu une ostéotomie seule.
Abrasion arthroplastique
Cette technique très agressive a été défendue depuis 1979 par
Johnson
[19]
. La fraise motorisée doit réaliser des sillons parallè-
les dans l’os sous-chondral au niveau de la perte de substance
cartilagineuse.
Johnson constatait dans une étude rétrospective non contrô-
lée sur 423 cas un taux de 16 % de réopérations après 5 ans. Les
patients étaient sans appui pendant 2 mois. Cet auteur notait
l’existence d’un fibrocartilage avec un petit pourcentage de
collagène de type II.
Singh
[20]
, dans une étude rétrospective non contrôlée sur
52 genoux avec un recul de3à27mois soulignait que seuls
14-326-A-10
¶
Chirurgie de la gonarthrose
2Appareil locomoteur
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 28/07/2010 par BELLIER Guy (282159)

51 % des patients étaient améliorés, 23 % inchangés et 26 %
aggravés. Bert et Maschka
[21]
ont publié une série avec un recul
de 5 ans comparant l’abrasion arthroscopique au débridement
sous arthroscopie. Dans le groupe des abrasions arthroscopiques
(59 patients), 33 % des patients ont eu un mauvais résultat et
10 patients étaient moins bien qu’avant l’intervention. Dans le
groupe des débridements (67 patients), 21 % des patients
avaient un mauvais résultat et 12 patients étaient moins bien
qu’avant. Friedman et al.
[22]
ont publié sur une série de
73 patients avec un recul de 12 mois. Soixante pour cent des
patients ont été améliorés, 34 % ne notaient aucun changement
et 6 % étaient moins bien qu’avant l’intervention.
Microfractures
Steadman
[23, 24]
a décrit cette technique en 1994. Les lésions
doivent être dans un premier temps débridées de façon à
s’affranchir de tout fragment cartilagineux puis les perforations
sont réalisées avec un poinçon dont il existe plusieurs angula-
tions. L’utilisation d’un poinçon repose sur l’idée d’éviter tout
dommage thermique à l’os sous-chondral. Une mobilisation
immédiate est instituée sur arthromoteur. La reprise de l’appui
est effectuée 8 semaines après l’intervention.
L’auteur
[23]
a montré, dans une étude prospective non
contrôlée sur 298 cas avec un recul moyen de 7 ans, que 75 %
de patients étaient améliorés, 20 % inchangés et 5 % aggravés.
Les patients faisaient en postopératoire6à8heures par jour de
rodage articulaire sur arthromoteur. Il constatait dans 77 cas,
lors d’une seconde arthroscopie, un mélange de cartilage hyalin
et de fibrocartilage, avec des chondrocytes viables.
Passler
[25]
a montré dans une étude rétrospective, non
contrôlée sur 351 cas (dont 46 % avaient répondu à un ques-
tionnaire) avec un recul de 4,4 ans, que 78 % des patients
étaient fonctionnellement améliorés, 18 % inchangés et 4 %
aggravés.
McGinley
[26]
dans une série de 191 patients candidats pour
la mise en place d’une prothèse totale, notait que seul un quart
des patients tirait profit d’une arthroscopie.
Patel
[27]
dans une étude rétrospective non contrôlée de
254 cas avec un recul de 44 mois, relatait 18 % d’excellents
résultats et 57 % de bons résultats ; 15 % étaient moyens et
10 % mauvais.
Bert
[21]
, avec un recul de 60 mois sur 126 cas, a comparé
67 cas de débridement et 59 cas d’abrasion associée à un
débridement. Dans la première situation, il existait 66 % de
bons résultats et 21 % de mauvais. Dans l’association abrasion
et débridement, il existait 51 % de bons résultats et 33 % de
mauvais, indiquant ainsi que l’abrasion pouvait aggraver le
résultat du débridement.
Hubbard
[28]
dans une étude prospective randomisée compa-
rant le lavage articulaire (38 cas) et le débridement (40 cas) avec
un recul de 4,5 ans, trouvait un taux d’échecs de 86 % pour le
lavage et de 20 % pour le débridement.
A contrario Chang
[29]
dans une étude prospective randomi-
sée de 32 cas avec un recul de seulement 1 an montre que le
pourcentage de satisfaction est plus grand avec le seul lavage :
12 cas (56 %) qu’avec le seul débridement : 20 cas (44 %).
De nombreux auteurs
[16, 29-33]
insistent sur deux facteurs
péjoratifs : l’importance des lésions cartilagineuses érosives et le
facteur temps. Après 2-3 ans, les résultats se dégradent.
Deux auteurs
[34, 35]
insistent aussi sur deux autres critères
mécaniques péjoratifs pour les résultats : la laxité associée et une
déviation axiale supérieure à 5°. Ces mêmes auteurs signalent
que la gonarthrose fémorotibiale externe a un comportement
différent de la gonarthrose interne et réagit moins favorable-
ment à la chirurgie arthroscopique (débridement, abrasion).
C’est après méniscectomie externe partielle arthroscopique que
Charrois
[36]
a décrit des cas de chondrolyse rapide.
Le Tableau 1 résume 12 articles avec le nombre de cas, le
recul, et le pourcentage d’amélioration fonctionnelle.
Ostéotomies
But et méthodes
Les ostéotomies ont pour but de corriger un défaut d’axe,
généralement dans un seul plan, et sont réalisées en zone
métaphysaire et donc extra-articulaire.
Les ostéotomies modifient l’axe dans le plan frontal et/ou
sagittal et ainsi diminuent les contraintes excessives sur un
compartiment fémorotibial ou fémoropatellaire (FP). Ces
ostéotomies peuvent être corrigées à l’aide d’une assistance
informatique qui améliore la précision de la correction
souhaitée.
Gonarthrose fémorotibiale médiale
Dans la gonarthrose fémorotibiale médiale (Fig. 1) avec
déviation axiale, il existe un déséquilibre et un axe mécanique
qui passe en dedans du centre du genou. Les ostéotomies
doivent alors corriger le défaut anatomique, situé en général sur
le tibia dans le genu varum.
Tableau 1.
Résumé des 12 articles avec le nombre de cas, le recul et le pourcentage
d’amélioration fonctionnelle.
Auteurs Nombre
de cas
Recul
(ans)
% d’amélioration
fonctionnelle
Del Pizzo
[37]
37 1 32
Sprague
[38]
78 1 75
Salisbury
[35]
48 2 32 (94 si axé)
Jennings
[39]
51 2 71
MacLaren
[31]
171 2 78
Jackson
[8]
137 3 68
Baumgartner
[14]
49 3 40
Patel
[27]
276 4 75
Timoney
[33]
111 4 45
Oggilvie-Harris
[32]
441 4 68
Rand
[12]
131 5 67
Bert
[21]
126 5 66
Figure 1. Gonarthrose fémorotibiale médiale de face.
Chirurgie de la gonarthrose
¶
14-326-A-10
3Appareil locomoteur
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 28/07/2010 par BELLIER Guy (282159)

L’origine de la déformation en varus étant dans le tibia,
l’ostéotomie est tibiale. Celle-ci peut se faire par fermeture
externe, par ouverture interne, curviplane ou en dôme.
La correction à obtenir varie selon les auteurs. Dugdale et
al.
[40]
recommandent que l’axe mécanique global passant par le
centre de la tête fémorale et le centre de la cheville coupe
l’interligne fémorotibial dans le compartiment externe, entre
62 % et 66 % de la largeur de l’épiphyse tibiale proximale, ce
qui correspond à un valgus de 3 à 5°, calculé selon la méthode
de Duparc et Massare
[41]
. Hernigou
[42]
a montré, sur une
population de 93 patients avec un recul de 10 à 13 ans, que les
meilleurs résultats étaient obtenus quand le valgus des axes
mécaniques se situait entre 3° et 6°. Hernigou a montré que la
quantification de la correction peut se faire en mesurant la
largeur de la métaphyse tibiale au site de l’ostéotomie. Puis, on
peut convertir cette angulation en mesure de hauteur particu-
lièrement pour les ostéotomies d’ouverture. Pour éviter les
hypercorrections excessives d’origine ligamentaire, il peut être
nécessaire de soustraire de l’angle de correction la part ligamen-
taire de la déformation. Cette correction peut se faire en
comparant la déformation à l’autre genou.
Ostéotomies de fermeture externe. Les premières ostéo-
tomies tibiales de fermeture ont été faites par Gariepy
[43]
avec
résection de la tête de la fibula. Les ostéotomies tibiales de plus
de 10° nécessitent d’associer une section de la fibula qui peut
se faire par ostéotomie ou par désarticulation de l’articulation
péronéotibiale supérieure. Cette ostéotomie de la fibula est
nécessaire dans ce cas pour rapprocher les surfaces de coupe de
l’ostéotomie tibiale.
Il existe, dans ce geste, au niveau du péroné, un risque non
négligeable pour le nerf sciatique poplité externe (SPE). Aucune
méthode ne permet d’éviter complètement les lésions nerveuses
qui existent dans toutes les séries importantes de la littérature.
Kirgis
[44]
a délimité plusieurs zones à risque élevé et faible.
Dans la technique d’ostéotomie par fermeture externe, il faut
absolument conserver une charnière interne sous peine de
perdre immédiatement la correction souhaitée. La technique
opératoire décrite par Descamps
[45]
permet de réséquer un coin
à base externe de manière « automatique ». La synthèse peut se
faire par agrafes externes, lame-plaque, plaque, etc.
Les complications inhérentes à cette technique sont les
paralysies du nerf sciatique poplité externe, la détente du
tendon rotulien, et le syndrome de loge antéroexterne dont le
risque est supérieurà1%.Laconsolidation survient en général
entre la sixième et la huitième semaine postopératoire.
Ostéotomies tibiales par ouverture interne
[42, 46]
(Fig. 2, 3).
Cette ostéotomie est sus-tubérositaire et nécessite une désinser-
tion des ischiojambiers médiaux et du faisceau superficiel du
ligament latéral médial au niveau tibial. Aucune ostéotomie du
péroné n’est nécessaire dans cette technique. Comme dans
l’ostéotomie par fermeture externe, il faut apporter un soin
particulier à la charnière externe qui doit rester, sous peine de
perdre immédiatement la correction. Le vide induit par l’ostéo-
tomie doit être comblé dès que l’ouverture dépasse 7 mm. On
peut greffer par un greffon iliaque ou un substitut osseux. Le
positionnement de ce coin est fondamental et doit être postéro-
médial. La fixation se fait par plaque et vis. La consolidation
survient entre la sixième et la huitième semaine. Les complica-
tions sont plus rares que dans l’ostéotomie externe.
Ostéotomies curviplanes. En 1961, Jackson et Waugh
[47]
ont
décrit une ostéotomie en dôme de la métaphyse supérieure du
tibia à concavité supérieure passant sous la tubérosité tibiale.
Blaimont
[48]
a décrit l’ostéotomie curviplane. Celle-ci a été
popularisée par Maquet
[49]
qui a ajouté une translation tibiale
antérieure. L’ostéotomie de Blaimont est fixée par un fixateur
externe type cadre de Charnley. L’ostéotomie du péroné peut
être faite au col par la même incision ou par une incision
distincte. Les avantages de l’ostéotomie curviplane avec fixateur
Figure 2. Ostéotomie tibiale d’ouverture interne.
A. Cliché de face.
B. Cliché de profil.
14-326-A-10
¶
Chirurgie de la gonarthrose
4Appareil locomoteur
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 28/07/2010 par BELLIER Guy (282159)

externe sont la correction possible de l’angulation en post-
opératoire et la mise en compression du foyer d’ostéotomie.
C’est un des seuls types d’ostéotomie qui permet une correction
importante : Maquet a rapporté une correction de 20° en
moyenne (20° à 32°).
Gestes associés aux ostéotomies. Au cours de ces ostéoto-
mies, d’autres interventions peuvent être réalisées comme une
arthroscopie avec nettoyage et/ou méniscectomie, une transpo-
sition de la tubérosité tibiale, une retension ligamentaire
périphérique, voire une reconstruction intra-articulaire du
ligament croisé antérieur (LCA).
Indications des ostéotomies tibiales dans la gonarthrose
fémorotibiale médiale. Les indications sont dominées par
l’arthrose fémorotibiale. Les arthrites inflammatoires en sont
une contre-indication.
Les éléments de décision sont nombreux :
• l’usure est un critère important. Moins l’usure est importante
au départ, meilleurs sont les résultats. Lootvoet
[50]
montre
84 % et 60 % de bons résultats dans les stades I et II respec-
tivement. Dans les stades III et IV, les bons résultats sont plus
aléatoires ;
• le développement de l’arthrose sur un morphotype en genu
varum constitutionnel est un critère de bons résultats ;
• l’âge et le poids : pour beaucoup d’auteurs, l’âge de 65 ans
constitue une limite, mais des ostéotomies tibiales faites plus
tard donnent d’excellents résultats. Plus que l’âge, il convient
de prendre en compte l’espérance de vie ainsi que le niveau
d’activité. La surcharge pondérale est un facteur de mauvais
pronostic ;
• l’arthrose fémoropatellaire n’est pas une contre-indication et
n’influence pas les résultats. À long terme, l’arthrose FP ne
s’aggrave pas lors des reculs importants ;
• la mobilité n’influence pas le pronostic et est peu modifiée
par l’ostéotomie. La flexion ne se trouve pas modifiée, en
revanche, l’extension peut être améliorée si un butoir tibial
antérieur est enlevé durant l’ostéotomie ;
• la laxité périphérique est importante à prendre en compte.
Elle rend plus difficile la planification opératoire. Pour
certains auteurs, elle empêche de prévoir l’axe postopératoire.
Il faut s’aider de clichés en varus et valgus forcé ;
• le degré de déformation n’a pas d’influence sur le résultat
postopératoire. Seule la correction compte à long terme ;
• la pente du tibia est parfois à prendre en compte, notamment
pour corriger un flessum avec pour conséquence un retentis-
sement sur la flexion.
Gonarthrose fémorotibiale latérale
La correction d’un genu valgum arthrosique peut se faire soit
dans le fémur, soit dans le tibia.
L’ostéotomie fémorale de varisation est indiquée dans la
gonarthrose sur genu valgum d’origine fémorale (Fig. 4). Son
but est d’obtenir un axe mécanique entre 0° et 3° de valgus. Le
problème est que cette ostéotomie ne corrige la déformation
que dans un seul plan. En effet, elle n’agit pas en flexion
(efficacité décroissante de 0° à 90° de flexion) puisque les
condyles postérieurs sont en appui en flexion.
Deux types de technique sont actuellement employés : la
soustraction interne ou l’addition externe. Dans ce cas, il faut y
adjoindre un greffon. L’ostéosynthèse est capitale de façon à
envisager une rééducation immédiate. L’appui est autorisé de
manière partielle à partir de la sixième semaine. L’appui
complet est donné à 3 mois. Les principales complications sont
la pseudarthrose et la raideur du genou par adhérence du cul-
de-sac sous-quadricipital.
L’ostéotomie tibiale de varisation est la deuxième technique
employée pour corriger un genu valgum arthrosique. Elle est
souvent critiquée, car elle entraîne un interligne fémorotibial
oblique. Si cet interligne est trop oblique, en général supérieur
à 10°, il peut y avoir une subluxation frontale de l’articulation.
Un des avantages de l’ostéotomie tibiale de varisation est son
efficacité en extension et en flexion contrairement à l’ostéo-
tomie fémorale. La varisation tibiale peut se faire soit par
addition externe, soit par soustraction interne. Elle ne doit pas
induire d’obliquité supérieure à 10°. Les complications sont
rares. Pour les additions externes, il a été rapporté des élonga-
tions du nerf sciatique externe lors des corrections importantes.
Pour certains auteurs, la libération du SPE doit être
systématique.
Gonarthrose fémoropatellaire
La médialisation et/ou l’avancement de la tubérosité tibiale
antérieure (TTA) est l’intervention conservatrice la plus souvent
décrite dans la littérature. La technique de médialisation est
bien acquise actuellement. Certains auteurs lui associent un
effet d’avancement tel que l’a décrit Macquet
[51]
. L’avancée
isolée n’a plus d’indication, car les résultats ne sont pas
Figure 3. Gonométrie postopératoire après ostéotomie tibiale d’ouver-
ture interne.
Chirurgie de la gonarthrose
¶
14-326-A-10
5Appareil locomoteur
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés. - Document téléchargé le 28/07/2010 par BELLIER Guy (282159)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%