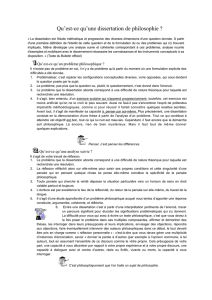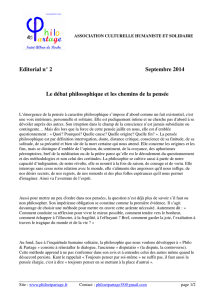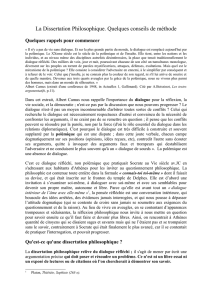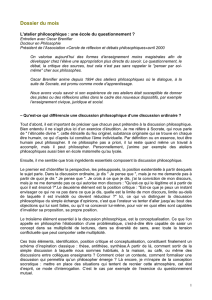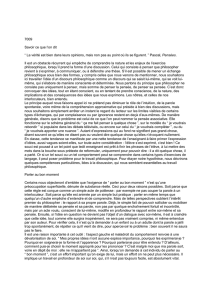Épreuve de philosophie

2
Épreuve de philosophie
Épreuve de philosophie
Tom e 1
Robert Tirvaudey
16.28 508899
----------------------------INFORMATION----------------------------
Couverture : Classique
[Roman (134x204)]
NB Pages : 204 pages
- Tranche : 2 mm + (nb pages x 0,07 mm) = 16.28
----------------------------------------------------------------------------
Épreuve de philosophie
Robert Tirvaudey
Robert Tirvaudey

2
2

2
3
Avant-propos
« Ne tirez pas cette conséquence de votre
apprentissage, qu’il ne vous reste rien à savoir,
mais qu’il vous reste infiniment à savoir. »
Pascal, Pensées, L.420.
Épreuve de philosophie n’appartient pas au registre
des Annales corrigés. Il est question ici d’une
invitation à la pensée et non de « bachoter » le
programme des classes terminales. L’ambition
poursuivie est d’exercer la réflexion soit sur le mode
d’une confrontation sur fond d’une question soit selon
la modalité d’un décryptage philosophique d’une
hypothèse. Il s’agit donc moins d’un instrument
pédagogique que de satisfaire par la pensée
philosophique les réquisits méthodologiques. Car il
est entendu que la pensée en philosophie se doit de
suivre un chemin (methodos, dit le grec), c’est-à-dire
un acheminement pour parvenir à une résolution ou
encore à une thèse que l’on fera nôtre. Ces exercices
ne sont donc pas à reprendre tels quels, ils sont
l’occasion de mettre en place un scénario conceptuel
critique dans l’optique d’un engagement intellectuel.

2
4
Ils sont plus spécifiquement des « expériences de
pensée ». C’est là son unique raison d’être. Précisons
que les questions et problèmes abordés ne sont pas
des artefacts, c’est-à-dire des interpellations
proprement formelles pour se dispenser de penser,
mais un ensemble de questionnements auquel toute
pensée est conviée.

2
5
I
L’exercice de la dissertation
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
1
/
20
100%