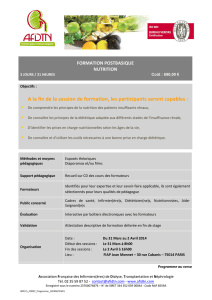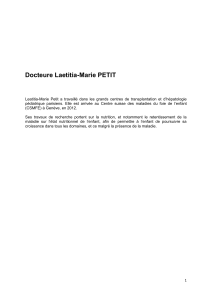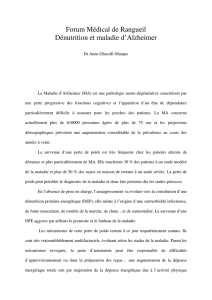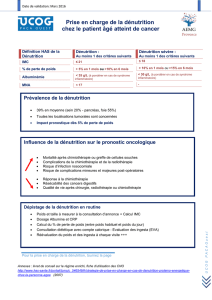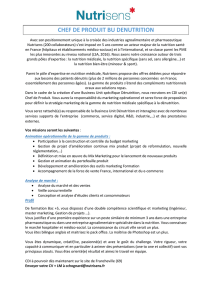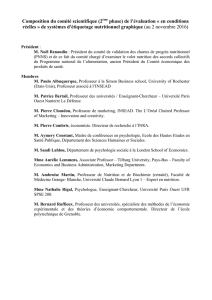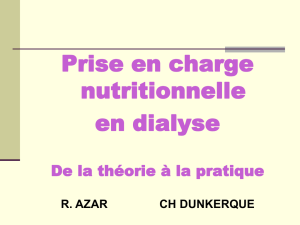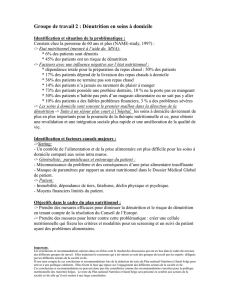en pathologie rénale - Institut Benjamin Delessert

Prévenir et traiter la dénutrition en pathologie rénale
Noël J.M. Cano1,2,3,4
49ème JAND janvier 2009
1CHU Clermont-Ferrand, Service de Nutrition, Hôpital G. Montpied, 63003 Clermont-Ferrand.
2CRNH Auvergne 63009, Clermont-Ferrand.
3Univ Clermont1, UFR Médecine, UMR 1019 Nutrition Humaine, 63000 Clermont-Ferrand,
4Inra, UMR 1019 Nutrition Humaine, 63122 Saint Genès Champanelle.

N. J.-M. Cano 3
L’altération de la fonction rénale est stratifiée en 5 stades en fonction du taux de filtration glomérulaire
(Tableau 1). La prévalence actuelle de l’insuffisance rénale chronique (IRC) est estimée à 3,5% de la
population en France, celle de l’IRC terminale (IRCT, stade 5) à un pour mille habitants, et celle des
hémodialysés à environ cinq pour dix mille [1]. L’influence de la dénutrition sur le pronostic des patients
insuffisants rénaux, qui débute souvent dès le début de la maladie, est particulièrement évidente au
stade 5 de l’insuffisance rénale : la mortalité des patients hémodialysés proche de 10 à 15% en France,
s’élève à 30% en cas de dénutrition [2].
Les causes de la dénutrition sont multiples au cours de l’IRC [1]. Elles associent une insuffisance des
apports alimentaires à des altérations du métabolisme protéique et énergétique (Tableau 2). Les
développements récents concernant la sarcopénie, la malnutrition et l’inflammation au cours des
maladies rénales ont conduit à la définition d’une nouvelle terminologie. Récemment, un panel
d’experts de l’International Society of Renal Nutrition and Metabolism a recommandé le terme
« protein-energy wasting » (PEW ,déplétion protéino-énergétique, DPE) pour désigner la déperdition de
masse protéique et des réserves énergétiques au cours de l’insuffisance rénale aiguë et chronique
(IRC) [3]. Selon ces recommandations, le diagnostic de DPE doit être établi lorsque trois éléments
diagnostiques sont présents : 1) diminution des concentrations plasmatiques d’albumine,
transthyrétine (préalbumine) ou cholestérol ; 2) réduction de la masse corporelle (diminution de l’indice
de masse corporel ou de la masse grasse associée à une réduction des apports proteino-énergétiques) ;
3) fonte musculaire, diminution du périmètre brachial musculaire ou de la masse maigre. Dans ce
texte, les termes « dénutrition » et « DPE » seront utilisés indifféremment.
La problématique de la prévention et du traitement de la DPE au cours de l’IRC varie en fonction du
contexte clinique. Chez le patient adulte, auquel se limite notre propos, deux tableaux peuvent être
schématiquement distingués en fonction de l’instauration ou non d’un traitement par dialyse [1]. Aux
stades prédialytiques, les objectifs principaux sont de limiter les signes de toxicité urémique et de
retarder la dégradation de la fonction rénale. L’alimentation doit également préserver l’état
nutritionnel. Elle doit être hypoprotidique et amener des apports énergétiques élevés. L’apparition
d’une DPE est un élément de la décision de la mise en dialyse qui permettra de libérer les apports
Résumé
La dénutrition est fréquente et son incidence sur le pronostic est majeure au cours de l’insuffisance
rénale chronique. De ce fait, différentes sociétés savantes ont édité des recommandations pour la
prévention et le traitement de la dénutrition. La surveillance régulière des ingesta et de l’état
nutritionnel ainsi que le respect des apports recommandés spécifiques des différents stades de la
maladie doivent permettre de prévenir son installation. La survenue d’un état de dénutrition au
cours de l’insuffisance rénale chronique terminale est un argument pour l’initiation de la dialyse.
Chez le patient dialysé, la dénutrition justifie l’intensification du conseil diététique et la mise en
route d’un support nutritionnel. L’efficacité de celui-ci peut être accrue par une approche
multimodale intégrant support nutritionnel, exercice et dans certains cas, cure d’androgène ou mise
en route d’une dialyse quotidienne.

N. J.-M. Cano 4
protéiques. Au cours de l’IRC traitée par dialyse, la DPE est retrouvée chez 20 à 70% des patients. Elle
détermine de manière indépendante le risque de décès et sa prise en charge est un élément clé du
suivi de ces patients. L’alimentation doit alors comprendre des apports protéiques et énergétiques
élevés. Du fait de la fréquence et l’impact pronostique de la DPE au cours de l’IRC, différentes sociétés
savantes ont édité des recommandations pour la prévention et le traitement de la DPE [4-9].
PRÉVENIR ET TRAITER LA DÉNUTRITION AUX STADES PRÉDIALYTIQUES DE
L’INSUFFISANCE RÉNALE
La dénutrition est alors peu symptomatique et souvent méconnue. Cependant, il a été montré que
l’évolution de l'IRC s’accompagne d’une réduction progressive des ingesta : l'apport protidique décroît
de 1,05 à 0,89 g/kg/j selon que la créatininémie est supérieure ou inférieure à 120 µmol.l-1 [10]. Il a
pu être calculé que chaque réduction de 10 ml/min de la clairance de la créatinine s’accompagne d’une
diminution de 0,06 g/kg/j de l’apport protidique [11]. L’apport énergétique, en règle plus réduit que ne
l’est l’apport protidique, contribue à l’altération de la balance protéique. Ainsi, les paramètres
nutritionnels et notamment l’indice de masse corporelle et l'albuminémie sont inversement corrélés
à la créatininémie [10]. Des signes de DPE sont présent chez 40 % des patients à l’entrée en dialyse
[11].
La prévention de la DPE comprend la surveillance trimestrielle des ingesta et de l’état nutritionnel, le
conseil diététique et dans certains cas une supplémentation nutritionnelle.
L’évaluation des ingesta permet de vérifier que ceux-ci correspondent bien aux apports recommandés,
caractérisés par une réduction des apports protéiques associée à une diète hyperénergétique (Tableau
1). Le rationnel de la diète hypoprotidique est de corriger certaines anomalies métaboliques associées
à l’IRC : l'acidose en diminuant la charge en acides aminés soufrés; l’hyperparathyroïdie secondaire
en réduisant l'apport phosphoré ; la résistance à l'action de l'insuline et la diminution de l'activité des
pompes à sodium par la moindre accumulation de peptides inhibiteurs résultant de la dégradation de
protéines alimentaires [12]. La restriction protidique est entreprise progressivement selon le degré
d'insuffisance rénale, jusqu'à 0,6 g/kg/j, sous surveillance de la balance azotée et de l'état nutritionnel.
Le régime comprend deux tiers de protéines d'origine animale, riches en acides aminés essentiels
(AAE). Une réduction des apports protéiques en deçà de 0,6 g/kg/j nécessite l'addition d'AAE. On peut
alors abaisser l'apport protidique jusqu'à 0,3 g/kg/j en y ajoutant des AAE et des céto-analogues d'AAE
[12]. Une telle restriction protidique est compatible avec une balance azotée équilibrée ou positive
pendant des périodes prolongées, sans compromettre le devenir nutritionnel après l’initiation de la
dialyse [13]. La tolérance d’un tel régime nécessite toutefois deux conditions : l’absence d’agression
ou inflammation, qui rendrait impossible l’adaptation aux apports hypoprotidiques, et un apport
énergétique élevé supérieur à 35 kcal/kg/j. L’administration de ces diètes très hypoprotéiques est
toutefois limitée par la disponibilité et la palatabilité des suppléments d’AAE et cétoanalogues.
Dans ces circonstances, il est crucial d’effectuer une surveillance régulière de l’état nutritionnel. Celle-
ci repose sur la mesure du poids corporel, la balance azotée, la créatininurie des 24 h et l’albuminémie
[4]. Le conseil diététique a pour but d’aider au respect des recommandations. En dehors des apports
spécifiques d’acides aminés, des compléments oraux peuvent être utiles [8]. La persistance et, a
fortiori, l'aggravation de la DPE malgré le suivi et les prescriptions hygiénodiététiques doivent faire
commencer rapidement l'épuration extracorporelle [4]. En effet, la DPE et particulièrement l’altération
des marqueurs protéiques de la dénutrition, albumine et transthyrétine (préalbumine), lors de la mise
en dialyse sont des facteurs prédictifs indépendants de la mortalité dans l’année qui suit.
PRÉVENIR ET TRAITER LA DÉNUTRITION CHEZ LE PATIENT DIALYSÉ
Environ 25% des patients hémodialysés présentent une DPE compromettant leur survie à moyen terme

N. J.-M. Cano 5
[14]. La prévalence de la DPE et son impact pronostique sont similaires au cours de l’hémodialyse et
de la dialyse péritonéale. Cette brève mise au point se limite à la DPE du patient hémodialysé. Dans
ce contexte, la relation entre l’IMC et la survie à long terme a suscité un grand intérêt. Dans la
population générale, le risque de mortalité exprimé en fonction de l’IMC décrit une courbe en J ou en
V : le risque le plus faible est observé lorsque l’IMC est entre 20 et 25 et il s’accroît lorsque l’on s’éloigne
de ces valeurs, tant lorsque l’IMC est inférieur à 20 que lors du surpoids et de l’obésité [15]. Chez
l’hémodialysé, le risque domine chez les patients présentant l’IMC le plus bas et décroît
progressivement avec l’augmentation de l’IMC, même lorsque l’IMC dépasse 30 [16]. Diverses
hypothèses ont été avancées pour expliquer cette « reverse epidemiology ». L’importance de la durée
de suivi (14 ans en moyenne dans la population générale et 4 ans chez le patient hémodialysé) a été
démontrée récemment : lorsque la période d’observation est limitée à 7 ans, chez l’hémodialysé
comme dans la population générale, les IMC < 18.5 ont un impact majeur sur la survie alors que
l’obésité a peu d’effet [17]. Dans cette étude, la mortalité à 7 ans était dix fois plus élevée chez les
patients hémodialysés que dans la population témoin. Ainsi, l’IRCT traitée par hémodialyse est
caractérisée par une réduction de l’espérance de survie, un risque élevé de dénutrition et un effet
protecteur du surpoids et plus encore de l’obésité. Une étude multicentrique portant sur 70028 patients
a montré que, plus que l’IMC, la masse musculaire prédisait la survie [18].
PRÉVENIR LA DÉNUTRITION DU PATIENT HÉMODIALYSÉ
Compte tenu de la gravité du pronostic, l’évaluation nutritionnelle doit faire partie du suivi régulier
des patients hémodialysés. Le tableau 3 donne les éléments du suivi du patient hémodialysé d’après
les récentes recommandations européennes [5]. Bien que leurs variations soient influencées par des
paramètres non nutritionnels (inflammation, insuffisance hépatique, variation des secteurs hydriques)
l’albuminémie et la transthyrétinémie mesurées avant dialyse sont des marqueurs incontournables de
l’état nutritionnel. Chez le patient dialysé adulte, les marqueurs suivants prédisent un pronostic
péjoratif à moyen terme et indiquent la nécessité d’une intervention nutritionnelle : IMC < 20,
amaigrissement > 10% du poids corporel en 6 mois , albumine < 35 g.l-1, transthyrétine < 300 mg.l-1
[19].
L’intervention nutritionnelle comprend principalement le conseil diététique, les compléments oraux,
la nutrition parentérale perdialytique (NPPD) et la nutrition entérale. Elle a pour objectif d'assurer des
apports correspondant aux besoins quotidiens : 1,2 à 1,4 g de protéines et 30 à 40 kcal.kg-1.j-1. Le
mode de renutrition sera alors choisi en fonction de son aptitude à couvrir ces besoins, en tenant
compte de l'alimentation spontanée.
Le seul conseil diététique, première étape de l’intervention nutritionnelle, est capable d’améliorer
l’état nutritionnel évalué par l’albuminémie, indépendamment des concentrations sériques de C-
réactive protéine [20]. Six études contrôlées portant sur des patients présentant une DPE documentée
ont montré la capacité des compléments oraux à améliorer l’état nutritionnel ([1] pour revue). Les
compléments nutritionnels oraux (CNO) constituent le principal mode de support nutritionnel. Le
moment de leur prise est à considérer : pendant la dialyse, afin de réduire les anomalies perdialytiques
du métabolisme protéique ; une heure après les repas, afin d’éviter qu’ils ne se substituent à ceux-ci ;
tardivement dans la soirée afin de limiter la durée du jeûne nocturne. Une compliance aux CNO de 60
à 70 % a été observée au cours d’une étude prospective d’une durée d’un an [19].
L’effet de la nutrition parentérale perdialytique (NPPD) sur l’état nutritionnel a fait l’objet de plus de
30 études dont 5 essais prospectifs, contrôlés, randomisés ([1] pour revue). Bien que très hétérogènes
quant aux apports nutritifs, au nombre de patients, à la durée du traitement et aux paramètres
nutritionnels mesurés, ces études ont montré une amélioration des marqueurs nutritionnels étudiés.
Une étude multicentrique, contrôlée et randomisée, a évalué en intention de traiter, pendant un suivi
de 2 ans, les effets du support nutritionnel (complément oral isolé ou associé à une NPPD).

N. J.-M. Cano 6
L’amélioration nutritionnelle en cours de renutrition, quelle qu’en soit la voie, permettait de réduire le
taux d’hospitalisation, le degré de handicap et la mortalité de l’hémodialysé dénutri. En particulier,
l’augmentation de 30 mg/l de la transthyrétinémie pendant les 3 premiers mois de traitement était
associée à un doublement de la survie à 2 ans. La réponse à la renutrition était indépendante du statut
inflammatoire évalué par la C-réactive protéine [19].
Au cours des dénutritions avancées, lorsque les ingesta sont inférieurs à 20 kcal/kg/j, les compléments
oraux et la NPPD deviennent insuffisants pour assurer des apports à la hauteur des recommandations.
On doit alors recourir à une assistance nutritive journalière. Dans cette indication, la nutrition entérale
doit être préférée à la nutrition parentérale. La nutrition entérale peut également être indiquée chez
l’hémodialysé agressé ou en situation periopératoire.
STRATÉGIE DE TRAITEMENT DE LA DÉNUTRITION EN DIALYSE
Toute DPE doit d'abord faire rechercher et traiter une affection intercurrente et une cause d'anorexie
ou de catabolisme. En particulier, on pourra être amené à : corriger une erreur diététique ; optimiser
le programme de dialyse; corriger l’acidose ; corriger l'anémie par l'érythropoïétine ; traiter un état
dépressif. Après cette première étape, une stratégie a été proposée pour la conduite du support
nutritionnel (Tableau 4)[9]. Différentes approches ont été développées afin d’améliorer l’efficacité du
support nutritionnel. La réhabilitation physique permet d’accroître son effet anabolique. En cas de
résistance à un support nutritionnel bien conduit les récentes recommandations européennes
proposent également, en l’absence de contre-indication, le recours à une cure d’androgènes de 3 à 6
mois. De même, la dialyse quotidienne peut être proposée chez les patients dénutris, instables,
tolérant mal les séances de dialyse [5]. Ainsi apparaît l’intérêt d’une approche multimodale de la DPE
de l’hémodialysé, combinant différentes interventions dans le but d’augmenter les ingesta et de
stimuler l’anabolisme protéique.
Conclusion
La dénutrition est fréquente et son incidence sur le pronostic est majeure au cours de l’IRC. La
surveillance régulière des ingesta et de l’état nutritionnel ainsi que le respect des apports
recommandés spécifiques des différents stades de la maladie doivent permettre de prévenir son
installation. La survenue d’un état de dénutrition au cours de l’IRCT est un argument pour l’initiation
de la dialyse. Chez le patient dialysé, la dénutrition justifie l’intensification du conseil diététique et la
mise en route d’un support nutritionnel. L’efficacité de celui-ci peut être accrue par une approche
multimodale intégrant support nutritionnel, exercice et dans certains cas, cure d’androgène ou mise
en route d’une dialyse quotidienne.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%