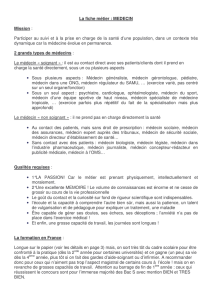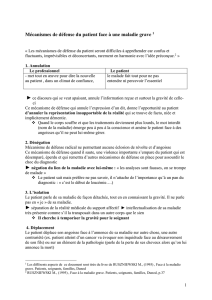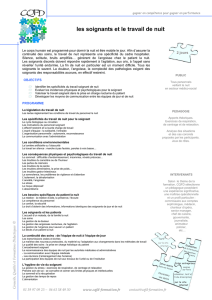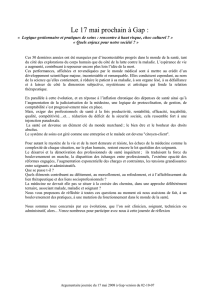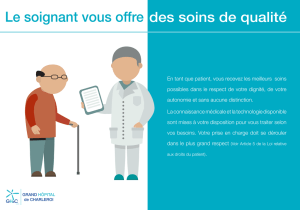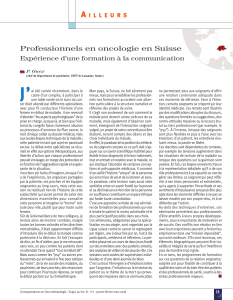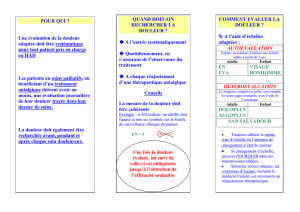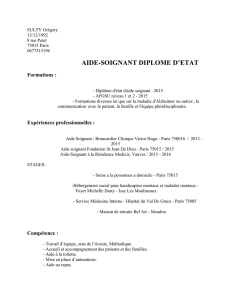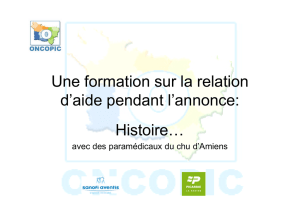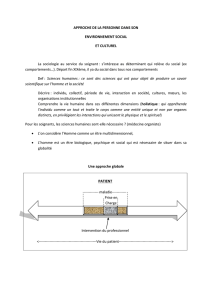Lire l`article complet

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2007
28
être et savoir
La souffrance des soignants
et leurs mécanismes
de défense
❏ I. Moley-Massol*
F
ace au diagnostic de maladie grave, à
une récidive, un échec des traitements, le
médecin est le premier à être confronté à
la violence de la mauvaise nouvelle.
Il est piégé dans une situation paradoxale : être
à la fois le soignant et celui qui inflige au patient
la blessure de la révélation de sa maladie.
Mais c’est d’abord à lui-même que le médecin doit
annoncer la mauvaise nouvelle. Elle le confronte
à ses angoisses en tant que soignant et en tant
que sujet humain.
Le médecin redoute le mal qu’il va “faire” au
malade, craint ses réactions et porte parfois la
culpabilité du “mauvais messager”.
Il s’expose à la détresse et à l’agressivité des
malades, qui, fréquemment associent la mauvaise
nouvelle à celui qui l’énonce.
Dans l’Antiquité, le messager d’une mauvaise nou-
velle était aussitôt exécuté, comme si énoncer un
malheur c’était le faire exister…
Pour le thérapeute aussi, la mauvaise nouvelle est
une épreuve à surmonter ; c’est pourquoi il est
important qu’il apprenne à reconnaître sa propre
souffrance, qu’il s’y autorise, qu’il la respecte.
Face à une maladie incurable et potentiellement
mortelle, le soignant est douloureusement ren-
voyé à ses propres limites, à sa vulnérabilité,
à l’angoisse de sa propre mort, à cette pensée
intolérable, irreprésentable que tout être humain
cherche désespérément à repousser.
Le médecin doit renoncer à l’illusion de la toute-
puissance de la médecine sur la maladie et la mort.
Il ne pourra pas sauver son malade, et pourtant
il ne doit pas démissionner mais rester, peut-
être plus que jamais, présent dans sa relation
au malade : “Accompagnertoujours,soulager
souvent,guérirparfois”disait Hippocrate.
Pour se prémunir de la souffrance du patient et se
protéger de ses propres peurs, le soignant recourt
à des modes de défense psychique qui l’aident à
réduire sa tension émotionnelle et à apprivoiser
la mauvaise nouvelle.
S’il est important d’identifier les mécanismes de
défense des malades, il faut aussi reconnaître
ses propres stratégies de protection, les accepter
comme des réponses légitimes à sa souffrance
de soignant.
Reconnaître sa souffrance, c’est déjà apprendre à
s’en protéger et à se protéger de celle du malade.
En acceptant ses peurs, ses faiblesses, ses
limites, le soignant ouvre un champ nouveau
de sa pratique médicale ; il se libère de telle sorte
qu’il devient finalement plus présent dans sa rela-
tion au patient.
“Detouteslesopérationsdéfensivesquelessoi-
gnantspourrontédifier,lemensongeestàl’évi-
dencelemécanismeleplusentier,leplusradical
etleplusdommageableàl’équilibrepsychique
dumalade”(1).
Par le mensonge, le médecin croit souvent “pro-
téger” le malade. En réalité, le mensonge ne fait
que préserver, temporairement, le médecin de sa
propre angoisse.
* Médecin libéral, praticien attaché à l’hopital
Cochin, Paris, psychothérapeute ;
auteur du livre L’annonce de la maladie ? Une
parole qui engage. Paris, Editions Datebe, 2004.
rcv mars 2007.indd 28 11/04/07 10:16:19

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2007
29
Le mensonge prive le malade d’une représentation
de sa maladie et l’empêche de donner un sens à
ses symptômes. Il n’est pas, dès lors, en mesure
de se préparer psychologiquement à l’évolution
de sa maladie.
Cette attitude ne tient pas compte de la demande
du malade, de ses besoins, de ses ressources
personnelles.
Le mensonge interdit tout échange authentique avec
le malade et empêche d’établir une véritable relation
de confiance entre le soignant et le soigné.
Elle ne tient pas compte de l’importance que revêt
la maladie pour le malade. Pour lui, sa pathologie,
quelle qu’en soit la gravité, n’est jamais “banale”.
Ce n’est pas “rien” !
En s’attachant aux seuls retentissements physiques
de la maladie, le médecin tient à distance les
aspects émotionnels. Il traite le corps malade et
non le patient. Le malade a le sentiment que sa
souffrance n’est pas reconnue. Il est nié en tant
que sujet.
Le soignant, démuni et impuissant face à la
maladie, ne parvient pas à affronter le malade. Il
fuit l’échange véritable avec le patient, dévie la
conversation, évite la rencontre.
Dans son discours, il est fréquemment “hors
sujet”. Il élude, esquive (1), pour éviter sa propre
angoisse.
C’est une forme de mensonge, car elle vise à
entretenir chez le patient qui n’y croit plus, un
espoir impossible.
Le soignant dissimule la vérité et optimise les
résultats des examens. Parfois, le malade feint
de croire les paroles faussement apaisantes
du soignant. Il n’est plus dans une relation de
confiance.
Avec ce mécanisme de défense, le soignant se
parle aussi à lui-même et cherche sa propre réas-
surance.
Le médecin se réfugie derrière un discours médical
hermétique qui lui sert d’écran protecteur vis-à-
vis du malade.
Le jargon médical est utilisé comme une langue
étrangère au malade, qui rend impossible toute
communication.
Le malade est laissé dans l’isolement et l’étrangeté
d’une parole vide de sens. Il n’a aucun mot auquel
se raccrocher.
Ce jargon rassure le soignant. Il lui donne un sen-
timent de puissance.
Le soignant s’agrippe à un registre rationnel. Il
tient à distance les émotions du malade, ainsi
que ses émotions propres, auxquelles il se sent
incapable de faire face.
Dans ce cas, le médecin dit tout au malade, et
tout de suite. Il se décharge d’un fardeau, sans
tenir compte de la demande du malade, de ses
ressources, de son cheminement.
C’est une forme de passage à l’acte verbal, de
fuite en avant qui peut être d’une extrême violence
pour le psychisme du malade, qui en gardera à
tout jamais la trace.
Le soignant, submergé par la charge émotionnelle,
“lâche” l’information et se libère d’une tension.
Tout dire est aussi le moyen de se protéger vis-à-
vis de la loi qui fait obligation d’informer le patient,
mais sans tenir compte de la capacité du patient
à recevoir cette information.
Elle efface la distance médecin-malade. Le soignant,
incapable de faire front, fait corps avec son patient.
Il se met à sa place, sans jamais y être toutefois. Il
n’est plus à l’écoute de l’autre, mais de lui-même.
Accepter sa propre angoisse, comprendre ses fonc-
tionnements de défense, c’est permettre d’instau-
rer une relation de confiance avec le patient, faite
de respect mutuel et d’humilité.
“Seuleunevéritépasàpas,tenantcomptedes
mécanismesdedéfensedusoignantetdusoigné,
estsusceptibled’engendrerunéchangeauthen-
tiqueetéquitable”(1).
Dire l’information difficile à dire ne va pas de soi
et, souvent, ce que nous disons n’est pas ce qui
est entendu. La relation à l’autre comporte une
rcv mars 2007.indd 29 11/04/07 10:16:20

Correspondances en Risque CardioVasculaire - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2007
30
être et savoir
part de malentendu. Il y a toujours un risque de
manquer l’autre dans toute relation.
Parfois, malades et proches reprochent au méde-
cin son manque de communication, d’empathie,
en des termes qui peuvent être reçus par le soi-
gnant comme une grande violence, et avec un fort
sentiment d’injustice.
Comment trouver alors l’énergie psychique qui
permette de surmonter cette épreuve à la fois
personnelle et relationnelle ? Comment trouver
la bonne distance, la “distance bonne” selon Paul
Ricoeur, entre trop grande neutralité et trop grande
empathie, qui toutes deux conduisent à une forme
de surdité ?
Comment rester présent, à l’écoute du malade
et à l’écoute de soi-même, de ses réactions,
de ses émotions ?
Le médecin a lui aussi besoin d’être reconnu,
écouté, entendu.
Ce respect de lui-même passe aussi par l’accep-
tation de ses limites, sans culpabilité.
Freud disait : “Ilyatroismétiersimpossibles,
gouverner,enseigner,psychanalyser”. Il aurait
pu ajouter, soigner.
Alors, forts de la conscience de nos limites, effor-
çons-nous d’être suffisamment bons en tant que
soignants. C’est déjà beaucoup.
RéféRence bibliogRaphique
1.M.Ruszniewski.Faceàlamaladiegrave.Patients,famille,
soignants.Paris:Dunod,1999.
Imprimé en France - EDIPS - 21800 Quetigny
Dépôt légal à parution
© novembre 2003 - DaTeBe SAS
Les articles publiés dans Correspondances en Risque CardioVasculaire le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
rcv mars 2007.indd 30 11/04/07 10:16:20
1
/
3
100%