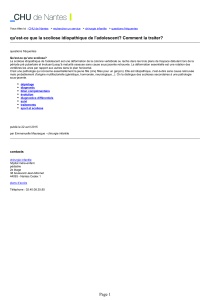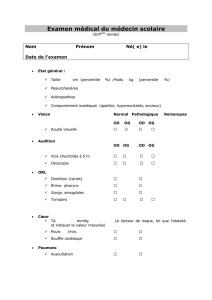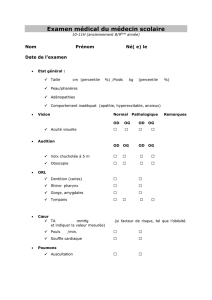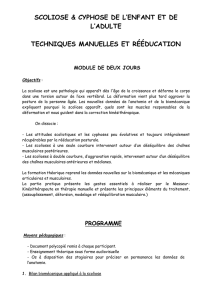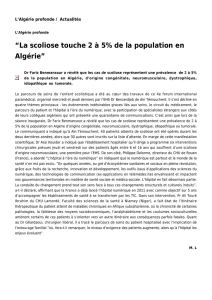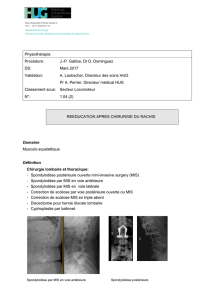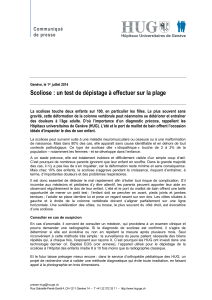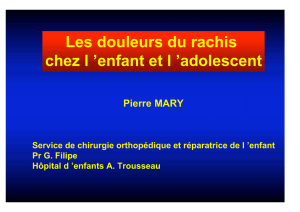Lombalgiedu sujet âgé : le cas méconnu de la scoliose adulte

A. Faundez
S. Genevay
Adult scoliosis : a misknown etiology of
low back pain in the elderly population
Degenerative scoliosis is often unapprecia-
ted in all-day clinical practice, however more
and more frequent in the elderly population
and deserves particular attention. This article
aims to provide practitioners with practical
guidelines to track these patients, organise
radiological assessment in accordance with
clinical situations, and implement an ade-
quate therapeutic strategy.
Rev Med Suisse 2010 ; 6 : 1358-62
La scoliose adulte est une situation méconnue, fréquemment
rencontrée dans la population âgée et qui mérite une atten-
tion particulière. Cet article a pour but de fournir aux praticiens
les éléments nécessaires pour dépister ces patients, réaliser le
bilan radiologique adéquat en fonction des situations cliniques
et mettre en place une stratégie thérapeutique adéquate.
Lombalgie du sujet âgé : le cas
méconnu de la scoliose adulte
pratique
1358 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 juin 2010
Dr Antonio Faundez
Service de chirurgie orthopédique
et traumatologie de l’appareil moteur
Département de chirurgie
Dr Stéphane Genevay
Service de rhumatologie
Département de médecine interne
HUG, 1211 Genève 14
Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 juin 2010 0
vignette clinique
Une femme de 68 ans consulte en 2007 pour une lombalgie
irradiant dans le membre inférieur droit selon un trajet non
radiculaire, devenue constante depuis quatre ans et plus
importante depuis deux ans. La lombalgie limite le péri-
mètre de marche à 30 minutes et la patiente décrit une dif-
ficulté à se redresser.
L’anamnèse systématique révèle une hypertension bien
contrôlée, un alcoolisme chronique avec plusieurs tentati ves
de sevrage et une thymie dépressive. Il n’y a pas d’élé-
ment pour une lombalgie spécifique.
L’état général est diminué, l’expression un peu ralentie et
le faciès triste. Il existe un discret trouble statique clinique-
ment réductible, un syndrome lombo-vertébral discret sans
limitation d’amplitude et aucun élément pour un syndro me radiculaire.
Le diagnostic de lombalgie chronique avec probable composante de camp-
to cormie (faiblesse musculaire des érecteurs du tronc) dans un contexte
d’alcoolisme chronique est retenu, l’antalgie est adaptée et une prescription
de physiothérapie active incluant des exercices de gainage, de proprioception
et d’endurance est délivrée.
La patiente reprend contact deux ans plus tard. Les symptômes se sont ag-
gravés, l’antalgie est inefficace, le périmètre de marche est à 100 mètres et les
déplacements au domicile sont difficiles.
A l’examen clinique, on est frappé par une importante cyphoscoliose lom-
baire que l’on retrouve sur la radiographie (figure 1).
généralités
La lombalgie du sujet âgé (après 65 ans) reste fortement méconnue. Les don-
nées épidémiologiques à disposition sont hétérogènes1 mais la diminution de
prévalence au-delà de 65 ans, fréquemment citée dans les revues, ne semble
concerner que les cas bénins.2
Le diagnostic différentiel des lombalgies est identique quel que soit l’âge (ta-
bleau 1). Plus le patient est âgé, plus la prévalence d’une néoplasie primaire ou
secondaire est augmentée. De même, une attention particulière doit être portée
pour la détection de tassements vertébraux afin d’en améliorer la prise en charge
et débuter un traitement anti-ostéoporotique. Lorsque la lombalgie s’accom-
pagne d’une irradiation dans les membres inférieurs, on recherchera des arguments
cliniques pour une claudication neurogène (tableau 2), seule manifestation cli-
38_42_34977.indd 1 24.06.10 09:16

Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 juin 2010 1359
nique clairement liée à un canal lombaire rétréci. A cet âge,
les syndromes radiculai res (tableau 2) semblent moins
fréquents, impliquent plus volontiers les racines L3 ou L4
et sont plus souvent liés à un rétrécissement foraminal
d’origine dégénérative qu’à une hernie discale.
Pour les autres présentations cliniques, de loin les plus
fréquentes, il n’existe actuellement aucun argument cli-
nique permettant de déterminer si une structure anato-
mique spécifique (par exemple une articulation interapo-
physaire postérieure) est à l’origine des douleurs 3 ou s’il
s’agit d’un problème de dysfonctionnement musculo-sque-
lettique comme c’est le plus souvent le cas lors de lombal-
gie commune du sujet jeune.4 Quelques études cliniques
réalisées à partir de blocs anesthésiques suggèrent ce-
pendant une participation plus fréquente des articula-
tions interapophysaires postérieures.5 Parmi ces patients
âgés au tableau clinique mal défini, un sous-groupe pré-
sente radiologique ment une scoliose de novo comme dans
la vignette clini que. Relativement peu prévalents dans la
population géné rale, ces patients représentent plus du
quart des patients âgés consultant un spécialiste et méri-
tent une attention particulière.
scoliose de l’adulte : éléments cliniques
Chez le sujet adulte, la scoliose peut avoir plusieurs
étiologies (tableau 3). Les déformations les plus fréquen-
tes sont les scolioses de novo et les scolioses
secondaires
de
l’adulte, mais il n’est pas rare de rencontrer des situations
à étiologie mixte.6 Comme toutes les scolioses, celles de
l’adulte sont définies radiologiquement par un angle de
Cobb supérieur à 10°. Elles concernent plus fréquemment
le segment lombaire des femmes dès la quarantaine. Leur
expression clinique est variée. Le plus souvent, il s’agit de
Symptômes et LR* LR
signes évocateurs si présent si absent
Infection
Spondylodiscite • Fièvre, frissons 25 0,5
Abcès épidural • Percussion douloureuse 2,1 0,23
Endocardite • Perte de poids
• Baisse de l’état général
Fracture
Trauma à haute • Traumatisme récent : 2 0,82
vélocité – L 50 ans 2,2 0,26
Ostéoporose – L 70 ans 5,5 0,81
• Corticostéroïdes 12 0,94
• Antécédent de fracture
• Ostéoporose connue
Néoplasie
Osétome ostéoïde • Antécédent néoplasique 15,5 0,7
Myélome multiple • Pas d’amélioration au repos 1,7 0,21
Métastase • Au moins un des suivants : 2,5 0,0
– L 50 ans, perte de
poids, antécédent +,
pas d’amélioration
sous traitement
Spondylarthro-
pathie
Spondylarthrite • l 40 ans 1,07 0,0
ankylosante • Sexe
Rhumatisme • Lombalgie inflammatoire
psoriasique • Autres symptômes
évocateurs
Tableau 1. Diagnostic différentiel d’une lombalgie
LR : likelyhood ratio (tiré de Durie Best, 2005).
Tableau 2. Définitions
Syndrome radiculaire
Douleur qui suit un dermatome, éventuellement avec des caractéristiques
neurogènes. Accompagnée de signes irritatifs (Lasègue, Lasègue inversé
ou Lasègue contro-latéral) et/ou de déficits neurologiques correspondant
au dermatome (sensitif, moteur ou réflexe)
Claudication intermittente neurogène
Irradiation dans un ou deux membres inférieurs apparaissant après un
périmètre de marche relativement fixe, soulagée par la flexion anté-
rieure du tronc ainsi que par la position assise. Pas de soulagement en
station debout immobile. Une lombalgie n’est pas nécessaire mais peut
être présente
Figure 1. Radiographie de la colonne lombaire de face de la même patiente
A. 2003. B. 2007. C. 2009.
BA C
38_42_34977.indd 2 24.06.10 09:16

lombalgies mécaniques mais celles-ci peuvent prendre un
caractère inflammatoire (souvent lors de la présence conco-
mitante d’un œdème dans les plateaux vertébraux), s’ac-
compagner de radiculalgie ou de claudication neurogène.
Les symptômes de compression neurologique peuvent être
unilatéraux, par compression du côté concave ou par éti-
rement du côté convexe.
L’examen clinique s’attachera à vérifier l’horizontalité
du bassin, le patient en position debout. Une inégalité de
longueur des membres inférieurs peut parfois être un fac-
teur décompensant des lombalgies sur scoliose. L’ampli-
tude articulaire des hanches et des genoux doit également
être testée : une coxarthrose responsable d’un flexum peut
également être un facteur décompensant de douleurs et
représente une priorité dans la prise en charge chirurgi-
cale globale de ces patients. C’est en flexion, bras tendus,
que l’on repère le mieux une gibbosité lombaire, thoraco-
lombaire ou thoracique dans le cas d’anciennes scolioses
idiopathiques de l’adolescent. Il faut également observer
l’équilibre global du patient dans le plan frontal (aligne-
ment des ceintures pelvienne et scapulo-thoracique) et
sagittal (lordose, cyphose). Les patients les plus sympto-
matiques seront ceux qui présentent une déformation en
cyphoscoliose : ils marchent penchés en avant (cyphose)
et penchés sur le côté (déviation de la ceinture scapulo-
thoracique par rapport au bassin, due à la scoliose). La dé-
pense d’énergie pour ces patients est énorme, car ils luttent
constamment pour ne pas tomber en avant. Dans le cadre
d’une consultation spécialisée, nous nous attacherons
également à tester cliniquement la réductibilité de la sco-
liose. L’examen clinique neurologique est par contre le plus
souvent normal.
bilan radiologique
La scoliose dégénérative se manifeste le plus souvent
par une lombalgie de type mécanique qui se distingue
peu de la lombalgie commune. Un bilan radiologique est
souvent prescrit dans l’idée d’éliminer un tassement ver-
tébral dans une population à risque ou lorsque l’examen
clinique suggère un trouble statique, déséquilibre frontal
ou gibbosité. L’évaluation comporte toujours des clichés
standards, patient debout. Il faut distinguer l’attitude sco-
liotique, déviation posturale, de la vraie scoliose caracté-
risée par une rotation des corps vertébraux (les pédicules
sur la radiographie de face ont une taille apparente asy-
métrique et les apophyses épineuses ne sont pas alignées).
Dans le cas de scoliose dégénérative, les corps vertébraux
conservent un aspect carré (sauf en présence de tassement
ostéoporotique) et n’ont pas la forme trapézoïde typique-
ment rencontrée lorsque la scoliose a débuté dans l’ado-
lescence. Le cas échéant, l’équilibre général sera évalué
par des clichés de colonne totale de face et de profil.
En cas de syndrome radiculaire persistant ou de claudi-
cation neurogène invalidante, une IRM est utile afin de pré-
ciser la localisation et l’étendue de la sténose ainsi qu’une
éventuelle hernie discale associée.
traitements conservateurs
Il n’existe aucune littérature spécifique de qualité con-
cernant l’efficacité des traitements pharmacologiques ou
physiothérapeutiques dans cette indication. On se basera
donc par analogie à ce qui se fait dans les syndromes
proches, lombalgies non spécifiques, radiculopathie par
hernie discale ou claudication neurogène sur canal lom-
baire rétréci. Il est important, comme lors de lombalgies non
spécifiques, de dépister et de prendre en charge active-
ment les principaux facteurs de risque de chronicisation
que sont l’anxiété, la dépression, alors que le catastro-
phisme et la kinésiophobie ne semblent pas être des fac-
teurs prépondérants dans cette catégorie d’âge.7 En cas
de situations complexes, un spécialiste rhumatologue ou
rééducateur aidera à la mise en place d’une prise en
charge multidisciplinaire et guidera le choix de la physio-
thérapie (gainage, étirements neuroméningés, McKenzie,
endurance, délordose, proprioception…). L’utilité de l’in-
filtration (par exemple péridurale en cas de claudication
ou de radiculalgie, ou facettaire en cas de lombalgies loca-
lisées) doit être évaluée grâce à une synthèse clinico-ra-
diologique compte tenu de la fréquence importante d’ano-
malies radiologiques dans la population asymptomatique.8
Une prudence particulière est de mise pour les infiltrations
périradiculaires (dites aussi foraminales) en raison des
effets secondaires rares mais graves (cas de paraplégies)
récemment rapportés.9 Outre l’aspect thérapeutique po-
tentiel, les infiltrations ciblées et bien évaluées apportent
des renseignements utiles lors d’une éventuelle décision
chirurgicale.
Le port d’un corset pourra être discuté même si l’on ne
peut certainement pas en attendre l’effet structurel (ralen-
tissement de l’évolution) espéré chez l’adolescent. Son
but est donc antalgique, par stabilisation mécanique. Le
plus souvent, nous proposons des corsets de type BOB
(Boston overlap brace)
puisque les scolioses dégénératives
sont le plus souvent lombaires. L’efficacité est limitée lors
de déséquilibre sagittal ou frontal important et il n’y a pas
d’indication à immobiliser en corset un patient avec une
prédominance de douleur radiculaire ou de claudication
neurogène.
quand référer un patient au
chirurgien ?
Un avis chirurgical est de rigueur lorsque le patient pré-
1360 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 juin 2010
Type de scolioses Etiologies Sommets de
de l’adulte courbure
Scoliose de novo Dégénérescence discale Lombaire ou
(dégénérative primaire) et facettaire asymétrique thoraco-lombaire
Scoliose progressive Scoliose idiopathique Thoracique,
de l’adolescent ayant progressé chez thoraco-lombaire,
l’adulte lombaire
Scoliose secondaire • Pelvis oblique, inégalité Thoraco-lombaire,
de l’adulte de longueur des lombaire, lombo-sacré
membres inférieurs
• Trouble du métabolisme
osseux (ostéoporose…)
Tableau 3. Classification des scolioses de l’adulte
38_42_34977.indd 3 24.06.10 09:16

ans. Une radiographie de colonne totale doit être ordon-
née, mais on remarque déjà sur le cliché lombaire de
face qu’il existe une déviation importante du tronc sur
la droite. L’anomalie a pris son origine en L4-L5 où l’on
constate une dégénérescence asymétrique avec trans-
lation et rotation de L4 sur L5 (scoliose adulte de novo).
Il s’agit donc d’une déformation originellement concen-
trée sur un segment, avec une déviation compensatoire
de la colonne lombaire sus-jacente. Ces déformations
très courtes sont en général très symptomatiques et
présentent un fort potentiel d’évolution. La probléma-
tique prédominante étant une cyphoscoliose déséqui-
librée et douloureuse avec risque important d’aggrava-
tion, il faudra proposer à la patiente une chirurgie de
correction et de stabilisation. L’étendue du montage dé-
pendra de la réductibilité de la courbure compensatrice
et devra être encore précisée par des clichés en incli-
naison. Le canal rachidien devra encore être exploré ra-
diologiquement puisque la patiente souffre d’une irra-
diation dans le membre inférieur droit.
1362 Revue Médicale Suisse
–
www.revmed.ch
–
30 juin 2010
Implications pratiques
Parmi les patients âgés lombalgiques, certains présentent une
scoliose de novo et nécessitent une prise en charge spécifi-
que
L’anamnèse et l’examen clinique sont les éléments qui permet-
tent de repérer les différents syndromes (syndrome lombo-
vertébral, radiculaire, claudication), d’ajuster le bilan radiolo-
gique et de guider l’approche thérapeutique
Le type de physiothérapie et le choix des infiltrations doivent
être guidés par la clinique
Le corset fait partie des possibilités thérapeutiques lorsqu’il
n’y a pas de déséquilibre statique important
Un avis chirurgical doit être requis lorsqu’il existe un désé-
quilibre statique important ou lors d’une évolution clinique
défavorable
>
>
>
>
>
1 Bressler HB, Keyes WJ, Rochon PA, Badley E. The
prevalence of low back pain in the elderly. A systematic
review of the literature. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24:
1813-9.
2 Dionne CE, Dunn KM, Croft PR. Does back pain
prevalence really decrease with increasing age ? A sys-
tematic review. Age Ageing 2006;35:229-34.
3 * Cohen SP, Raja SN. Pathogenesis, diagnosis, and
treatment of lumbar zygapophysial (facet) joint pain.
Anesthesiology 2007;106:591-614.
4 ** Waddell G. Low back pain : A twentieth century
health care enigma. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:2820-5.
5 * Bogduk N, Dreyfuss P, Govind J. A narrative review
of lumbar medial branch neurotomy for the treatment
of back pain. Pain Med 2009;10:1035-45.
6 ** Aebi M. The adult scoliosis. Eur Spine J 2005;
14:925-48.
7 Kovacs F, Abraira V, Cano A, et al. Fear avoidance
beliefs do not influence disability and quality of life in
Spanish elderly subjects with low back pain. Spine (Phila
Pa 1976) 2007;32:2133-8.
8 Kalichman L, Li L, Kim DH, et al. Facet joint os-
teoarthritis and low back pain in the community-based
population. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:2560-5.
9 * Wybier M, Gaudart S, Petrover D, Houdart E,
Laredo JD. Paraplegia complicating selective steroid in-
jections of the lumbar spine. Report of five cases and
review of the literature. Eur Radiol 2009;20:181-9.
* à lire
** à lire absolument
Bibliographie
sente des signes cliniques de déséquilibre frontal et sagittal,
et en particulier en cas d’association avec des symptômes
de claudication neurogène. La consultation n’aboutira pas
systématiquement à une sanction chirurgicale, mais permet-
tra au chirurgien de prendre connaissance de la situation
et de planifier un suivi radio-clinique. La fréquence du suivi
radiologique dépend des symptômes et de leur répercus-
sion sur la qualité de vie, de l’appréciation radiologique
de l’équilibre dans les deux plans, et des signes radiolo-
giques d’instabilité (olisthésis, dislocation rotatoire, pré-
sence ou non d’ostéophytes pontant les disques, etc.). Si
le risque d’évolution est jugé élevé, une radiographie de
colonne totale sera ordonnée six mois plus tard. Un an ou
plus si le risque est faible. Si une intervention chirurgicale
est envisagée, le bilan sera fréquemment complété par
des clichés en flexion, extension et inclinaisons habituel-
lement réalisés en présence du chirurgien qui effectue
des manœuvres destinées à tester la réductibilité de la
déformation. On recourt également à la myélo-sacco-radi-
culographie avec coupes CT afin d’obtenir une excellente
représentation en 3D.
La prise en charge chirurgicale dépendra du type et de
l’intensité des symptômes ressentis par le patient, et de
leur répercussion sur sa qualité de vie. Diverses options
chirurgicales peuvent être choisies, en s’efforçant toujours
d’être le moins agressif possible avec des patients dont
l’âge peut parfois être très avancé. L’étendue de la chirur-
gie va donc varier selon si le problème clinique prédomi-
nant de la scoliose est un trouble majeur de l’équilibre, avec
lombalgies plus ou moins sévères, ou si c’est plutôt une
douleur radiculaire dans le contexte d’une scoliose bien
équilibrée dans les plans frontal et sagittal. Dans le premier
cas, on s’orientera vers une chirurgie de plusieurs heures
qui consistera à réduire la déformation et à en rétablir
l’équilibre sagittal et frontal, afin de redonner une autono-
mie à la marche. Dans le deuxième exemple, une décom-
pression segmentaire à minima sera préférée pour éviter
de déstabiliser la colonne vertébrale.
vignette clinique : attitude
L’évolution clinique et radiologique chez cette patiente
est nettement défavorable sur une période de deux
38_42_34977.indd 4 24.06.10 09:16
1
/
4
100%