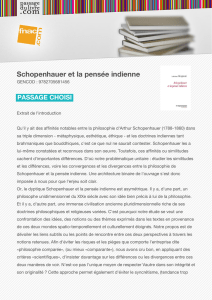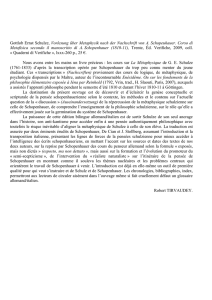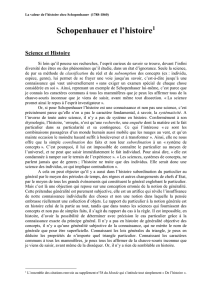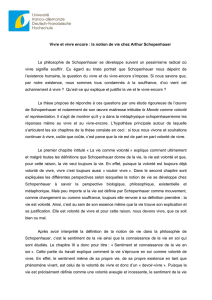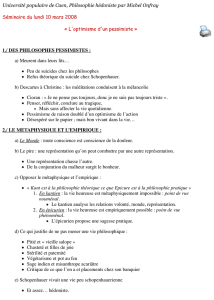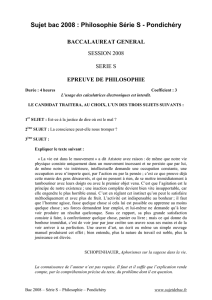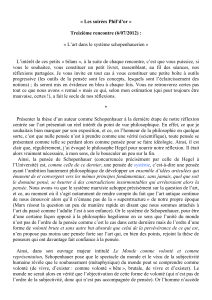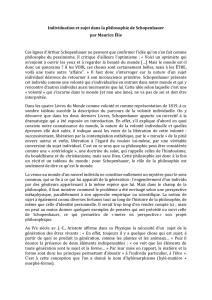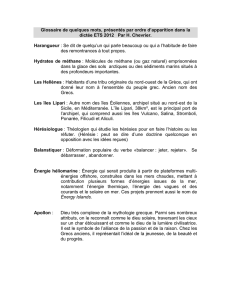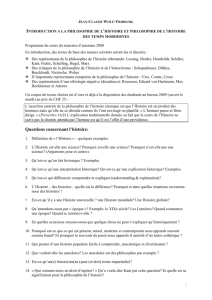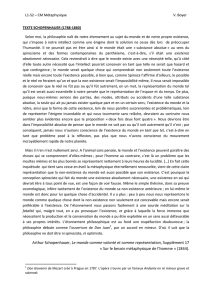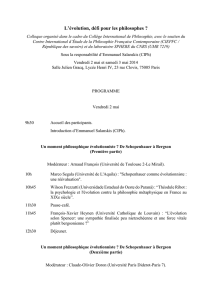INDIVIDU ET MORT DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER

INDIVIDU ET MORT
DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER
par le Rév. Père LEDURE, membre correspondant
La question de la mort dans la philosophie de Schopenhauer ne relève
pas de la pure érudition. Elle n'est pas de l'ordre du détail que l'on peut
ignorer dans la problématique d'ensemble de l'œuvre de ce penseur soli-
taire qu'a été et que demeure Schopenhauer. La mort est une pièce maî-
tresse dans la réflexion schopenhauerienne, car elle porte sur l'essentiel, la
béatitude.
Par ailleurs la problématique de Schopenhauer présente un autre
intérêt, celle d'amorcer ce que l'on a appelé depuis la modernité. Sa
réflexion sur la mort met en jeu de nouveaux paramètres, des critères neufs
qui donnent de l'homme et du monde une nouvelle compréhension. Sa
réflexion sur la mort ouvre l'homme à son irrationnel, à ce qu'il ne peut
plus maîtriser par les lumières de la raison.
I
La mort comme parole de l'homme
La réflexion de Schopenhauer sur la mort s'inscrit en rupture par
rapport à la grande tradition d'Epicure. L'auteur de «La lettre à Menecée»
voit une incompatibilité entre la mort et nous les humains, pétris de sensibi-
lité.
Il ne cesse de répéter que la mort n'est rien pour nous. Jean Bollack (1)
a montré la profonde originalité d'une telle pensée, à condition de la
dépouiller de ses pseudo-évidences, de ses interprétations plates et faciles.
Pour comprendre Epicure, il faut redonner au texte son intégrité. Il
importe de retrouver l'orthodoxie du texte pour en mesurer la vigueur.
Contrairement à ce qui est couramment affirmé, Epicure ne définit pas la
mort comme le rien. Il n'exprime pas une pensée nihiliste qui se hâterait
d'évacuer la mort dans le néant. Plus subtilement - comme si la mort ne
relevait d'aucune évidence mais qu'elle n'épelait que des nuances - Epicure
affirme que la mort est «rien pour nous» (2). Cette remarque ne définit pas
(1) Jean Bollack : La pensée du plaisir - Epicure, textes moraux, commentaires, Paris, édi-
tions de Minuit, 1975.
(2) Maxime 2.
157

INDIVIDU ET MORT DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER
la mort en elle-même, pour elle même, dans son homogénéité spécifique.
Elle situe la mort par rapport à nous. La réflexion d'Epicure porte moins
sur la nature de la mort - cet imprenable - que sur la relation homme-mort.
Epicure dresse un constat. Entre Phomme, être sensible et la mort, fin de
toute sensation, ne fonctionne aucune communication. Il n'y a pas pas-
sage,
car ce sont deux univers qui s'excluent mutuellement. On ne commu-
nique pas de l'un à l'autre, car rien ne relie ces deux espaces séparés par le
vide.
Le «rien» dont parle Epicure ne porte pas sur la mort. Il concerne
l'espace entre l'homme et la mort où il n'y a rien.
Remarquons qu'Epicure reprend les très anciennes traditions reli-
gieuses qui voyaient dans la mort un monde spécifique n'ayant rien
d'humain. Les morts habitaient un univers particulier - le Sheol, l'Hadés,
les Enfers - que rien ne reliait à la terre des hommes. L'interdiction que
pose la Bible d'invoquer les morts ne fait que codifier cette non-
communication. La nécromancie qui prétend invoquer les morts est décla-
rée pratique idôlatrique. On trouve encore des traces dans l'Evangile de
cette très ancienne représentation, notamment dans la parabole du pauvre
Lazare et du mauvais riche (Luc 16, 19 sq). La même approche de la mort
est perceptible dans l'ancienne religion égyptienne. En effet les grandes
sépultures royales comme les pyramides, se referment hermétiquement sur
le défunt. La tombe est conçue de telle façon qu'elle ne puisse plus être
ouverte. Cette architecture porte en elle une très grande signification reli-
gieuse. Les morts dessinent un espace spécifique, inviolable qui ne commu-
nique plus avec celui des vivants.
Epicure rejoint ces traditions religieuses lorsqu'il affirme l'impossibi-
lité de communiquer avec les morts. Dans cette perspective la mort
n'appartient plus à l'espace humain; elle en trace la limite extérieure,
l'in-
franchissable. Elle sort du champ expérimental humain. Le sage est celui
qui reconnaît cette réalité, qui accepte l'impraticable de la mort. Epicure
exhorte l'homme à entrer dans cette problématique lorsqu'il écrit :
«Familiarise-toi avec la pensée que la mort n'a aucun rapport avec nous...
puisque lorsque nous existons la mort n'est pas présente, alors nous n'exis-
tons pas» (3).
Jankélévitch, dans la lignée d'Epicure, dira de la mort qu'elle est
l'impensable, ce qui ne peut être pensé parce qu'elle n'offre aucun contenu
au penser. La mort ne désigne pas la pensée du rien - elle tomberait alors au
niveau de l'objet nihiliste - elle détermine le rien de la pensée. Car la pensée
s'annule en essayant de ne rien penser, de penser sur rien. Ce qui signifie
(3) Lettre à Ménécée - § 124-125.
158

INDIVIDU ET MORT DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER
que de la mort, il n'y a rien à penser. Elle défie et délie la pensée. «Par rap-
port à la mort, écrit Jankélévitch, le mieux que je puisse faire, c'est de ne
pas chercher à y penser parce qu'il n'y a rien à penser en elle, rien à dire.»
(4)
Voici la mort frappée en quelque sorte de mutisme. Elle est réduite au
silence. Et pourtant elle anime la réflexion philosophique, mais à titre de
non-dit du discours. Sous-jacente au propos philosophique, la mort pèse
comme la menace qui met en danger la pensée et que la pensée refoule de
son discours conscient.
Schopenhauer rompt cette tradition de silence dont la philosophie
entourait depuis Epicure la mort. Non pas en ce qu'il parle de la mort, ce
que chaque grande philosophie accomplit à sa façon. Avec Schopenhauer,
la mort est une parole humaine qui concerne le vivant. Elle ne définit plus
une situation-limite, l'au-delà du sensible qui menace de l'extérieur la vie.
Schopenhauer opère un déplacement de la mort et la ramène dans «l'intra
muros» de l'expérience humaine. Elle ne désigne plus l'au-delà de la vie,
mais une modalité de son fonctionnement. De ce fait elle redevient parole
humaine.
Schopenhauer obtient ce désenclavement en opérant une distinction
très nette entre mort et décès. Pour lui la mort ne s'identifie pas à l'acte de
mourir, elle ne se réduit pas à la fin, elle ne se concentre pas dans cet ultime
de la vie. La mort de l'homme se distingue du mourir biologique commun à
tout vivant animal, en ce qu'elle relève de la pensée. Entre le mourir biolo-
gique et la mort au sens propre se profile la distance de l'idée. C'est la cons-
cience qui transforme le mourir en mort et lui donne dimension spirituelle,
spécifiquement humaine. «L'animal ne connaît la mort, écrit Schopen-
hauer, que dans la mort même; l'homme marche chaque jour vers elle en
pleine conscience et cela fait planer un doute sur la vie, même chez celui qui
n'a pas encore compris qu'elle est faite d'une succession d'anéantissement.
Cette préscience de la mort est le principe des philosophies et des
religions.» (5)
Ce texte nous livre en résumé toute la problématique de la mort chez
Schopenhauer. En ne se réduisant pas au décès biologique, la mort devient
un fait de conscience. Mais cette idée de la mort que l'homme a en propre,
rejaillit sur sa vie qui ne saurait plus se comprendre simplement et unique-
ment comme un organisme biologique. Le fait que l'homme connaisse la
(4) Quel Corps ? Paris, François Maspéro, petite collection Maspéro, 1978, p. 39.
(5) Le Monde comme volonté et comme représentation, trad. A. Burdeau, revue par Roos,
Paris PUF, 1966, § 8, p. 67.
159

INDIVIDU ET MORT DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER
mort «macht das Leben bedenklich». Il importe ici de passer par le texte
original allemand pour saisir la vigueur de cette pensée. La pensée de la
mort fait peser un doute sur la vie qui perd son homogénéité opaque, son
évidente densité. Ce doute qui pèse sur le biologique n'est plus la menace
extérieure du mourir, mais le fait que la pensée - Denken - s'exerce sur lui.
La mort oblige ainsi la vie à se mettre à penser, à devenir une fonction pen-
sante. Quand la mort n'est rien d'autre que l'acte final d'une existence, elle
appartient à l'ordre naturel, comme l'admettent les Stoïciens. Il faut s'y
résigner ! Mais en faisant du mourir biologique un événement de la pensée,
en anticipant le décès dans l'idée de la mort, tout change. Car alors la mort
n'est plus l'ultime de la sensibilité, mais ce qui met la vie en exercice de pen-
sée.
Elle ne réduit plus la vie humaine à un ensemble de fonctions biologi-
ques,
mais la contraint à un travail de pensée. La vie franchit un seuil pour
devenir événement spirituel.
C'est en ce sens que l'on peut dire que la mort met la vie en état de
penser. Elle est ce qui inspire toute pensée, et plus particulièrement la phi-
losophie. La mort rejoint le «es», le «ça» indiscible de Heidegger qui parle
en l'homme, qui fait de l'homme un être parlant, le seul de tous les vivants.
La mort en faisant «penser» la vie, instaure la différence entre l'homme et
l'animal. Elle devient à proprement parler avènement de l'esprit.
Dans la perspective de Schopenhauer la mort, en tant qu'idée du
mourir, n'est plus l'au-delà de toute communication, comme chez Epicure,
mais au contraire la fondamentale, pourrait-on dire, de tout vécu humain.
Elle met en question - Bedenklich - ce vécu dans son écoulement incessant
pour se penser en fonction d'un avenir, d'une fin. L'homogénéité du vécu
est brisée par la pensée de la mort. Loin d'être im-pensable, la mort est ce
qui donne à penser à la vie. Elle désigne l'occupation essentielle de
l'homme en ce qu'elle le met en différence d'avec l'animal. Elle garde
l'homme à sa vocation de différence. «Excepté l'homme, aucun être ne
s'étonne de sa propre existence» précise Schopenhauer (6).
Donnant à penser, la mort construit l'espace de la pensée. Elle est la
patrie de la pensée. Sans elle, il n'y aurait probablement pas de philoso-
phie,
note Schopenhauer (7). Bien des prolongements pourraient être tirés
à ce niveau. Dans une société comme la nôtre qui évacue et marginalise la
mort, quelle réalité a encore la pensée ? Si mort et pensée se joignent pour
créer l'espace de toute culture, on est en droit de se demander si une société
qui refoule la mort dans des lieux spécifiques à l'extérieur de la cité, est
(6) Le Monde, suppléments, § 17, p. 851.
160
(7) Le Monde, suppléments, § 41, p. 1203.

INDIVIDU ET MORT DANS LA PHILOSOPHIE DE SCHOPENHAUER
encore en mesure de créer un lieu de penser. Une société qui vit uniquement
au présent sans l'idée de la fin, s'interdit tout dépassement de l'instant. Le
chemin de la culture lui est barré, car elle ne projette aucun avenir. Autant
dire qu'elle n'a pas d'avenir devant soi, puisqu'elle ne se pense pas en fonc-
tion d'une fin.
II
Vouloir-vivre universel et vie individuelle
La mort ne saurait donc, dans la perspective de Schopenhauer, être le
refoulé, ce que l'on oublie. Tout au contraire, elle est parole en l'homme.
Elle fait du vivant qu'est l'homme un humain qui vit avec la certitude de la
mort. Ainsi commence la fonction pensante de la vie qui ne se réduit plus
au présent jouisseur. Mais cette certitude de la mort n'empêche-t-elle pas la
vie de s'épanouir, de se développer ? Car la mort donnant à penser, rend de
ce fait la vie incertaine d'elle-même. Or, affirmera Schopenhauer, c'est
encore la pensée qui réconciliera mort et vie en permettant la maîtrise du
mourir.
«Chez l'homme a paru, avec la raison, par une connexion nécessaire,
la certitude effrayante de la mort. Mais, comme toujours dans la nature, à
côté du mal a été placé le remède ou du moins une compensation; ainsi
cette même réflexion, source de l'idée de la mort, nous élève à des opinions
métaphysiques, à des vues consolantes, dont le besoin comme la possibilité
sont également inconnus à l'animal. C'est vers ce but surtout que sont diri-
gés tous les systèmes religieux et philosophiques/Ils sont ainsi d'abord
comme le contrepoison que la raison, par la force de ses seules médiations,
fournit contre la certitude de la mort.» (8)
Ce texte manifeste à souhait l'ambivalence, il faudrait dire l'ambi-
guïté de la pensée. Dans la problématique de Schopenhauer, l'acte de pen-
ser remplit une double fonction. Il éveille l'homme à sa fin, à son mourir.
La pensée, pourrait-on dire, garde l'homme à la conscience de son avenir.
Mais d'un autre côté, c'est encore la pensée qui permet de vivre avec la cer-
titude de la mort. Schopenhauer inaugure ainsi un nouveau type de penser
philosophique qui intègre l'irrationnel, c'est-à-dire ce que l'on ne peut pas
penser «radicalement», à savoir, la mort. La question qui se pose à nous est
donc la suivante : comment la pensée, après avoir éveillé l'homme à sa
mort, peut-elle maîtriser ce qui lui échappe, à savoir le mourir ?
161
(8) Le Monde, suppléments, § 41, p. 1203.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%