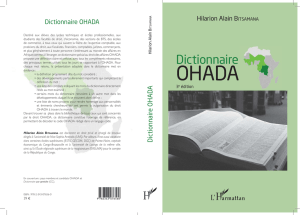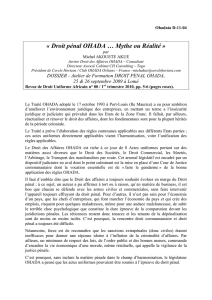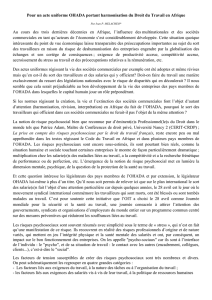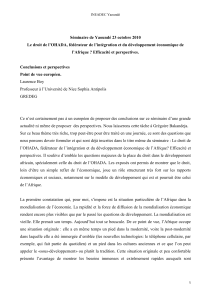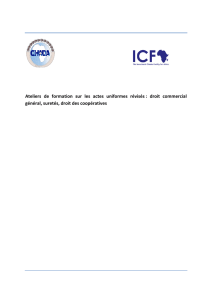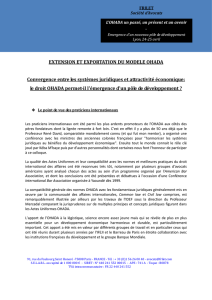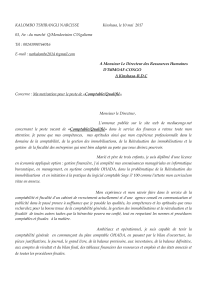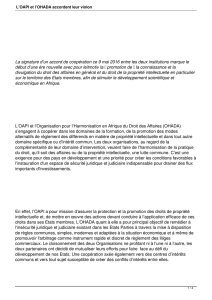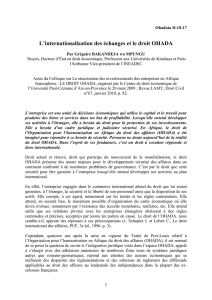Ohadata D-10-36

Ohadata D-10-36
Pourquoi la République Démocratique du Congo (RDC)
devait adhérer à l’OHADA ?
“ Critique prospective de la démarche d’adhésion de la RDC à
l’OHADA ”
par
Ghislain BAMUANGAYI KALUKUIMBI,
Avocat au Barreau de Kinshasa (RDC) et Chercheur indépendant
Revue congolaise de droit et des affaires, N° 2, janvier-mars 2010, p. 81
INTRODUCTION
Le Parlement de la République Démocratique du Congo (RDC) a adopté la loi autorisant la
ratification du Traité de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires
(OHADA), le 14 décembre 2009, et la Cour Suprême de Justice a déclaré cette loi conforme à
la Constitution congolaise du 18 février 2006, par décision du 05 février 2010, jugeant ainsi
toute révision constitutionnelle inutile en vue de l’adhésion à l’OHADA. Le Président de la
République a promulgué l’Ordonnance-loi portant ratification du Traité OHADA par la RDC,
le 11 février 2010.
Au départ, une opposition farouche s’était levée sur fond de défense de la souveraineté de
l’Etat congolais et d’une appréhension de domination juridique et économique des pays
francophones de l’Afrique de l’Ouest
1
. La contestation a failli porter ses fruits au Parlement et
renvoyer l’adhésion aux calendes grecques
2
.
Le vrai débat national sur l’intérêt de l’adhésion, la procédure à suivre, les questions
incidentes et les conséquences, pourtant commencé au Sénat puis à l’Assemblée Nationale, ne
s’est pas poursuivi. L’intérêt politique semble avoir prévalu dans la décision définitive
parlementaire d’autoriser l’adhésion. Un compromis politique a été trouvé, sans une réelle
conviction sur les arguments en faveur de l’adhésion, confrontés aux arguments contre, en
considération de la prééminence d’une certaine « urgence » sur les conséquences, peut-être
négatives, de la discussion approfondie sur l’adhésion à l’OHADA par la classe politique et
par les intellectuels congolais.
1
Le site OHADA.com avait relayé quelques arguments de l’opposition à l’adhésion de la RDC en date du
13/10/2009 (http://fr.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch.gx=I&.rand=7664r81fm8gqn), suite à deux articles de
presse, le premier du journal Le Potentiel de la RDC et le second de Congo Indépendant apparaissant sur
internet. Le séminaire organisé les 9 et 10/12/2008 sur l’importance de la ratification par la RDC du Traité
OHADA par la Commission des Relations Etrangères du Sénat avait, aux cours des débats, permis de relever
les oppositions.
2
Le Sénat congolais, le 12/11/2009, avait délibéré et rejeté le projet de loi autorisant l’adhésion à l’OHADA,
tandis que l’Assemblée Nationale, le 14/12/2009, l’avait adopté. Suite à une rencontre de la Commission
mixte Sénat et Assemblée Nationale, le Parlement avait en date du 15/12/2009, adopté finalement le projet de
loi.

L’OHADA, pour se réaliser, a certainement besoin de chaque pays africain, son ambition
étant de favoriser le développement de l’Afrique et d’atteindre un vaste, attrayant et important
système juridique d’un marché économique continental. La RDC est, sans aucun doute, d’un
intérêt majeur pour la promotion de l’OHADA, au moment où la gouvernance nationale, dans
ses secteurs juridique, judiciaire et économique, y compris celle projetée dans le proche
avenir, la contraignent au réalisme et à l’humilité dans le recours à une institution
communautaire comme l’OHADA.
Cette Organisation est unique en Afrique par rapport à sa compétence d’unification du droit
des affaires et d’examen des litiges de droit privé, et tout aussi originale dans le monde quant
à certains principes juridiques. Elle est une belle opportunité pour la RDC, mais qui aura
besoin de la détermination, du sérieux et d’un ferme engagement des Congolais pour être le
facteur favorisant du développement de leur pays. Sans pareil esprit, son adhésion sera une
complaisance nuisible à l’économie nationale et à la culture juridique d’un pays, pendant que
d’autres pays, des multinationales, des institutions financières internationales, des avocats et
des entreprises d’ailleurs en tireront le maximum de profit à son détriment. L’adhésion à
l’OHADA est une bonne chose, mais la manière de le faire doit garantir l’intérêt du pays et de
son peuple.
Les enjeux de l’adhésion de la RDC sont à apprécier à la lumière de l’importance que
prendrait le marché OHADA avec l’adhésion d’un pays aux dimensions d’un sous-continent,
comptant environ 65.000.000 d’habitants
3
, cohabitant avec neuf pays voisins, regorgeant de
richesses naturelles immenses et s’étendant du centre au sud du continent, avec une extension
vers l’Est proche de l’Océan Indien et une sortie à l’Ouest sur l’Océan Atlantique.
La présente réflexion va s’articuler autour de deux points, à savoir les arguments soulevés
contre l’adhésion de la RDC à l’OHADA (I) et les enjeux que représente son adhésion sur le
plan géostratégique (II).
I.- LES ARGUMENTS CONTRE L’ADHESION DE LA RDC A L’OHADA
Pourquoi évoquer les arguments balayés, en définitive, par le vote favorable du Parlement ? Il
s’agit de gagner les sceptiques à la cause de l’OHADA, mais aussi de tenir compte des
arguments des sceptiques et des opposants.
Les mêmes débats ont lieu dans d’autres pays africains non encore membres, et qui hésitent à
s’engager sur la voie de l’OHADA.
Les arguments contre l’adhésion étaient en résumé les suivants :
• l’influence du droit français alors que la RDC est régie par un droit d’essence belge ;
• l’inadaptation et l’incompatibilité du Traité OHADA à certaines réalités fondamentales de
certains pays d’Afrique ;
• la restriction de la compétence de la Cour Suprême de Justice sur les questions relevant du
droit des affaires au profit d’une juridiction « étrangère » ;
3
Jean Pierre GUENGANT, chercheur en démographie de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
basé à Ouagadougou (Burkina Faso), le 25 janvier 2010, estimant à 65 millions la population de la RDC,
indique que l’accroissement annuel y est de deux millions d’habitants. D’après ses études, la population
congolaise atteindrait d’ici 2050, le chiffre de 100 millions d’habitants.
(http://www.casafree.com/modules/news/article.php?storyid=18300, consulté le 26/01/2010).

• la crainte pour certains indépendants comme les avocats, les consultants en matière de
société et les experts comptables, de perdre le marché congolais des affaires au profit des
professionnels des pays déjà membres de l’OHADA ;
• les difficultés de vulgariser le droit OHADA sur l’ensemble du pays au regard de ses
dimensions ;
• le possible effacement du franc congolais par la domination du franc CFA dans l’espace
OHADA ;
• un possible conflit de compétence en matière de cassation entre la Cour Suprême de Justice
et la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
• un changement brusque et brutal des règles dans le domaine des affaires ;
• l’inadéquation entre plusieurs dispositions du droit interne et le droit OHADA, nécessitant
une harmonisation interne ;
• une certaine incompatibilité d’appartenir à la fois à la SADC
4
, à la CEEAC
5
, à la
COMESA
6
et à l’OHADA ;
• l’incompréhensible application immédiate et directe des textes OHADA ;
• l’éloignement du siège de la CCJA ;
• le risque de modifier la Constitution en vue d’intégrer le juge communautaire OHADA
dans l’ordre judiciaire et de conformer l’adhésion aux dispositions constitutionnelles.
Il ne s’agira pas d’examiner techniquement tous ces arguments, quelques-unes de ces
considérations seulement feront l’objet de la présente réflexion.
A. Le besoin d’harmoniser les vues et les textes au niveau communautaire et national
Plusieurs critiques ont été émises en vue de revisiter les textes de l’OHADA
7
. La révision du
Traité OHADA au Québec le 17 octobre 2008 est un signe de grande ouverture et de
croissance de l’Organisation, qui a intégré les critiques en procédant à une évaluation 15 ans
après sa création.
La vocation continentale de l’OHADA l’oblige à s’auto-évaluer sans complaisance, après un
travail remarquable de législation et de jurisprudence dans le domaine du droit des affaires, à
un niveau élevé d’Organisation communautaire de 16 Etats. Les conditions de législation et
d’administration de la justice vont-elles rester les mêmes avec 20, 25 ou 30 Etats, que
lorsqu’ils étaient 14 ou 16 ? La localisation actuelle des institutions plus au Nord-Ouest ne
pourrait-elle pas être une faiblesse du système, avec un élargissement plus accru vers le centre
4
Communauté pour le Développement de l’Afrique Australe, qui regroupe l’Afrique du Sud, l’Angola, le
Botswana, l’Ile Maurice, le Lesotho, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, la Namibie, la République
Démocratique du Congo, les Seychelles, le Swaziland, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.
5
Communauté Economique des Etats d’Afrique Centrale, qui regroupe l’Angola, le Burundi, le Cameroun, le
Centrafrique, le Congo (Brazzaville), le Gabon, la Guinée Equatoriale, la République Démocratique du
Congo, Sao Tomé et Principe et le Tchad.
6
Marché Commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique Australe, qui regroupe le Burundi, les Comores,
Djibouti, l’Egypte, l’Erythrée, l’Ethiopie, le Kenya, l’Ile Maurice, la Libye, Madagascar, le Malawi, la
République Démocratique du Congo, le Rwanda, les Seychelles, le Soudan, le Swaziland, l’Ouganda, la
Zambie et le Zimbabwe.
7
Jean YADO TOE en a fait une critique pertinente dans un article, « La problématique actuelle de
l’harmonisation du droit des affaires par l’OHADA », publié dans la Revue de Droit Uniforme, UNIDROIT,
2008, pp. 23-37.

et le sud du continent ? N’est-il pas temps d’établir une relation structurée et intime entre
l’OHADA et les formations universitaires à tous les niveaux d’études ? Les questions sont
nombreuses. L’important est de garder l’ouverture, la capacité d’adaptation et de
réajustement, sans se départir des objectifs principaux de l’Organisation ou de s’empêtrer
dans des modifications intempestives susceptibles de faire perdre les acquis ou de briser les
équilibres essentiels obtenus au niveau institutionnel et jurisprudentiel.
Pour le cas particulier de la RDC, ses dimensions quant à la vulgarisation des textes OHADA,
à l’adaptation des structures et à la formation d’un personnel approprié, ainsi que le niveau
très élevé de dysfonctionnement de ses appareils administratif et judiciaire, sont a priori en
incompatibilité avec l’exigence du Traité OHADA à mettre en vigueur ses textes dans les 60
jours qui suivront le dépôt de l’instrument d’adhésion par le chef de l’Etat.
Mais, le dernier alinéa de l’article 53 du Traité OHADA offre la possibilité de retarder le
dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du Gouvernement du Sénégal, dépositaire du Traité
OHADA. Cela pourrait être un temps favorable de préparation d’une naissance désirée. Le
moment d’implanter les structures appropriées, de vulgariser les Actes uniformes et le Traité
lui-même sur toute l’étendue du pays, de conformer certaines dispositions du droit interne au
droit OHADA, de repenser les contenus des cours et le programme de formation universitaire
dans les facultés de droit et d’économie, de former le personnel administratif, les avocats et
les magistrats.
Attendre le dépôt des instruments de ratification pour commencer ce travail d’adaptation et
d’harmonisation, au motif que le droit national est encore d’application, serait une erreur
stratégique
8
. Les structures, les normes et les comportements actuels sont inadaptés aux
exigences d’une économie moderne et ils sont inefficaces pour le développement. Il ne
faudrait pas attendre l’avènement de l’OHADA pour les changer.
Dans le travail préparatoire, qui aura la vocation de résoudre par la même occasion des
problèmes importants de développement et de progrès du pays, il y a lieu d’épingler les cas
suivants :
B. Le besoin de définir le système économique
L’OHADA est née et évolue dans le contexte de l’économie de marché de l’après deuxième
guerre mondiale, fondée à la fois sur le libéralisme et sur l’interventionnisme des pouvoirs
publics dans le but de garantir la concurrence, l’équilibre du marché et la liberté
d’entreprendre et d’agir des opérateurs économiques. Le droit économique est au centre du
libéralisme économique pour promouvoir la propriété privée et la liberté du commerce, pour
réaliser et protéger le profit résultant de l’exploitation du capital et pour restreindre au
maximum la possibilité des pouvoirs publics d’intervenir comme agent économique dans la
production, le transport et la commercialisation des biens et services.
L’OHADA est, dans la mouvance du capitalisme, au service de l’entreprise pour donner à
cette dernière sa pleine forme d’action. Postulant que le développement de l’Afrique est
fonction de la protection de l’entreprise, à laquelle l’Organisation communautaire tend à
aménager un environnement juridique et judiciaire favorable, le Traité OHADA, dans son
préambule, stipule : « Persuadés que la réalisation de ces objectifs suppose la mise en place
dans leurs Etats d’un Droit des Affaires harmonisé, simple, moderne et adapté, afin de
faciliter l’activité des entreprises ; Conscients qu’il est essentiel que ce droit soit appliqué
8
Lire MASSAMBA MAKELA Roger, Modalités d’adhésion de la RDC à l’OHADA, vol. 1, Rapport final de
consultation, 2005, disponible sur
www.copirep.org/.../Modalit%E9s%20d’adh%E9sion%20RDC%20OHADA.doc consulté le 27/01/2010.

avec diligence, dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités
économiques, afin de favoriser l’essor de celles-ci et d’encourager l’investissement. »
Dans le même temps, les pays développés favorisent l’économie libérale en Afrique, en
contradiction flagrante avec leurs importantes interventions financières sous forme de
subventions destinées à garantir les actifs des sociétés, à influer sur le niveau de production
des produits agricoles et pour sauver des entreprises non compétitives, violant ainsi les règles
de la concurrence et de l’équilibre du marché.
L’OHADA devra tenir compte de ces contradictions dans l’harmonisation du droit africain.
La RDC, qui évolue dans les mêmes contradictions par une tendance au libéralisme à outrance
de son économie, à l’encouragement des monopoles de fait pour de nombreux produits et à
l’aveuglement par le laisser-faire, sous pression de l’extérieur et des intérêts étrangers, alors
que les réalités sociales et économiques l’invitent davantage à venir au secours des entreprises
malades et de préserver l’intérêt du pays par la présence d’agents économiques, a l’obligation
de définir clairement et souverainement les options fondamentales de son économie.
L’application du droit OHADA pourrait donc être handicapée en RDC, si le pouvoir politique
n’anticipe pas avec une politique économique nettement définie par des principes directeurs
fondés à la fois sur l’intérêt national, sur les besoins internes d’un marché commun africain et
sur l’ambition de jouer un grand rôle dans le développement du continent.
En fait, la promotion de l’OHADA en RDC sera garantie par la capacité des pouvoirs
politiques congolais à définir et à préserver les intérêts économiques du Congo. L’OHADA
est un véhicule, dont les routes doivent être préalablement tracées à l’intérieur de chaque Etat
par lui-même. Une situation de flou économique, de tâtonnement dans les choix économiques,
d’attention prioritaire aux intérêts étrangers, d’inféodation de l’économie aux intérêts des
individus, sera la source d’incompréhension avec l’Organisation communautaire et de
difficultés d’exécution des décisions venant des organes de celle-ci.
C. Une législation économique, des structures adaptées aux besoins de développement
Le droit OHADA, par son caractère obligatoire et supranational, établit un ordre public
communautaire, alors qu’il n’a pas vocation à harmoniser le droit public interne des Etats. Par
contre, il fait de nombreux renvois au droit interne. Par exemple, le droit communautaire
laisse à chaque Etat partie la tâche de déterminer les sanctions relatives aux incriminations
qu’elle prévoit (article 5 du Traité OHADA), ainsi que les biens et droits insaisissables
(articles 50 et 51 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution).
Il convient, au regard du besoin de modernisation des normes et des structures, d’avoir un
droit économique pénal moderne, des règles de procédure civile aptes à créer les conditions de
justice et d’équilibre des parties devant le juge, un droit économique incitateur et favorable à
l’investissement, un droit protecteur de l’environnement et des mesures de sécurité des
citoyens et de leurs biens. Il ne faut pas attendre l’application du droit OHADA pour instaurer
un climat serein et favorable aux affaires.
Le rapprochement du justiciable de son juge ou l’administré de l’administration publique est
une nécessité actuelle d’extrême urgence en RDC. Le droit écrit a eu du mal à évincer
certaines coutumes dépassées, à cause de l’absence de tribunaux, de la police et des autorités
civiles dans les zones rurales, qui constituent, par ailleurs, la majorité du territoire congolais et
comprennent environ 65 % de la population. Par conséquent, la fameuse « civilisation », celle
du droit écrit, est une fiction pour le plus grand nombre d’Africains, puisque le cas de la RDC
est semblable à celui de la majorité des pays africains.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
1
/
16
100%