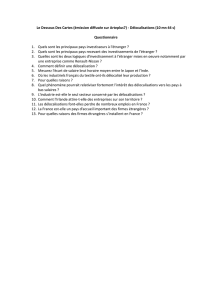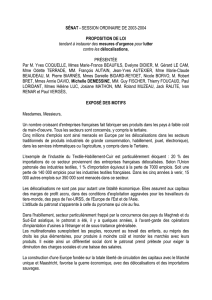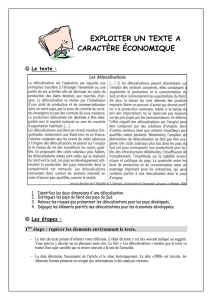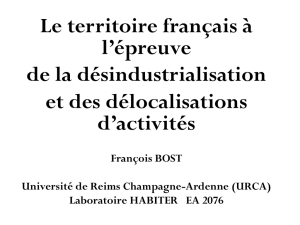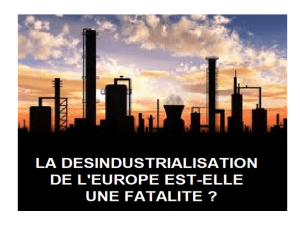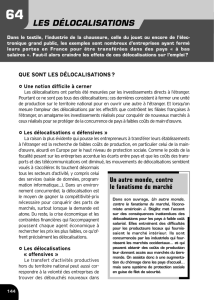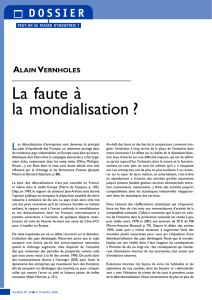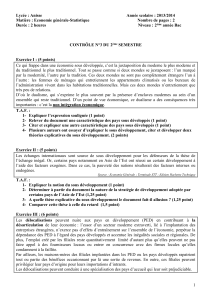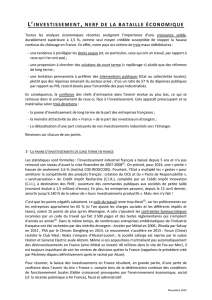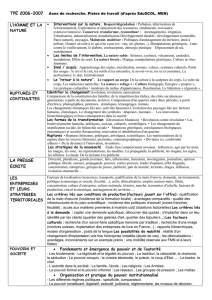Economie

Économie
Une composition de sciences économiques.
SUJET : Délocalisation, relocalisation : enjeux et perspectives.

Copie notée : 14/20
L’annonce récente de l’entreprise allemande Adidas de relocaliser ses ateliers de production
en Europe après leur départ pour l’Asie dans les années 1990 montre que le phénomène
de délocalisation n’est pas irréversible.
Au sens strict, une délocalisation désigne le transfert d’une unité de production à l’étranger
comme le fit l’entreprise Aubade en 2007 en transférant son site de la Trimouille dans le
Poitou vers la Tunisie. C’est ce que Jean Arthuis (rapport de 1993) appelle une
« délocalisation pure ». Dans un sens plus large, une délocalisation désigne toute
réorganisation d’une entreprise qui se traduit par une substitution d’une production
étrangère à une production française (Insee 2005, Aubert et Sillard, « Délocalisations et
réductions d’effectifs dans l’industrie française »). Il n’y a pas forcément fermeture d’une
unité de production, il peut s’agir d’une division internationale du processus de production
(Lassudrie – Duchêne). Enfin, dans un sens encore plus large, une délocalisation désigne
toute décision d’un producteur qui renonce à produire en France pour produire ou sous-
traiter à l’étranger (rapport de Jean Arthuis de 1993). Cette définition inclut aussi les
« non-localisations ». Au contraire, une relocalisation désigne le retour d’une production
précédemment délocalisée sur le sol français.
Les délocalisations auxquelles fait face l’économie française se traduisent principalement
par une désindustrialisation et une réduction du tissu productif du pays. Ces délocalisations
et cette désindustrialisation sont problématiques au vu du caractère essentiel de l’industrie
pour l’économie.
Toutefois, non seulement les effets négatifs de ces délocalisations sont à relativiser mais
la question des relocalisations montre que le phénomène de délocalisation n’est pas
irréversible. En réalité, plusieurs facteurs concourent à expliquer les stratégies de
localisation des entreprises. Si l’approche OLI (Dunning, 1988) offre un éclairage théorique,
elle est peu opérationnelle en termes de politique économique à mener. La question des
coûts de production, aussi bien du coût du travail que de la fiscalité, permet d’expliquer en
partie les stratégies de localisation des entreprises. D’autres facteurs doivent néanmoins
être pris en compte, notamment la question des compétences et la volonté d’accéder à des
consommateurs solvables.
Finalement, la lutte contre le phénomène de délocalisation et d’instauration d’un contexte
favorable aux relocalisations nécessitent des politiques diverses et adaptées : baisse des
coûts de production des entreprises, amélioration du niveau de qualification de la
population active, relance de la croissance dans la zone euro, etc…
Ainsi, s’interroger sur les enjeux et perspectives des délocalisations et relocalisations
revient à examiner leurs effets, leurs motifs et les moyens d’influer sur la localisation des
entreprises.
Si les délocalisations auxquelles fait face l’économie française sont problématiques au vu
du caractère essentiel de l’industrie, leurs effets négatifs sont à relativiser et la question
des relocalisations montre que le phénomène n’est pas irréversible (I). En réalité, plusieurs
facteurs concourent à expliquer les stratégies de localisation des entreprises ce qui explique
la nécessité de politiques diverses et adaptées (II).
Si les délocalisations auxquelles fait face l’économie française sont problématiques au vu
du caractère essentiel de l’industrie (A), leurs effets négatifs sont à relativiser et la question
des relocalisations montre que le phénomène n’est pas irréversible (B).
Les délocalisations auxquelles fait face l’économie française se traduisent principalement
par une désindustrialisation et sont problématiques au vu du caractère essentiel de
l’industrie.
Les délocalisations auxquelles fait face l’économie française se traduisent principalement
par une désindustrialisation et une réduction du tissu productif du pays.

Sur les trente dernières années, la France a perdu plus de deux millions d’emplois
industriels selon le rapport Gallois (novembre 2012). La part des emplois industriels dans
l’emploi total est ainsi passée de 18 à 12% entre 2000 et 2011. Selon L. Demmou
(Economie et statistiques 2010), entre 13 et 39% de ces destructions d’emplois
s’expliquent par la concurrence internationale et les délocalisations selon la méthodologie
employée. Les délocalisations se traduisent donc par une destruction du tissu productif du
pays notamment au profit des pays en développement. Ainsi, selon la CNUCED (2011), les
pays en développement ont reçu plus de la moitié des investissements directs à l’étranger
mondiaux en 2010.
Ces délocalisations et cette désindustrialisation sont problématiques à plusieurs points de
vue. Le premier effet néfaste des délocalisations réside dans les destructions d’emplois
qu’elles entrainent. Cahuc et Zylberberg (Le chômage, fatalité ou nécessité ?, 2004)
montrent ainsi que les emplois détruits dans le secteur du textile dans les pays développés
dans les années 1990 ont été recréés dans ce même secteur dans les pays en
développement (PED). Par ailleurs, la menace des délocalisations entraine une concurrence
fiscale dont les effets sont néfastes : insuffisance de l’offre de biens publics (Zodrow et
Mieszkowski, 1986), taxation excessive du travail et de la consommation (Bucovetsky et
Wilson, 1991), etc. De plus, la désindustrialisation entrainée par les délocalisations est elle
aussi problématique au vu du caractère essentiel de l’industrie. Cette dernière est en effet
essentielle pour les gains de productivité et le pouvoir d’achat (Lettre Trésor, février 2014,
« L’industrie, quels défis pour l’économie française ? ») alors que les salaires sont moins
importants dans les services (Artus et Pastré, 2009, Sorties de crise) tout comme les gains
de productivité (« maladie des coûts » de Baumol). Elle est également essentielle pour ses
effets d’entrainement (0,7 € de consommation intermédiaire pour 1 € de production contre
0,4 € pour les services selon la DATAR, février 2004, « France, puissance industrielle ») et
pour la recherche et le développement (85% des dépenses de recherche et de
développement privées proviennent de l’industrie selon le rapport Beffa de 2005 « Pour
une nouvelle politique industrielle »). Les délocalisations et la désindustrialisation qu’elles
entrainent sont donc problématiques pour l’économie française ce qui amène Artus et
Virard (La France sans ses usines, 2010) à critiquer le modèle bipolaire laissant l’industrie
aux PED et les services à haute valeur ajoutée aux pays développés.
Si les délocalisations semblent donc avoir des effets négatifs pour les pays développés dont
la France, ceux-ci sont à relativiser d’autant que la question des relocalisations montre que
le phénomène n’est pas irréversible.
Non seulement les effets négatifs des délocalisations sont à relativiser mais la question des
relocalisations montre de plus que le phénomène n’est pas irréversible.
Les effets négatifs des délocalisations doivent être relativisés : non seulement les
destructions d’emplois dues aux délocalisations sont limitées mais ces délocalisations
peuvent même être porteuses d’avantages en soi, notamment en termes de pouvoir
d’achat.
Selon l’étude de l’INSEE de 2005 (Aubert et Sillard) « Délocalisations et réductions
d’effectifs dans l’industrie française », les suppressions annuelles brutes d’emploi dues aux
délocalisations sont de l’ordre de 3% seulement. Une étude de l’INSEE de 2007 (Barlet et
al) confirme totalement les ordres de grandeur. Par ailleurs, les délocalisations permettent
d’améliorer la compétitivité de l’entreprise et donc l’emploi sur les sites de production
restés dans le pays d’origine. Le rapport Brunel (Assemblée Nationale, 2006) donne ainsi
l’exemple du secteur du diamand en Anvers où des milliers d’emplois ont été détruits dans
la taille mais où plus encore ont été créés dans le commerce, le marketing, etc... Les
délocalisations permettent également d’améliorer le pouvoir d’achat des consommateurs
(le libre-échange est un jeu à somme positive comme l’ont montré Adam Smith puis
Ricardo) à travers la baisse du prix des importations et à terme d’augmenter les
exportations vers les pays concernés grâce à leur enrichissement.

De plus, la concurrence fiscale induite par la menace des délocalisations peut être favorable
selon Tiebout (article de 1956) en éliminant les collectivités non efficaces et en étant
conforme à la diversité des préférences en matière d’offre de biens publics. Les effets
négatifs des délocalisations doivent donc être relativisés.
Par ailleurs, la question des relocalisations montre que le phénomène de délocalisation
n’est pas irréversible Suzanne Berger (Made in Monde, 2006) montre ainsi qu’un mètre de
tissu peut coûter deux fois plus cher à produire en Inde qu’en Italie malgré la différence
du coût du travail notamment en raison du coût généré par le contrôle de la qualité, par
les gaspillages, etc. Elle affirme ainsi que le secteur du textile a un avenir en Europe et
qu’aucun emploi dans ce secteur n’a été détruit en Italie depuis 1995. Il existe ainsi des
exemples de relocalisation sur le sol français. C’est notamment le cas de l’entreprise
Geneviève Lethu. Le phénomène de délocalisation n’est donc pas irréversible.
Les effets des délocalisations sont donc ambigus. Selon le rapport du CAE de 2010
(Fontagné et Toubal) intitulé « Investissement direct à l’étranger et performance des
entreprises », les entreprises qui s’externalisent voient leur chiffre d’affaires et leur emploi
augmenter. Néanmoins, dans un complément au rapport, Anne Epaulard souligne que ces
résultats optimistes ont été obtenus avant 2010 et que l’orientation nouvelle des IDE vers
les PED oblige à nuancer les conséquences positives des délocalisations. Finalement, il
convient d’analyser les motifs des stratégies de localisation des entreprises pour
déterminer les politiques à mener.
En réalité, plusieurs facteurs concourent à expliquer les stratégies de localisation des
entreprises (A) ce qui explique que la lutte contre le phénomène de délocalisation et
l’instauration d’un contexte favorable aux relocalisations nécessitent des politiques
diverses et adaptées (B).
Plusieurs facteurs concourent à expliquer les stratégies de localisation des entreprises.
Si l’approche Ownership-Localisation-Internationalisation (OLI) offre un éclairage
théorique, elle est peu opérationnelle en termes de politique à mener. Développée par
Dunning (1988), cette théorie fait de la décision de délocalisation une combinaison de trois
éléments interdépendants. Le premier élément, « l’ownership » désigne la détention d’un
actif (innovation, marque déposée, etc.) pouvant être potentiellement exploitée à l’échelle
internationale. La « localisation » désigne l’intérêt à exploiter cet actif à l’échelle de
plusieurs pays. Enfin, « l’internationalisation » désigne l’intérêt à produire soi-même à
l’étranger plutôt que de sous-traiter (question du contrôle de la qualité, du respect de la
propriété intellectuelle, etc…). Cette théorie est néanmoins peu opérationnelle en termes
de politique économique.
La question des coûts de production, aussi bien du coût du travail que de la fiscalité, permet
d’expliquer en partie les stratégies de localisation des entreprises. Ainsi, selon Bouba-Olga
(Les nouvelles géographiques du capitalisme, 2006), la « dictature des coûts » explique en
partie ces stratégies. S’agissant du coût du travail, les coûts salariaux unitaires (CSU) sont
encore inférieurs de 50% en Chine par rapport à la France (CAE 2010, Artus et al.,
« L’émergence de la Chine »). En effet, si les salaires augmentent vite (jusqu’à 20% par
an sur les zones cotières), la productivité augmente très vite aussi. Au-delà du coût du
travail, la question de la fiscalité revêt également une importance d’où une « concurrence
fiscale prédatrice » entre les pays (CAE 2005, Saint-Etienne et Le Cacheux, « Croissance
équitable et concurrence fiscale »). Ainsi, en Union Européenne, le taux d’impôt sur les
sociétés a diminué de 8 points en moyenne sur les quinze dernières années. Il s’élève ainsi
à 12,5% en Irlande qui pratiquait également jusqu’il y a peu le système du « double Irish »
permettant aux entreprises localisées en Irlande de payer leurs impôts dans un paradis
fiscal. Le Luxembourg pratique quant à lui un système de « rescrit fiscal » permettant à
une entreprise de négocier au préalable son statut fiscal.

Néanmoins, la concurrence se fait en réalité entre couples offre de biens publics/fiscalité
(Bénassy – Quéré) ce qui offre aux grands pays une rente de cinq ponts de fiscalité selon
le rapport du CAE de 2005. Les délocalisations pour des questions de coûts s’apparentent
à ce que Markusen (1995) qualifie d’IDE vertical : produire à l’étranger pour réimporter.
Cette décision implique un arbitrage entre coûts de production et coûts de transport et de
transaction favorable aux premiers.
D’autres facteurs doivent néanmoins être pris en compte pour expliquer les stratégies de
localisation des entreprises notamment la question des compétences et la volonté
d’accéder à des consommateurs solvables. Bouba-Olga (2006) met ainsi en avant la
« dictature des compétences » pour expliquer une partie de ces stratégies. Outre le niveau
de qualification de la population active, la question des effets d’agglomération (Krugman)
est centrale et explique la constitution de « clusters » (Porter) ou pôles de compétitivité.
Un effet d’agglomération peut se définir comme une économie d’échelles externe qui
s’explique par la concentration des compétences sur un lieu. De tels pôles de compétitivité
existent à Schenzen en Chine (où est installée l’entreprise Apple), à Bangalore en Inde
(pour les services informatiques) ou encore sur une bande étroite allant de Varsovie à
Bucarest pour la production d’automobiles (ce que le rapport Brunel de 2006 appelle le
« détroit de l’Est »). Enfin, les entreprises cherchent également à accéder à des
consommateurs solvables (étude du Cepii de 2007 de Mayer, Méjean et Nefussi) comme
le montre une étude du Comité national des conseillers au commerce extérieur de la France
de 2010 : 90% des entreprises interrogées souhaitent accéder à des marchés en pleine
croissance, seules 10% affirment se délocaliser pour réimporter. Ces délocalisations
s’apparentent à ce que Markusen (1995) qualifie d’IDE horizontaux.
Face à cette multiplicité des facteurs concourant à expliquer les stratégies de localisation
des entreprises (Mayer et Mucchielli, 1999), plusieurs politiques économiques doivent être
menées pour répondre au phénomène de délocalisation et faciliter les relocalisations.
La lutte contre le phénomène de délocalisation et l’instauration d’un contexte favorable
aux relocalisations nécessite des politiques diverses et adaptées.
La lutte contre le phénomène de délocalisation implique de diminuer les coûts de
production des entreprises et d’améliorer le niveau de qualification de la population active.
S’agissant de la baisse des coûts de production des entreprises, plusieurs mesures ont déjà
été prises par le gouvernement tant pour diminuer le coût du travail que la fiscalité pesant
sur les entreprises. Ces mesures sont rassemblées dans le pacte de stabilité et de
responsabilité dont le coût total est de 41 milliards d’euros. Il comprend tout d’abord le
crédit d’impôt pour la compétitivité et pour l’emploi (CICE) d’un montant de 6% de la
masse salariale pour les salariés rémunérés jusqu’à 2,5 SMIC. Le coût total du CICE est de
20 Mds €. Le Pacte comprend également 1 Mds € de baisse des cotisations sociales
notamment par le biais de l’abaissement du taux de cotisations familiales à 3,45% (contre
5,25% auparavant) pour les salariés rémunérés jusqu’à 1,6 SMIC. Il comprend enfin des
baisses d’impôts pour 10 Mds € dont toutes ne sont pas entrées en vigueur : il prévoit ainsi
la suppression totale de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés (C3S) d’ici
2017 après avoir relevé son seuil d’entrée (de 760 000 € à 3,25 M € de chiffre d’affaires)
dès 2015 et l’abaissement du taux d’impôt sur les sociétés dès 2017. Si ces mesures vont
dans le bon sens, il conviendrait de cibler le CICE sur les entreprises soumises à la
concurrence internationale et d’inscrire la baisse de l’impôt sur les sociétés dès 2017 dans
un document contraignant liant les mains du gouvernement. Par ailleurs, au-delà des coûts
de production des entreprises, il conviendrait d’améliorer le niveau de qualification de la
population active ce qui implique de réformer le système éducatif français, particulièrement
inégalitaire et source d’exclusion (Maurin, La nouvelle question scolaire ; Cahuc, Carcillo,
Galland, Zylberberg, La machine à trier). Enfin, une des faiblesses majeures dans
l’émergence de pôles de compétitivité en France est la faible mobilité des travailleurs.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%