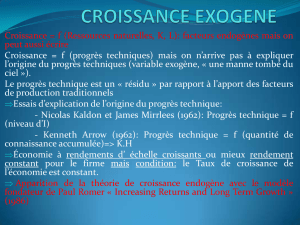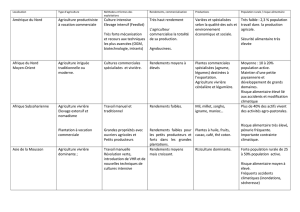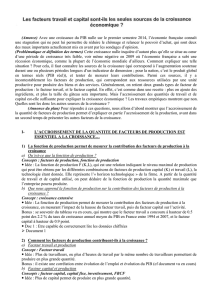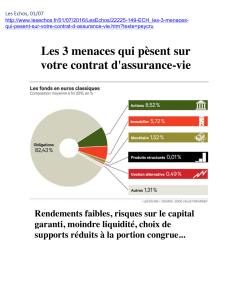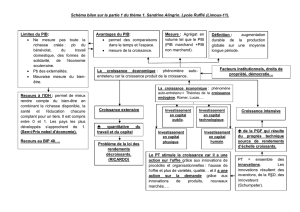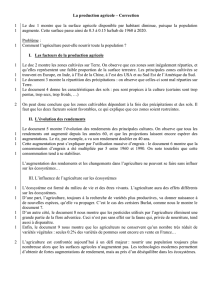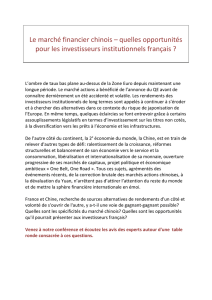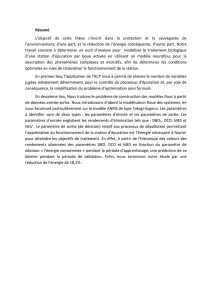La baisse de la volatilité macroéconomique explique-t

Diagnostics Prévisions
et Analyses Économiques
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
N° 116 – Juillet 2006
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
La baisse de la volatilité macroéconomique explique-t-elle le bas niveau
des taux d'intérêt ?1
Les taux obligataires à long-terme ont atteint depuis le début de 2003 des niveaux très bas qui ne
peuvent être expliqués par les seuls déterminants macro-économiques usuels. Ainsi, à la mi-2006,
les taux obligataires à 10 ans aux États-Unis et en zone euro seraient encore significativement inférieurs à
ce que les variables macro-économiques suggèreraient, et ce en dépit de la remontée observée depuis le
début de l’année.
Certains facteurs conjoncturels comme l’abondance de liquidité ou la recherche de rendements sur des
maturités plus longues peuvent expliquer ce décalage. On s’intéresse ici à des facteurs plus structurels :
notamment, la diminution des primes de risque en liaison avec une plus grande stabilité économi-
que, qui a pu favoriser une diminution tendancielle de l’incertitude des agents sur les anticipa-
tions d’inflation et de croissance. Cette hypothèse est testée ici sur les taux obligataires américains et
européens.
Pour évaluer la prime de risque associée aux obligations, on compare le rendement associé à la détention
pendant un an d’un titre obligataire de maturité initiale de 10 ans à celui associé à la détention sur la même
période d’un titre sans risque de maturité un an. Sur la période 1972-1984, les investisseurs ont exigé
en moyenne une rémunération pour le risque mesurée par un «rendement excédentaire» du titre
risqué de 2,5 points aux États-Unis et de 3,6 points en Europe.
Ce «rendement excédentaire» exigé par les investisseurs sur les obligations peut être prévu à
l’aide du niveau des anticipations de taux d’intérêt et de la volatilité de l’activité économique. Ces
«rendements excédentaires prévisibles» auraient baissé tendanciellement aux États-Unis en liaison avec
une réduction de la volatilité du PIB. En Allemagne, les évolutions sont assez semblables, quoique de plus
faible ampleur.
La prise en compte des «rendements excédentaires prévisibles» dans les équations de taux longs
permet d’améliorer considérablement les modèles traditionnels. La moindre volatilité de l’économie
serait responsable d’une baisse des primes de risque sur les marchés obligataires. Ainsi, sur la période
récente, le modèle ainsi amélioré permettrait de réduire de 2/3 l’écart entre taux observé et taux estimé
aux États-Unis et de moitié en Allemagne.
1. Ce document a été élaboré sous la responsabilité de la Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique et ne reflète pas nécessairement
la position du Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

2
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
Juillet 2006 n°115 • Réduction du biais domestique et financement du déficit courant américain, Luc Eyraud,
Françoise Jacquet-Saillard
n°114 • Assurance-vie et contrat diversifié, Frédéric Cherbonnier, Philippe Gravier, Daniel Turquety
Juin 2006 n°113 • Le policy-mix en zone euro et aux États-Unis de 1999 à aujourd'hui, Clotilde L’Angevin,
Fabrice Montagné
n°112 • Une analyse de l’inflation en France depuis le lancement de l’euro, Benoît Heitz, Julie Muro
n°111 • Caractéristiques des marchés du travail dans les pays de l’OCDE, Romain Bouis,
Jean-Paul Renne
Mai 2006 n°110 • Evolutions comparées des exportations en zone euro, Thibault Cruzet, Antoine Langlet
n°109 • Analyse de l’évolution des bénéficiaires de la PPE, Ludivine Barnaud, Gaël Bescond
n°108 • L'investissement en Chine est-il excessif ? Benjamin Delozier, Diana Hochraich
Avril 2006 n°107 • Vers la fin de la déflation au Japon ? Yann Pouëzat
n°106 • Enjeux économiques liés à l’intégration des industries post-marché en Europe, Frédéric
Cherbonnier, Séverine Vandelanoite
n°105 • Le ciblage d’inflation à travers l’expérience des pays latino-américains, Sophie Chauvin,
Olivier Basdevant
Mars 2006 n°104 • La compétitivité de l’économie allemande, Alexandre Espinoza
n°103 • La situation économique mondiale au printemps 2006, Pierre Beynet, Nathalie Fourcade
n°102 • Structure et comportement des entreprises exportatrices françaises, Nila Ceci, Bruno
Valersteinas
n°101 • Le droit des défaillances d’entreprises, Frédéric Cherbonnier, Anne Épaulard, Xavier Payet
Fév. 2006 n°100 • Perspectives d’appréciation du taux de change réel chinois : une analyse économique,
Mars Y. Robert
n°99 • Une modélisation analytique des stratégies d’endettement de l’État, Jean-Paul Renne, Nico-
las Sagnes
n°98 • Les indicateurs de retournement : des compléments utiles à l’analyses conjoncturelle,
Pierre Emmanuel Ferraton
Janv. 2006 n°97 • Bilan des finances locales depuis 1980, Julie Marcoff
n°96 • Mondialisation et marché du travail dans les pays développés, Nadia Terfous
Sommaire
des derniers numéros parus

3
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
Les équations traditionnelles2 décrivant les évolutions
des taux d’intérêt à long-terme n'arrivent plus à expli-
quer les faibles niveaux observés depuis 2003. L'écart
avec les niveaux estimés s'élevait à la fin du premier
trimestre de 2006 à 150 pdb aux États-Unis et 180 pdb
en zone euro. Il s’est réduit depuis avec la remontée
des rendements.
1. Les pistes d’explication du très faible
niveau des rendements obligataires
1.1 Des facteurs en partie conjoncturels
Au delà des déterminants macro-économiques tradi-
tionnels, de nombreux facteurs peuvent expliquer le
bas niveau atteint ces dernières années par les taux
obligataires :
•les réaménagements de portefeuille, notam-
ment de la part des investisseurs institutionnels, au
profit des titres obligataires, qui auraient pu être
renforcé par les réformes en cours de la gestion
actif-passif des fonds de pensions dans certains
pays européens (notamment aux Pays-Bas) ;
•une recherche de rendement sur des maturités
longues dans un contexte de taux d’intérêt bas au
niveau mondial ;
•l'abondance de liquidité, les interventions des
banques centrales asiatiques, le recyclage des
recettes pétrolières, ou encore un déséquilibre
entre épargne et investissement dans certains
pays...
Il est également possible que, dans des économies
occidentales plus stables et dotées de banques centra-
les plus crédibles, les agents aient exigé une prime de
risque plus faible sur les taux obligataires, favorisant
ainsi une baisse de leurs niveaux.
1.2 La baisse de l’incertitude sur l’évolution de
l’économie
La volatilité de long-terme 3de l’économie, calculée
comme l’écart type sur 10 ans des glissements annuels
des prix et du PIB réel, a baissé de façon très nette aux
États-Unis au début des années 1990, plus lentement
en Europe, traduisant une plus grande stabilité de
la situation macro-économique4 (cf. graphique 1).
Le processus d'intégration et d'innovation sur les mar-
chés financiers aurait favorisé un financement moins
volatil de l'économie, et les politiques monétaires ont
sans doute aussi participé à cette stabilisation en lut-
tant efficacement contre le risque inflationniste. Une
gestion plus efficace des stocks aurait également ren-
forcé la stabilité du PIB5.
Comme les taux longs reflètent les anticipations des
agents sur la croissance potentielle et sur l'inflation
future, une économie structurellement plus stable
favoriserait un meilleur ancrage des anticipations et
s'accompagnerait d'une baisse de la volatilité des taux
longs, notamment aux États-Unis (cf. graphique 2).
Graphique 1 :
volatilité des variables macro-économiques
Graphique 2 : volatilité des taux obligataires à 10 ans
Source : Banque de France, Bundesbank - calculs DGTPE. Volatilité
calculée sur 10 ans.
Si les agents ont été sensibles à cette baisse de l'incer-
titude économique, il est logique qu’ils exigent une
prime de risque plus faible au moment de l'achat
d'obligations souveraines, ce qui fait baisser les rende-
ments obigataires. Pour Rudebusch et Wu6, cette
hypothèse expliquerait le changement structurel
observé à la fin des années 1980 dans la dynamique de
la courbe des taux américaine.
Pour tenir compte d'une possible baisse des pri-
mes de risque sur les taux longs, plusieurs études
ont proposé d'ajouter une mesure de la volatilité
économique dans les équations de taux tradition-
nelles. Warnock & Warnock7 utilisent la volatilité des
taux longs nominaux sur trois ans. Bien que cette
variable soit significative pour expliquer les taux longs
américains, l'écart entre leur niveau estimé et observé
demeure élevé, à +150 pdb. Une étude de la Deutsche
Bank8 suggère que l'utilisation de la volatilité nominale
sur 10 ans du PIB comme variable explicative des taux
longs serait mieux à même d'illustrer l'hypothèse d'une
baisse des primes de risque. Elle permettrait de corri-
ger de près d'un tiers les erreurs d'estimation sur les
taux longs américains.
2. Elles utilisent des déterminants économiques, tels que les taux
courts, l'inflation, le PIB réel ou le solde des finances publiques. Cf.
DPAE n°90, "Les déterminants des taux longs nominaux aux États-
Unis et en zone euro".
3. On veut capter ici les grandes tendances de long-terme, contraire-
ment à ce qui présenté en partie 3 on l’on calcule une volatilité sur
une période plus courte.
4. Voir aussi Stock et Watson (2003) : «Has the business cycle chan-
ged ? evidence and explanations», Fed Kansas.
5. Cf. Kahn, McConnel, et Perez-Quiros (2002) : «On the causes of
the increased stability of the US economy», Federal Reserve Eco-
nomic Policy Review vol.8.
6. Rudebusch et Wu (2004) : «Accounting for a shift in term structure
behaviour with no-arbitrage and macro-finance models», Fed San
Francisco.
7. Warnock & Warnock (2005) : «International capital flows and US
interest rates», Federal Reserve, International Finance Discussion
Paper n°840.
8. T. Mayer (2006) : «Lower volatility = lower rates», Deutsche Bank
Global Markets Research.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
PIB réel - Allemagne PIB réel - Etats-Unis
inflation - Allemagne (éch. de droite) inflation - Etats-Unis (éch. de droite)
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
en Allemagne
aux Etats-Unis

4
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
s
Ces estimations reposent sur l'hypothèse implicite que
la prime de risque exigée sur les taux longs a été sensi-
ble à la baisse de la volatilité économique. C'est ce
qu'on essaie d'estimer dans la suite. On présente
d'abord une mesure susceptible de contenir la prime
de risque exigée par les agents, puis on cherche à isoler
cette prime à l'aide d'un indicateur de la volatilité éco-
nomique. La série ainsi estimée est ensuite utilisée
comme variable explicative des taux longs.
2. L’existence d’un biais sur les taux longs
nominaux à 10 ans
2.1 Le calcul du biais
On calcule le «rendement excédentaire» procuré par la
détention pendant un an d’une obligation de maturité
initiale 10 ans par rapport à un titre sans risque de
maturité initiale de 1 an (cf. graphique 3).
Cet indicateur constitue une mesure directe de l'écart
entre le taux d'intérêt à neuf ans attendu dans un an,
mesuré par le taux forward, et sa réalisation un an plus
tard : si la courbe des taux d'intérêt est efficiente, alors
ce taux forward doit être un estimateur sans biais du
taux d'intérêt effectivement réalisé ex-post, c'est-à-
dire que les «rendements excédentaires» doivent être
en moyenne nuls. Cette hypothèse a été globalement
rejetée par la littérature empirique9, le taux forward
étant biaisé parce qu'il contient une prime de risque, et
(ou) parce que les anticipations des agents ne sont pas
rationnelles (cf. encadré 1).
Graphique 3 : «rendements excédentaires»
Source : Banque de France - calculs DGTPE.
L’étude porte ici sur les rendements des obligations
américaines et des obligations européennes. Les obli-
gations allemandes ont été choisies pour repré-
senter la zone euro en raison du rôle joué par
l’Allemagne au cours de la période précédant la
mise en place de l’Union Économique et Moné-
taire. En effet, au cours de la période 1979-1999,
l’Allemagne a été l’ancre du système monétaire euro-
péen et ses taux d’intérêt ont été la plupart du temps
Encadré 1 : «rendements excédentaires» et erreurs d’anticipation
Les «rendements excédentaires», xt+1(n), correspondent à l'écart de rendement entre la détention pendant un an d'un titre
de maturité initiale de n années et celle pendant la même année d’un titre sans risque de maturité un an. Pour des obliga-
tions zéro-coupon, les «rendements excédentaires» peuvent être exprimésen fonction des taux d'intérêt, soit après passage
au logarithme,
xt+1(n) = n rt(n) - (n-1) rt+1(n-1) - rt(1)
où rt(n) correspond à l'observation en t du taux d'intérêt annuel versé par une obligation zéro-coupon terminant dans n
années. En t, à la date d'achat de l'obligation, le taux d'intérêt rt+1(n-1) est inconnu de l'investisseur. Si celui-ci est neutre au
risque, son espérance de rendement est nulle, et l'équation précédente peut s'écrire :
Et(xt+1(n) ) = n rt(n) - rt(1)- (n-1) Et(rt+1(n-1) ) = 0 soit Et(rt+1(n-1) ) = (n rt(n) - rt(1))/(n-1)
Or le terme n rt(n) - rt(1) correspond au rendement procuré par l'obligation à 10 ans détenue pendant dix ans, ajusté du taux
d'intérêt à un an. Il s'agit donc d'un taux forward, ft1,n-1 , correspondant à une mesure, à partir de la courbe des taux d'inté-
rêt, de l'anticipation des agents sur le niveau dans un an du taux d'intérêt à neuf ans. Il en résulte que lorsqu'un agent est
neutre au risque, son espérance de rendement est nulle et le taux forward constitue une mesure sans biais de son anticipa-
tion :
n rt(n) - rt(1) = (n-1) ft1,n-1 d’où Et(rt+1(n-1)) = ft1,n-1
Inversement, si l'agent est averse au risque, il exigera une prime de risque, ρt , pour réaliser cet investissement. Dans ce cas,
le taux forward observé sera supérieur à la vraie anticipation de l'agent, les taux longs à 10 ans étant par exemple un peu
plus élevés par rapport à leur valeur théorique rt*(n) , c'est-à-dire celle permettant une espérance de rendements excédentai-
res nulle (le même raisonnement s'applique si l'agent n'est pas rationnel et tend à faire des erreurs systématiques dans ses
anticipations) :
si rt(n) = rt*(n) + ρt , alors (n-1) ft1,n-1 = n (rt*(n) + ρt ) - rt(1) = (n-1) Et(rt+1(n-1)) + n ρt
d’où Et(xt+1(n-1)) = n ρt
Dans la suite, on montre que les biais estimés aident à expliquer le niveau des taux longs. Toutefois il n'est pas impossible
qu'une partie des biais proviennent de taux d'intérêt à un an un peu trop faibles par rapport à leur valeur théorique. Piazzesi
& Swanssona ont notamment montré que les taux à 3 mois anticipés jusqu'à un an (sur les contrats futures) tendaient à être
inférieurs aux mouvements de taux courts effectivement décidés par la banque centrale.
a. Piazzesi et Swanson (2004) : «Future prices as risk-adjusted forecasts of monetary policy», Federal Reserve.
9. Voir Campbell (1995) : «Some lessons from the yield curve», Jour-
nal of economic perspectives, vol.9.
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004
aux Etats-Unis
en Allemagne

5
Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique
les plus bas parmi les pays participant au mécanisme
de change européen (MCE 1). On évite ainsi d’inclure
dans la prime de risque sur les obligations un risque de
change lié aux possibilités de réalignements des parités
au sein du mécanisme de change.
Le graphique 3 retrace l'évolution des «rendements
excédentaires» en Allemagne et aux États-Unis. Ceux-
ci ont été calculés à l'aide d'obligations zéro-coupon,
disponibles depuis 1961 aux États-Unis et 1972 en
Allemagne.
2.2 Principales caractéristiques des «rende-
ments excédentaires»
Plusieurs observations se dégagent de l'analyse des
«rendements excédentaires» :
Ils sont en moyenne positifs sur la période 1972-
2005, à +2.5 points aux États-Unis et +3,6 points
en Allemagne. Ce phénomène reflète l'existence
d'une prime de risque sur le niveau des taux longs, ce
qui est logique dans la mesure où acheter une obliga-
tion souveraine de maturité 10 ans pour la revendre un
an plus tard est une stratégie risquée10. En outre, il ne
peut être exclu que les agents fassent en plus des
erreurs systématiques dans leurs anticipations.
Ils sont variables au cours du temps, et anormale-
ment répartis autour de leur moyenne. Les pério-
des où les «rendements excédentaires» apparaissent
négatifs ne durent pas, et elles sont rapidement suivies
par des périodes au cours desquelles les «rendements
excédentaires» sont durablement positifs. Cela pour-
rait refléter une certaine persistance des primes de ris-
que exigées, peut-être parce que les incertitudes des
agents mettent du temps à se dissiper.
Leur variance a diminué tendanciellement depuis
les années 1980. Si les agents sont rationnels, alors les
erreurs d'anticipation qu’il commettent sont de moins
forte ampleur.
Leur niveau et leur évolution sont similaires aux
États-Unis et en Allemagne depuis 1990. Le pro-
cessus d'intégration financière a sans doute participé à
cette évolution. C’est sans doute plutôt les «rende-
ments excédentaires» américains qui ont influencé
ceux de l'Allemagne que l'inverse11.
Leur moyenne sur 5 ans a légèrement diminué,
tendanciellement à partir de 1987 aux États-Unis,
et en deux temps en Allemagne, entre 1987 et
1994, puis à partir de 1998. La hausse des «rende-
ments excédentaires» moyens en Allemagne entre
1995 et 1998 reflète peut-être un ajustement en niveau
des biais allemands sur ceux des États-Unis, les taux
longs américains ayant une plus forte influence sur
ceux de l'Allemagne à partir de 1990.
Ces observations suggèrent ainsi que l’estimation des
taux futurs via les «rendements excédentaires»
(cf. encadré 1) est biaisée mais que le biais n’est pas
constant. Il semble avoir baissé tendanciellement, aux
États-Unis depuis 1987, et en Allemagne récemment.
3. L’évolution du biais pourrait refléter une
plus grande stabilité macro-économique
3.1 Une prise en compte de l’incertitude sur
l’avenir
Dans la mesure où les biais dépendent de l'incertitude
des agents sur l'avenir, ils devraient être en partie pré-
visibles. Cochrane et Piazzesi12 ont récemment mon-
tré qu'une combinaison linéaire de taux forward
observés ex-ante expliquerait jusqu'à 35% de la
variance des «rendements excédentaires» observés ex-
post, un an plus tard, aux États-Unis13. Ces excès de
rendements prévisibles refléteraient pour les auteurs
une prime de risque, qui aurait tendanciellement dimi-
nué depuis 1984.
Si l'accroissement de la stabilité économique a réduit
le niveau des primes de risque exigées sur les taux
longs, alors des variables capturant cette plus grande
stabilité devraient également permettre d'expliquer les
excès de rendements constatés sur les obligations.
C'est ce que l'on observe sur données américaines et
allemandes (cf. encadré 2).
3.2 L’estimation du lien entre biais et grandeurs
macro-économiques
Selon les estimations, une hausse de la volatilité du
PIB14 de 1 point impliquerait une hausse de 3,9
points des rendements prévisibles aux États-
Unis, et de 4,6 points en Allemagne, les agents
étant plus incertains sur la direction future du PIB. De
même, un élargissement de 100 pdb de la pente
des taux sur sa partie courte impliquerait une
hausse des rendements prévisibles de 5,1 points
aux États-Unis et de 7,0 points en Allemagne. La
pente de taux reflèterait l'incertitude des agents sur
l'orientation de la politique monétaire au-delà d'un an.
Elle pourrait capter par exemple une prime d'inflation.
Les «rendements excédentaires» ainsi prévus ont
tendanciellement diminué aux États-Unis depuis
1984. Cette baisse est en partie attribuable à la
moindre volatilité du PIB réel aux États-Unis.
Elle est passée de 3,5% en 1984 à 1% en 2005, ce qui
a conduit, toutes choses égales par ailleurs, à une
baisse de 10 points du niveau des «rendements excé-
dentaires prévisibles».
Au-delà de cette baisse tendancielle, il apparaît que les
«rendements excédentaires prévisibles» sont tempo-
rairement remontés au début des années 1990, puis au
début des années 2000. Entre ces épisodes, ils ont eu
tendance à diminuer, même s'ils présentent une cer-
taine persistance.
Ces évolutions sont très similaires à celles présentées
par Cochrane et Piazzesi. En particulier, les rende-
ments prévisibles tendent à évoluer de la même
façon que le taux de chômage américain. Ils reflè-
teraient donc une prime de risque plutôt que des
erreurs systématiques d’anticipation, les agents exi-
geant une rémunération plus forte lorsque le chômage
augmente.
10. Le prix de vente d'une obligation dans un an est incertain.
11. Test de Granger.
12. Cochrane et Piazzesi (2002) : «Bond risk premia», NBER Working
Paper n°9178.
13. Lorsque les rendements excédentaires sont calculés en supposant la
détention pendant un an d'une obligation de maturité dans 5 ans.
14. A chaque date, la volatilité du PIB réel est mesurée par l'écart-type,
sur les douze derniers trimestres, du taux de croissance en glisse-
ment annualisé du PIB réel.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%