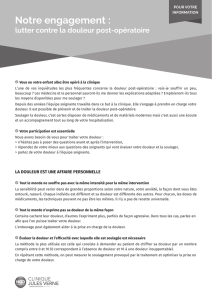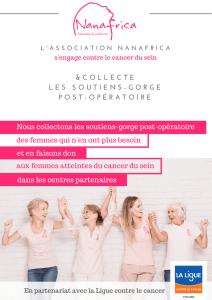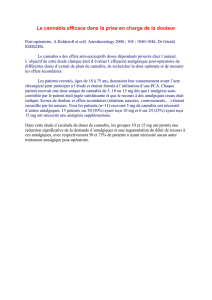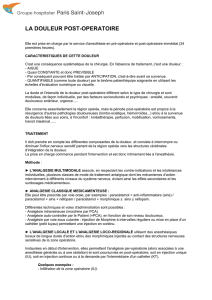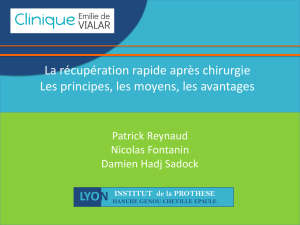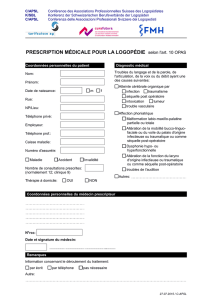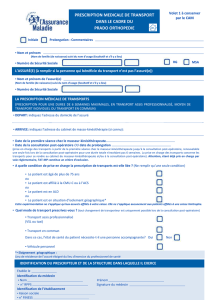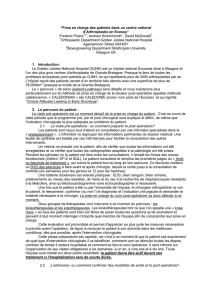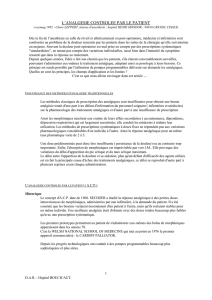la douleur post-opératoire aiguë de l`adulte : influence de la

Notre choix professionnel, le contexte international de
recherche sur la douleur et la médiatisation du sujet,
ont mûri notre volonté de réflexion sur la douleur
post-opératoire.
Un constat d’insatisfaction dans la prise en charge de
la douleur corroboré par les résultats globaux des seuils
douloureux relevés dans ce travail :
62 % des patients ont exprimé une douleur forte à très
forte en post-opératoire et l’audit récent publié par les
hôpitaux de Paris montrant que 46,4
%
des patients
souffrent en post-opératoire alors que nous disposons
des moyens de soulager leur douleur. Tout ceci nous
amène à vous présenter aujourd’hui ce travail.
Nous avons voulu connaître l’influence des concepts
sur une pratique. Nous nous sommes attachés à la
recherche d’une conception professionnelle de la dou-
leur.
La douleur aiguë post-opératoire possède des particu-
larités.
Mieux les connaître faciliterait-il notre pratique
3
Notre conception agit sur les différents de la prise en
charge.
En être conscient améliorerait-il la démarche de soin ?
LA DÉMARCHE
Cette recherche en soins infirmiers se situe au sein du
centre hospitalier d’Angoulême et a été réalisée sur une
période de deux mois, de Mars à Avril 1996. La ques-
tion posée est :
Peut-on améliorer la qualité de la prise en charge
para-médicale de la douleur post-opératoire immédiate
de l’adulte en chirurgie gynécologique et orthopédique
réglée en agissant :
-
sur la conception de la douleur par le personnel,
-
sur I’objectivation du syndrome douloureux
3
Elleconcerne la salle de surveillance post-intervention-
nelle, les unités de chirurgie orthopédique et gynécolo-
gique.
L’échantillon des patients sélectionnés doit répondre
aux critères suivants :
-
Avoir agréé leur participation à l’étude.
-
Sujets âgés de plus de
18
ans.
-
Ne pas subir une intervention en urgence.
-
Posséder une bonne compréhension des informa-
tions.
-
Subir une intervention de chirurgie orthopédique
ou gynécologique.
Jean-François GOUYOU , I.A.D.E. Centre Hospitalier d’Angoulême
Claude VIDAL, I.A.D.E. Centre Hospitalier d’Angoulême
LA DOULEUR POST-OPÉRATOIRE AIGUË DE L’ADULTE :
INFLUENCE DE LA CONCEPTION SUR LA PRISE EN CHARGE
Recherche en soins infirmiers N” 53 - Juin 1998

L’évaluation pour le choix de la participation à l’étude
sera faite la veille de l’intervention par I’IADE lors
d’une visite préopératoire.
De cet échantillonnage, ont été exclus deux groupes de
patients : ceux bénéficiant d’une chirurgie ambulatoire
pour des raisons pratiques et les IVG, par respect de
l’éthique.
Dans notre méthodologie, la création de trois outils
d’évaluation est apparue nécessaire.
L’élaboration d’un questionnaire anonyme et indivi-
duel destiné au personnel paramédical des services
concernés par l’étude.
Dans le but de mieux connaître
la
perception du con-
cept au sein même de la profession.
Cette conception est sans aucun doute
le
reflet de /‘idée
personnelle
de chaque soignant, comme nous pourrons
le constater au cours de l’analyse.
II ne s’agit pas de porter un jugement de valeur sur nos
pratiques, mais de trouver quelques voies de compré-
hension à nos attitudes.
Quant aux données pré-opératoires concernant le pa-
tient, elles ont été transcrites sur la fiche de recueil des
informations complémentaires lors de la visite la veille
de l’intervention dans le service.
La personnalité et les motivations, le niveau d’anxiété,
l’acte chirurgical accepté, désiré ou contraint, les expé-
riences algiques antérieures et attitudes habituelles vis-
à-vis de la douleur ainsi que la prémédication nous ont
paru être les éléments les plus importants.
Nous avons également conçu une fiche de surveillance
spécifique.
Elle suit le patient sur 24 h et y sont consignés
(à
chaque contact avec le patient) :
-
les paramètres hémodynamiques (Pouls et Tension
Artérielle),
-
la quantification de la douleur par le patient
(Echelle visuelle analogique descriptive),
-
l’appréciation cotée de la douleur par le personnel
paramédical,
-
le comportement,
-
la survenue d’événements particuliers,
-
le traitement prescrit, sa mise en oeuvre, son effica-
cité et ses effets secondaires.
l’auto évaluation du patient se fait sur sa propre
échelle de valeur et non la nôtre.
Evaluer permet de lever la barrière des expressions
affectives et placer le patient sur un canal normatif de
communication.
Dans la qualité de prise en charge de la douleur post-
opératoire, il nous paraît essentiel d’aborder le sujet de
l’évaluation de la douleur.
L’échelle visuelle analogique ou EVA développée par
HUSKISSON, se présente sous forme d’une réglette
horizontale avec une ligne horizontale continue de
10 cm dont les extrémités sont définies par divers qua-
lificatifs : douleur absente à l’extrémité gauche et dou-
leur maximale imaginable ou intolérable à l’extrémité
droite.
Le patient répond en déplaçant un curseur sur cette
I
igne.
La mesure s’effectue sur l’autre face de la réglette non
visible du patient au centimètre près.
D’utilisation simple et rapide elle est particulièrement
fiable, sensible, reproductible et non mémorisable.
Les âges extrêmes rencontrés dans notre étude nous
montrent bien qu’il n’existe pas de limite à la compré-
hension de I’EVA.
Une condition essentielle à notre avis est l’explication
de son utilisation en pré-opératoire.
Nous n’en sommes plus à discuter le bien-fondé de la
douleur des patients. Nous avons admis que : S’il dit
qu’il a
mal
c’est qu’il a
besoin
(quelle que soit la forme
de douleur exprimée)
d’être soulagé.
Evaluer la douleur est le moyen
de
connaître I’évolu-
tion de celle-ci dans le temps et d’apprécier l’efficacité
du traitement entrepris.
Nous avons donc dans cette étude, fait apparaître les
EVA dans les services d’hospitalisation.
Dans un but d’efficacité nous avons demandé une
mesure par auto évaluation chaque fois qu’il leur était
nécessaire d’intervenir dans la surveillance post-opéra-
toire.
II nous paraissait également intéressant de compléter
l’auto-évaluation par une hétéro-évaluation (par un
observateur).
Celle-ci consistait à consigner des paramètres physio-
logiques mesurés et les observations comportementa-
les.

LA DOULEUR POST-OPÉRATOIRE AIGUË DE L’ADULTE :
INFLUENCE DE LA CONCEPTION SUR LA PRISE EN CHARGE
Y seront notés, la survenue d’événements particuliers,
le traitement prescrit, son efficacité et ses effets secon-
daires.
Ainsi que l’appréciation cotée de 0 à 10 de la douleur
par le personnel para-médical. Pour les raisons de
l’étude, nous avons demandé que la cotation infirmière
soit faite en premier lieu et à la même fréquence que
les auto-évaluations.
Ces fiches sont mises en place dès la salle de sur-
veillance post-interventionnelle.
RÉPARTITION DES PATIENTS
L’échantillon observé est de 73 patients, dont 22
%
en
orthopédie, dans une population d’âge se situant entre
21 à 99 ans.
Ceci nous donne une moyenne d’âge de 49 ans, avec
une majorité située dans la tranche des 40 à 60 ans.
Cette répartition nous permet de situer la grande variété
des interventions rencontrées. La plus grande propor-
tion se situant sur les coelioscopies opératoires et diag-
nostiques que nous avons regroupées.
Nous avons également regroupé les différentes prothè-
ses : épaule, genou, hanche.
Au sujet de la répartition des soignants interrogés, nous
avons proposé ce questionnaire aux personnels des
services confrontés quotidiennement à la douleur post-
opératoire aiguë de l’adulte. Les unités de chirurgie,
réanimation et anesthésie.
LA DOULEUR POST-OPÉRATOIRE
ET SES COMPOSANTES
La douleur est un phénomène complexe qui intègre
plusieurs éléments :
La stimulation des afférentes nociceptives.
Une interprétation des influx par les centres supérieurs,
à laquelle participe la mémoire et la modulation par
des éléments affectifs et émotionnels.
Nous avons donc essayé de retrouver ces composantes
dans notre travail.
..>YZ
Caractéristiques de la stimulation nociceptive
II nous a semblé intéressant de porter notre étude sur
les 24 premières heures car nous savons que la douleur
post-opératoire aiguë est transitoire ; elle cède sponta-
nément en quelques jours.
Variable au cours du
nycthemère,
nous avons pu véri-
fier qu’il existait deux périodes où les patients
expri-
mentunpicdedouleur:de13hà15hetde17à18h.
Des interactions comme les sorties de salle de sur-
veillance post-interventionnelle, les relais antalgiques,
mobilisations et la fin des visites, limitent cependant
nos conclusions.
Imprévisible dans les individualités, certains types de
chirurgie s’avèrent plus douloureux (hystérectomies,
prothèses).
Nous constatons que plus la durée de l’intervention
augmente, plus les douleurs sont intenses bien qu’il
n’existe pas de relation directe entre la sévérité d’un
acte chirurgical et la douleur ressentie par le patient.
&
Composante cognitive
=.’
‘.-4W
(Mémoire et expériences antérieures)
Nous pouvons noter que les patients se disant intolé-
rants à la douleur ont paradoxalement exprimé des
valeurs maximales basses.
Par contre les patients qui nous font part d’une expé-
rience douloureuse antérieure (migraines, algies rebel-
les) décrivent des douleurs post-opératoires plus inten-
ses et ont des besoins en antalgiques supérieurs.
Cela appuie la théorie disant que la projection du
message douloureux au niveau cortical implique la
mise en route d’associations mentales d’angoisse, de
mort et de souffrance qui sont des résidants permanents
de notre mémoire.
Cette corticalisation, par des mouvements permanents
de biochimie cellulaire génère un effet de majoration
des expériences à venir.
II est à noter que les interventions à visée antalgique (les
prothèses) sont, elles aussi douloureuses en post-opéra-
toire, mais la douleur n’est jamais intolérable pour les
patients observés. L’espoir antalgique, s’il se fait atten-
dre reste pour le moins un moyen de passer un cap
difficile.

Tout cela étant modulé par des éléments affectifs et
émotionnels.
Nous pouvons constater que, sur l’échelle visuelle ana-
logique (EVA), les patients anxieux et très anxieux ont
en majorité exprimé leur douleur dans les tranches de
valeur des douleurs fortes à très fortes. (Déjà en 1985,
CHAPMAN, dans une étude, corrélait le niveau dou-
loureux et l’anxiété.) II faut préciser que notre travail ne
se base que sur l’anxiété pré-opératoire dite : anxiété
anticipatoire.
l’anxiété de situation, concomitante à la DP0 et I’an-
xiété trait, se définissant comme une prédisposition
générale à réagir de façon très émotionnelle à une
situation de stress, n’ont pu être incluses dans cette
étude (SCOTT en 1983 et FEINMAN en 1993 ;
«
les
influences sur le niveau de DP0
»).
La réapparition de la douleur se fait plus rapidement
chez les patients anxieux et très anxieux puisque 76 %
des anxieux et 75 % des très anxieux ont exprimé leur
maximum de douleur dans les 3 premières heures. On
peut donc confirmer que l’anxiété est un facteur direct
d’influente sur douleur post-opératoire.
Dans un autre ordre d’idée, on remarque une douleur
exprimée globalement plus élevée en post-opératoire
lorsque les interventions sont classées
«
mutilantes
»
(comme les hystérectomies, interventions qui ont la
réputation d’être douloureuses et génératrices de dé-
pression).
Dans les autres facteurs d’influente, de nombreux soi-
gnants ont constaté une modification dans l’attitude
des patients face à la douleur lorsque la famille était
présente.
On peut avancer ici avec précaution, compte tenu du
faible échantillonnage et des pourcentages rapprochés,
que cette analyse tend à montrer le bénéfice de la visite
des familles sur les patients. Les groupes de patients les
plus nombreux sont ceux qui expriment une douleur
inférieure pendant et après les visites de leurs proches.
Ce, d’autant que la réponse d’un malade peut être
modifiée par l’attitude de ses voisins. Cela demande
une réflexion sur l’aspect architectural, organisationnel
des locaux et la possibilité offerte de se distraire. La
qualité des soins prodigués peut donc être ainsi
amé-
I
iorée.
A coté de ces facteurs individuels, il faut citer d’autres
facteurs qui modulent la DP0 : qu’ils soient culturels,
ethniques, religieux, sociaux, professionnels ou fami-
liaux, ils demanderaient une étude sociologique locale
qui ne relève pas de notre propos.
On comprend aisément la notion de subjectivité, qui a
pendant longtemps freiné la prise en charge de la
douleur post-opératoire. La nécessité d’évaluation par
des outils fiables et validés apparaît comme évidente.
L’ensemble de ces facteurs
d’influente,
nous fait remar-
quer que si certains échappent à une action, d’autres
peuvent être modérés par une amélioration de notre
pratique.
DE LA CONCEPTION
A LA DÉMARCHE DE SOINS,
ÉLÉMENT DE NOTRE PRATIQUE
A travers la lecture des questionnaires recueillis, nous
constatons que, pour les personnes interrogées, la prise
en charge de la DP0 est majoritairement essentielle
voire importante. On ne dénie donc plus son existence.
Et pour la moitié des para médicaux ; elle est normale,
facultative et maîtrisable.
En ce qui concerne sa place dans le rôle infirmier, un
taux élevé de non-réponse nous interroge sur la con-
naissance des définitions de notre rôle.
Le rôle propre, qui est la reconnaissance et la mise en
œuvre d’actions infirmières nous paraît essentiel dans
le domaine de la prise en charge de la douleur, le
diagnostic infirmier le plus évident étant celui de la
douleur.
Le rôle délégué, qui consiste à mettre en oeuvre les
actions prescrites semble assez bien compris. II ressort
donc que pour un tiers des
prospects
la prise en charge
de la douleur ne fait pas partie de leur rôle propre et
seulement
1/5,
ne connaît d’autre moyens antalgiques
que médicamenteux. Le savoir-faire infirmier à tou-
jours beaucoup de mal à s’exprimer.
Voyons maintenant comment le ressenti de l’infirmière
peut avoir une action sur la prise en charge de la DP0 ?
Dans l’évaluation, en mettant en relation la cotation
infirmière et la mesure par EVA, on observe dans 35 %
des mesures que la plainte du patient est plus forte
qu’elle ne paraît à IDE.
Cette sous-estimation, se fait surtout lors de pics dou-
loureux. Ce phénomène d’écrétage des valeurs maxi-
mum, peut correspondre à une appréciation excessive
de l’action thérapeutique.
En poussant plus loin la réflexion, nous nous sommes
donc demandés s’il existait une administration d’antal-

LA DOULEUR POST-OPÉRATOIRE AIGUË DE L’ADULTE :
INFLUENCE DE LA CONCEPTION SUR LA PRISE EN CHARGE
gique après une cotation IDE supérieure à I’EVA, ou
une non-administration après cotation inférieure.
En règle générale, les cotations supérieures incitent à
administrer une thérapeutique, et peu de cotations in-
férieures entraînent une modification de I’administra-
tion.
On voit toute la nécessité de travailler sur l’idée que le
patient peut gérer seul sa douleur.
Cela d’autant plus que le principe de I’antalgie ne
semble pas être une évidence pour une partie du per-
sonnel soignant. Nous avons voulu mettre en lumière
les raisons de ces réticences.
La douleur reste un élément de diagnostic pour la
période post-opératoire, I’antalgie masque
«
toujours
»
cet élément pour une personne et
«
quelquefois
»
pour
314
des personnes. Une mise au point sur la sur-
veillance post-opératoire parait nécessaire, avec les
opérateurs.
La gêne à l’utilisation des morphiniques du fait de leurs
effets secondaires ; deux personnes répondent par un
franc
«
oui ». Deux c’est encore trop, mais nous nous
situons dans un processus d’évolution puisque
97
%
s’estiment à l’aise avec ce type d’antalgique.
La
DP0
est inéluctable pour 15 % des
prospects
et au
total 27 % des interrogés ne sont pas persuadés que
I’antalgie soit efficace.
On sait aujourd’hui que pour être au maximum de son
efficacité, I’antalgie doit être pro-active.
De sa précocité dépend sa mémorisation qui comme
nous l’avons vu dans la physiopathologie conditionne
le futur. Le blocage précoce du message douloureux
(avant le passage médullaire et donc avant le passage
cortical) va nécessiter des quantités d’antalgiques
moindres et va inhiber les effets nociceptifs plus diffici-
les à juguler dés lors qu’ils sont déjà installés.
Or nous pouvons voir que lors de soins douloureux
comme les mobilisations par exemple, un dixième seu-
lement est précédé de l’administration d’antalgiques,
les pansements eux sont d’avantages pris en compte,
puisqu’un sur deux est précédé d’antalgiques.
En ce qui concerne le mode d’administration de ces
antalgiques, la majorité des soignants apprécient en
théorie le traitement systématique de la
DP0
mais en
pratique administre plutôt à la demande.
Quelques explications sont à retenir :
-
«
Une standardisation
»
des protocoles antalgiques
qui implique une évaluation et une adaptation de la
prescription aux besoins exprimés du patient.
-
Problème organisationnel : La charge de travail ne
permet pas toujours d’assurer les horaires d’injection.
-
Et puis attendre la demande, c’est
«
peut-être quel-
que part
»
valoriser la fonction de soignant.
Les modifications apportées à la prescription dans I’ap-
plication du traitement sont, elles aussi, significatives.
II est clair que l’on modifie dans l’ensemble plus volon-
tiers les antalgiques non morphiniques. Nous remar-
quons ensuite, une plus grande majorité de modifica-
tions des soignants des unités d’anesthésie et de
réanimation.
On peut suggérer une plus grande habitude de manipu-
lation de ces produits (surtout morphiniques) de par
leur maniement quotidien, des connaissances pharma-
cologiques réactualisées, et la proximité immédiate
d’un médecin prescripteur. 86 % des patients ont reçu
des antalgiques en salle de surveillance post-interven-
tionnelle.
Le pourcentage de diminution dans l’administration est
constant dans les deux groupes ; nous considérerons
qu’il correspond à un taux de prescription inadéquate.
Pour toutes les raisons évoquées ci-dessus on voit que
l’amélioration passe par la formation.
POUR CONCLURE
Agir sur la conception de la douleur post-opératoire par
les IDE améliorera sans aucun doute la prise en charge.
Mais cet élément nous était-il totalement étranger
?
Une forte demande d’action de formation est exprimée
et elle doit se faire à tous les niveaux car la douleur
n’est pas l’apanage de ceux qui savent, en opposition à
ceux qui ne savent pas. Infirmiers, nous nous sommes
penchés sur nos pratiques mais l’efficacité de la prise
en charge de la douleur demeure l’affaire de toute une
équipe.
Le but à atteindre est de réduire la douleur post-opéra-
toire à un seuil tolérable pour le patient car s’intéresser
à sa douleur c’est s’intéresser à sa qualité de vie.
 6
6
1
/
6
100%