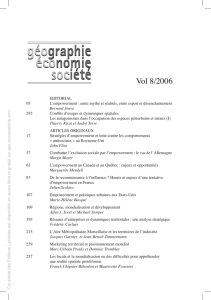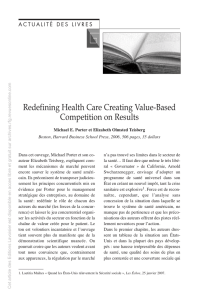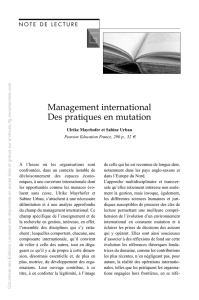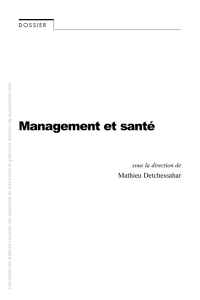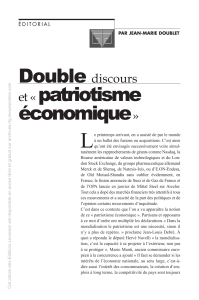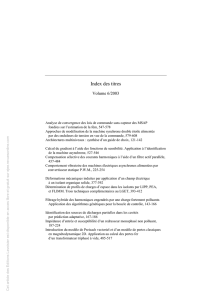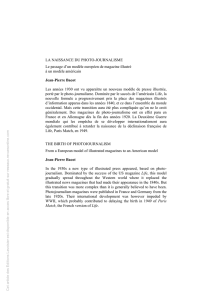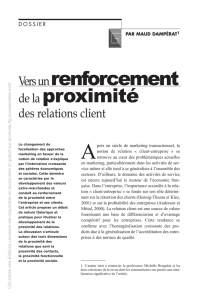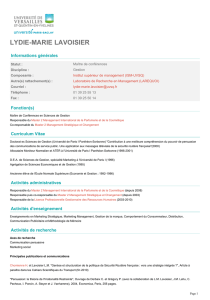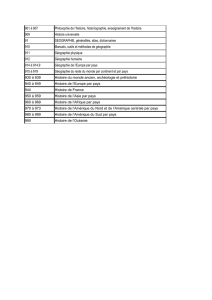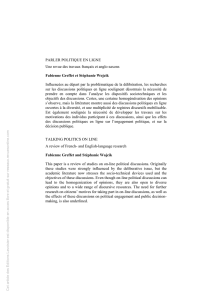géographie économie société géographie économie société

Géographie, Économie, Société 13 (2011) 213-220
géographie
économie
société
géographie
éco
nomie
soc
iété
Comptes Rendus
FrédéricLasserre(dir.)(2010),Passages et mers arctiques: géopolitique d’une région en
mutation,Québec,Pressesdel’UniversitéduQuébec,489p.
Un ouvrage imposant, par son volume, par l’abondance d’informations appuyées sur
une solide expertise et une non moins solide documentation, et qui en impose surtout par
les enjeux appelés à prendre une importance considérable dans les dix ou vingt prochaines
années. Le fait n’a pu passer inaperçu en Europe quand, à l’été 2007, les occupants d’un
sous-marin russe ont planté un drapeau en titane au fond de l’océan Arctique à l’endroit où
se trouve le pôle Nord. Chose certaine, les médias canadiens en ont fait grand bruit. On est
non moins possible nouvelle guerre froide suscitée par la convoitise des richesses naturelles
rendues disponibles par la fonte de la banquise estivale. Tout comme deux ans plus tôt, il a
été beaucoup question des manœuvres d’un brise-glace canadien, le si bien nommé Frozen
Beaver, dont la mission a consisté à rappeler aux Danois que le Canada était bel et bien pro-
priétaire de l’île de Hans. En effet, pas question de négliger les droits acquis sur cet îlot de
1,3 km² situé comme tout le monde le sait (sic) au centre du chenal Kennedy, dans le détroit
de Nares. Mais comme des accords signés entre Ottawa et Copenhague au siècle dernier ont
négligé de préciser le statut de cet îlot perdu, encore fréquenté par les seuls ours polaires en
voie rapide de disparition, il faut s’attendre à des rebondissements. Pourquoi? En vertu de
quels enjeux, et avec quelles conséquences prévisibles?
C’est ce à quoi ont tenté de répondre vingt auteurs comprenant une courte majorité
de femmes (douze). L’ensemble comprend sept géographes auxquels se sont ajoutés des
spécialistes du droit international, des sciences politiques et du transport maritime. F.
Lasserre, professeur au Département de géographie de l’Université Laval (Québec) a
eu la tâche de coordonner les efforts de cet aréopage tout en rédigeant trois des dix-neuf
chapitres de l’ouvrage qui comprend quatre parties visant à décrire l’ensemble de la pro-
blématique que suscite la fonte de la banquise d’été. D’entrée de jeu, si on sait qu’elle
sera fatale pour la survie des ours polaires et pour le mode de vie traditionnel des Inuit,
on nous apprend que l’on a rien à craindre du côté de l’élévation du niveau des mers. En
effet, si la fonte d’un glaçon dans un verre rempli d’eau ne fait pas déborder le verre en
question, le même principe de la physique hydraulique s’applique ici. La disparition de
cette imposante étendue glacée que les moins de 60 ans connaîtront assurément va ouvrir
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ges.revuesonline.com

Comptes rendus / Géographie, Économie, Société 13 (2011) 213-220214
une voie appelée à un fort taux de fréquentation : le fameux passage Nord-Ouest (PNO)
dont il est beaucoup question dans ce volume.
En introduction, on tente de répondre à la question suivante : qu’est-ce que l’Arctique?
de très nombreuses autres illustrations dont l’aspect pédagogique agrémente de beaucoup
tout au long du volume une lecture qui autrement deviendrait rapidement trop austère. En
-
gelé en permanence (le pergélisol dont les jours sont comptés). Oui, admettons-le : rien
ici pour animer les adeptes de la nouvelle géographie économique, habitués de la revue.
La première partie se rapporte au cadre climatique : le déclin rapide de la fameuse
banquise. C’est F. Lasserre qui ouvre le bal. Septique, voire légèrement optimiste (?) il se
demande si la banquise est vraiment destinée à disparaître à brève échéance. Probablement
pas sur une année entière d’après ses sources. En s’interrogeant sur les changements cli-
matiques et sur les possibilités d’une tendance inversée, il passe le relais à l’auteur du
chapitre suivant complétant ainsi cette première partie.
Le deuxième partie Controverses et débats : acteurs et enjeux politiques, avec ses huit
chapitres se veut la plus importante de l’ouvrage. On retrouve F. Lasserre qui s’interroge
cette fois sur les possibilités de confrontation ou de coopération que représente l’Arc-
tique. L’effondrement de l’empire soviétique n’a rien changé en ce qui concerne l’intérêt
de la Russie envers ce que représente la zone, autant comme lieu de passage que comme
pourvoyeur de multiples ressources naturelles. Un état de fait qui ne manque pas d’in-
quiéter les voisins immédiats des Canadiens. Eux aussi savent utiliser un brise-glace tout
aussi bien nommé que son homologue canadien : le Polar Sea qui, en 1985, avait soulevé
la controverse par sa balade à travers le PNO. Pour Washington, il n’y a pas l’ombre
d’un doute : le PNO constitue un détroit international, ouvert en conséquence à une libre
navigation. On comprend donc l’auteur du chapitre 7 quand il souligne que les États-Unis
s’opposent formellement aux prétentions canadiennes sur le PNO.
S’il y a lieu de s’inquiéter sur le sort réservé aux ours polaires comme nous y invitent
les documentaires animaliers (style Zoom animal), c’est aux conséquences des change-
ments climatiques sur les communautés inuit que se consacre le chapitre 9. Il s’agit ici du
proche avenir de pas moins de 50 000 Inuit dispersés en une cinquantaine de collectivités
à l’intérieur de quatre grandes régions, dotées d’une certaine autonomie administrative,
allant des Territoires du Nord-Ouest à la mer du Labrador. Personnellement, je n’avais
entendu parler que du Nunavut et du Nunavik (anciennement Nouveau Québec). C’est
dire que ces territoires ne font pas souvent la manchette des journaux canadiens. Pour ces
habitants, comme il est pertinemment souligné, les changements s’avèrent plus qu’une
menace théorique, il s’agit d’un problème quotidien.
Suivent la 3e partie Une nouvelle frontière à conquérir? et la dernière, Routes mari-
times et ressources naturelles : quels enjeux économiques? On le devine, ici, on a droit à
une batterie de questions se rapportant à l’avenir du tourisme, à l’ampleur des richesses
faire du PNO rien de moins qu’une autoroute maritime. On retrouve F. Lasserre dans un
minières et pétrolifères. Ici, comme pour d’autres contributions tout au long de l’ouvrage,
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ges.revuesonline.com

Comptes rendus / Géographie, Économie, Société 13 (2011) 213-220 215
des photos prises par l’auteur prouvent au lecteur que les écrits ne s’appuient pas unique-
ment sur une documentation très fouillée mais également sur des recherches in situ.
Le tout se termine par un vœu : en présence des enjeux majeurs qui se dessinent dans
l’Arctique, la souveraineté individuelle des États doit faire place la coopération. Peu
importe à qui appartient le PNO.
André Joyal
Université du Québec à Trois-Rivières
© 2011 Lavoisier, Paris. Tous droits réservés.
Diane-Gabrielle Tremblay, Juan-Luis Klein et Jean-Marc Fontan, 2009, Initiatives
locales et développement territorial,Montréal,Ed.Télé-Université,UQAM,353p.
Le trio québécois de chercheurs sociologues et géographes est connu pour ses travaux,
en équipe ou individuels, qui se situent aux frontières de leurs disciplines respective set
analysent, à travers les formes socio-organisationnelles, l’économie du savoir, l’anthro-
pologie économique du développement ainsi que les initiatives du développement local,
sous l’angle de l’économie sociale.
Les premiers chapitres, qui incluent chacun une bibliographie, passent en revue
les différentes approches du développement local, avec les initiatives, les concepts
et les enjeux, les systèmes locaux de production, et surtout le point le plus original
appliqué au Québec et au Canada, le rapport entre développement local et économie
sociale. Le chapitre 5, Cité créative et district culturel, offre d’ailleurs une base de
discussion, appuyée sur les cinq exemples de grandes villes canadiennes (Montréal,
Toronto, Ottawa, Vancouver et Québec), des thèses de Florida sur la classe et la ville
créatives, en en montrant aussi les limites. Le chapitre suivant est l’occasion de passer
en revue, au sujet de l’innovation socio-territoriale et des milieux innovateurs, les tra-
vaux de Schumpeter, Veblen et Polanyi, pour montrer que l’innovation est un processus
certes complexe, mais aussi multiforme et multidimensionnel. Il restait aux auteurs
à s’appuyer sur des études plus empiriques et des exemples concrets pour illustrer et
démontrer leur propos. C’est le cas à Montréal du technopole Angus, où est mis en
interventions successives de nouveaux entrepreneurs, de la ville de Montréal, du gou-
vernement Provincial du Québec et dans une moindre mesure du gouvernement fédéral,
puis du secteur privé. Il s’agit d’un long processus de négociations entre acteurs où
peu à peu sont évincés les acteurs sociaux d’origine. Plus brièvement sont abordés les
qui mériteraient des analyses suivies. Autre cas étudié, toujours à Montréal, celui de
l’industrie du vêtement qui est apparue fragilisée face à des concurrences internatio-
nales. Son adaptation, synonyme de re-développement, est venue de la constitution
de CDEC (Corporation de Développement Economique Communautaire), structures
intermédiaires chargées de redynamiser à la fois des secteurs urbains à l’échelle de ter-
ritoires limités ainsi que des domaines d’activités précises, tel le cas des designers des
quartiers Centre-Sud et Plateau Mont-Royal.
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ges.revuesonline.com

Comptes rendus / Géographie, Économie, Société 13 (2011) 213-220216
De cet ouvrage au contenu foisonnant, on retiendra surtout ce qui fait l’originalité du
cas québécois en matière de développement social et économique local : l’intervention
initiale d’acteurs locaux, d’origines très différentes, avec pour objectif, en s’appuyant sur
toutes les ressources possibles, de créer les conditions de formation et d’emploi, d’ouver-
ture vers de nouvelles activités innovantes ou de modernisation d’activités anciennes,
vers aussi des logements et des équipements, le tout circonscrit à l’échelle de territoires
infra-métropolitains ou bien de territoires ruraux de faible densité. Il s’agit d’un double
objectif, économique et social, souvent mobilisateur de multiples acteurs extérieurs, pou-
-
-
ticipatives multiples et variées, tout en permettant de nous interroger sur le rôle actuel des
municipalités et collectivités territoriales, de l’État et des organismes communautaires.
Jean-Marc Zuliani
Université Toulouse Le Mirail
© 2011 Lavoisier, Paris. Tous droits réservés.
Au-delà de l’analyse technique, un regard sociologique. Compte-rendu critique de
l’ouvrageLa sécheresse au Sahel. Vers une gestion concertéedeNathalieDubuset
JeanDubus,Lavoisier,2011,318p.
Un territoire : le Sahel. Il regroupe le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso,
le Niger et le Tchad, pays desquels l’ouvrage utilise des d’études permettant de dresser
l’état des lieux de ce que les experts appellent sécheresse1. Des problèmes : l’eau, son
approvisionnement et sa gestion pour les populations qui l’habitent. Les auteurs, respec-
tivement maître de conférences en géographie et hydrogéologue rendent compte d’études
démographique du territoire, d’en connaître les phénomènes climatiques, la structure géo-
logique, le milieu. L’ouvrage passe en revue toutes les connaissances liées à la mise en
valeur des ressources en eau, la manière dont sont gérées les inondations, les méthodes
pour favoriser l’accès des populations à l’eau, ainsi que les problèmes qui y sont direc-
tement liés. Il s’agit de trouver un système de mise en valeur plus élaboré que ceux qui
existent déjà (cultures en zaï ou demi-lunes, systèmes d’écoulement pour éviter les inon-
l’ouvrage est fortement tourné vers les sciences dures mais il est également intéressant
-
pour l’accès à l’eau et prendre conscience de la manière optimale de la gérer. On parle
(par exemple, le GIRE pour Gestion Intégrée des Ressources en Eau). Il s’agit de pro-
grammes mis en place pour éviter une concurrence entre les usages et les usagers de l’eau
1 Le Sahel s’étend plus à l’Est et comprend également le Soudan et l’Ethiopie
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ges.revuesonline.com

Comptes rendus / Géographie, Économie, Société 13 (2011) 213-220 217
besoins, de l’adhésion des différentes catégories d’utilisateurs et des dimensions sociales
et économiques de l’eau. Ainsi, on pourrait comprendre que ceux qui vivent sur le terri-
toire deviennent acteurs en ayant la possibilité d’exprimer leurs besoins auprès des orga-
nismes gestionnaires des projets. Ce type de mobilisation est devenu chose courante en
Afrique subsaharienne, où il semble que les règles qui régissent l’appropriation et la mise
en œuvre de projets de développement durable soient suivies de près, notamment par les
experts des pays du Nord.
Dans un premier temps, nous mettrons en évidence certains éléments clés pour avan-
cer la critique de l’ouvrage, à savoir, le choix du titre, le poids du volet économique,
l’association des populations au programme de développement, le rôle des pays du Nord
dans l’établissement des principes de gestion concertée ou encore l’analyse du système
expert qui nous est présenté. Dans un second temps, nous les articulerons à une analyse
plus approfondie au regard de recherches menées antérieurement sur le même type de
projets ou, de manière plus globale, sur le développement, les sciences et les techniques.
pays du Sud alors que ces derniers tentent d’apporter des solutions à des situations parfois
critiques, mais de mettre l’accent sur le jeu des acteurs engagés sur la scène de la gestion
concertée et d’interroger les conséquences de sa mise en œuvre d’un point de vue socio-
logique, plutôt que technique ou économique.
L’eau, où que ce soit dans le monde, suscite beaucoup d’attentions, toutes disciplines
non parce qu’elle est rare, mais parce qu’elle est nécessaire pour de nombreuses activités
humaines : boire, cuire les aliments, cultiver, abreuver le bétail, se laver, laver son linge.
Comme les auteurs le rappellent, le problème n’est pas tant le manque de ressources
hydriques que connaît le Sahel que les aménagements pour les utiliser (p.143). L’ouvrage
-
sur un aspect climatologique et laisse croire que les populations seraient juste mal situées
géographiquement. De la même façon, je m’interroge au sujet du sous-titre qui laisse
entendre qu’une large part de la mise en oeuvre des projets relève de la participation des
populations, alors que nous disposons de très peu d’informations sur les interactions entre
populations/gouvernements/experts - hormis le fait que la consultation est obligatoire
pour pouvoir accompagner (p.105-106), que la mise en place des programmes passent par
l’éducation et la sensibilisation (p.94, p.112-113, p.135). Aucune information ne relate la
manière dont les populations locales ont été abordées, réunies, concertées, alors que près
d’un tiers de l’ouvrage est consacré au fonctionnement du modèle d’expertise.
Ensuite, rappelons que le projet s’inscrit dans une logique de développement durable
qui associe l’économique, le social et l’environnemental. Ce qui est frappant dans le texte
est le poids que semble prendre le volet économique, apparaissant toujours comme sous-
conditions de vie possibles. Dans le cas présent, c’est par l’accès à l’eau que cet objectif
est visé. Les interrogations surgissent dès lors que se pose la question de sa gestion : qui
est responsable du puits ou du poste d’eau autonome et comment fait-on pour que l’ins-
tallation perdure ? L’instauration d’un système payant est présentée comme une solution
Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur ges.revuesonline.com
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%