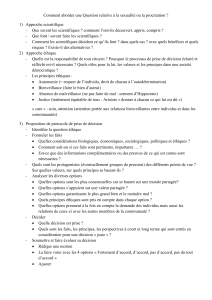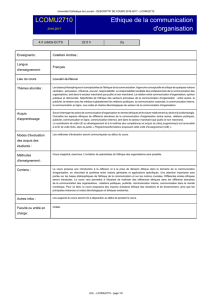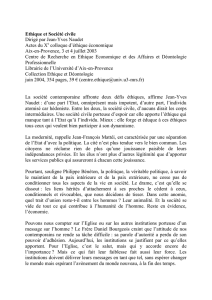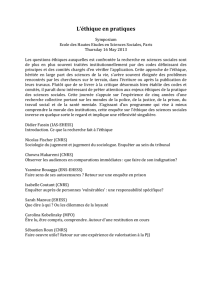Attitudes éthiques et perceptions des tactiques non éthiques de la

Attitudes éthiques et perceptions des tactiques non éthiques de la
négociation commerciale
Houda Zarrad*
Doctorante en Marketing
École Supérieure de Commerce de Tunis
Mohsen DEBABI
Professeur des Universités
École Supérieure de Commerce de Tunis
*Adresse : École Supérieure de Commerce de Tunis, Université de la Manouba, 2010 Tunisie
E-mail : houdazarrad@yahoo.fr
Téléphone : 00 216 97 317 438

Attitudes éthiques et perceptions des tactiques non éthiques
de la négociation commerciale
Résumé :
Cette recherche met l’accent sur le raisonnement éthique des négociateurs, le rôle de la
confiance dans la négociation et l'utilisation des tactiques de négociation considérées
généralement comme étant trompeuses.
Les résultats de notre étude effectuée auprès des étudiants ayant poursuivi une formation en
négociation commerciale, indiquent que les caractéristiques individuelles de la personne ont
un impact sur ses attitudes éthiques et que le niveau de confiance est un facteur prédictif de la
probabilité d'utiliser les tactiques non éthiques de négociation. Cette étude fournit des
implications pour le développement des stratégies de négociation capables d'augmenter la
compétitivité des négociateurs.
Mots-clés : orientation éthique, attitudes éthiques, tactiques non éthiques de la négociation,
confiance
Ethical attitudes and perceptions of unethical negotiation tactics
Abstract :
This research focuses on the ethical reasoning of the negotiators, the role of trust in
negotiation, and the use of negotiation tactics regarded as misleading.
The results of our study with a sample of students who were trained in business negotiation,
indicate that individual characteristics have an impact on ethical attitudes and that the level of
trust is a predictor of the likelihood of using unethical negotiation tactics. Thus, trust plays an
important role in the choice of negotiating tactics. This study provides implications for the
development of negotiation strategies that can increase the competitiveness of the negotiators.
Key-words: ethical orientation, ethical attitudes, unethical negotiation tactics, trust

1
Attitudes éthiques et perceptions des tactiques non éthiques
de la négociation commerciale
Introduction
Les normes éthiques en matière de négociation sont essentielles pour comprendre la nature du
jeu de négociation (Tsay et Bazerman, 2009). Cependant, un certain nombre d'études ont
évalué la validité perçue des tactiques de négociation (Lewicki et Stark, 1996; Menkel-
Meadow et Wheeler, 2004).
Les années 1990 ont vu un débat actif sur l'éthique de la tromperie dans la négociation.
Certains ont fait valoir que la tromperie est à prévoir dans la négociation et elle est
moralement acceptable (Strudler, 1995). En revanche, d'autres ont soutenu l’idée que la
tromperie est toujours inacceptable au niveau de l’éthique (Dees et Cramton, 1991) et ont
réclamés des standards normatifs de comportement de négociation. Plus récemment,
l'attention s'est déplacée vers une meilleure compréhension de l'éthique dans le contexte de la
négociation (Tenbrunsel, 1998; Tenbrunsel et Messick, 2004).
Lors de la négociation, les acteurs peuvent avoir des normes différentes selon qu'ils
s’engagent dans un comportement non éthique où ils sont la victime de ce comportement
(Babcock et Loewenstein, 1997). De plus, les parties développent ces normes différentielles
sans conscience (Banaji, Bazerman, et Chugh, 2003).
L’éthique est fondée sur une disposition individuelle à agir selon les vertus afin de rechercher
la bonne décision dans une situation donnée (Nillès, 2002). Cependant, les négociateurs
éthiques refusent de demander tout ce qu'ils ne veulent pas vraiment ou ne peuvent pas
vraiment justifier. Ils assument la responsabilité d’une part de faire leurs devoirs et d’autre
part de justifier ce qu'ils veulent (Byrnes, 1987).

2
Les contributions de (Messick, 1995, 1996; Messick et Bazerman, 1996) dans le domaine de
l'éthique des affaires se concentrent sur des modèles psychologiques du comportement non
éthique. Ainsi, Gino, Moore et Bazerman (2008) expliquent le processus psychologique par
lequel les individus évaluent le comportement non éthique. Les personnes qui traitent
l'information de cette manière ont tendance à négliger les actes contraires à l'éthique qui sont
dans leur propre intérêt. Par ailleurs, Lewicki, Saunders et Minton (1999) mettent l’accent sur
l'impact de divers facteurs démographiques sur le comportement éthique.
Perry & al. (2005) ont également trouvé que l’âge et le genre étaient significatifs en
expliquant les attitudes morales dans la négociation.
Notre intérêt dans cette recherche consiste à déterminer comment les négociateurs perçoivent
et distinguent les différentes classes des tactiques non éthiques de la négociation
commerciale. Cependant, nous cherchons à montrer si l’orientation éthique (relativisme
et idéalisme) des négociateurs et la confiance influencent les croyances éthiques générales,
et à savoir dans quelle mesure l’âge et le genre affectent l’éthique dans la négociation
commerciale.
1. Orientation éthique – Idéalisme et Relativisme
Les deux caractéristiques individuelles primaires des négociateurs sont l’idéalisme et le
relativisme (Al-Khatiba, Malshea et AbdulKaderb, 2008). Elles ont été également classées
comme orientation éthique de l’individu (Forsyth, 1980). Selon les théories modernes de
l’éthique des affaires (Ferrell et Gresham, 1985 ; Ferrell, Gresham, et Fraedrich, 1989), il est
généralement supposé que les différents individus, face à des situations de décision ayant le
contenu éthique, appliqueront des directives éthiques ou des règles basées sur différentes
philosophies éthiques.

3
Généralement ces philosophies éthiques peuvent être classées en deux grandes catégories :
déontologique et téléologique (Murphy et Laczniak, 1981). Ces deux types de philosophies
éthiques ont été distingués par Hunt et Vitell (1992) comme suit : "les théories déontologiques
se concentrent sur les actions ou les comportements spécifiques d'un individu, tandis que les
théories téléologiques mettent l’accent sur les conséquences des actions ou des
comportements''. Hunt et Vitell (1992) décrivent l'évaluation déontologique comme le
processus où on évalue l'exactitude ou l'inexactitude inhérente d'un ensemble évoqué de
solutions de rechange considérées comme lignes de conduite possibles. Cette évaluation
implique de comparer des comportements possibles à un ensemble de normes déontologiques
prédéterminées ou de directives prédéterminées qui représentent des valeurs ou des règles
personnelles du comportement. Si la morale commande au décideur par le biais de sa
conscience et si la déontologie lui indique le sens de son action, l'éthique lui recommande
d'agir d’une manière ou d'une autre en fonction du cadre d'action auquel il se réfère
(Bergadaà, 2004). Au sens littéral, la déontologie est un ensemble de codes de bonne conduite
propres à une profession (Lavorata, 2007). Ce terme, est défini comme "la morale
professionnelle" par Nillès (2001).
Quant à l'évaluation téléologique, les individus évalueront des comportements possibles en
tenant compte : (1) des conséquences perçues de chaque alternative pour différents groupes
d’intervenants, (2) de la probabilité que chaque conséquence se produise à chaque groupe de
parties prenantes , (3) de la désirabilité ou pas de chaque conséquence, et (4) de l'importance
de chaque groupe de parties'' (Hunt et Vitell, 2006).
Le paradigme déontologique / téléologique est semblable aux deux dimensions éthiques
personnelles de la philosophie du concept - idéalisme/relativisme de Forsyth (1980).
Conformément à Hunt et Vitell (2006), celles-ci peuvent également être caractérisées comme
des caractéristiques individuelles. Forsyth (1980) conceptualise le relativisme comme la
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%