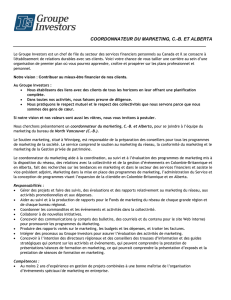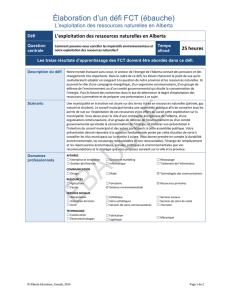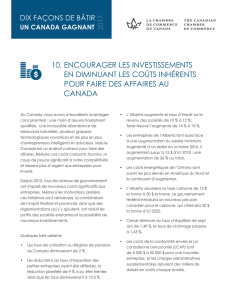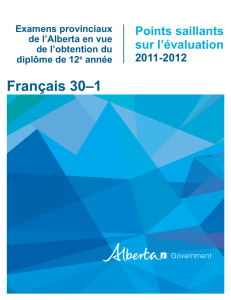L`Alberta bilingue : les racines constitutionnelles

L’Alberta bilingue : les racines constitutionnelles
Conférence prononcée lors de l’Assemblée générale annuelle de
l’Association des juristes d’expression française de l’Alberta (AJEFA)
Edmonton Petroleum Club, le 22 mai 2009
Edmund A. Aunger
Professeur de sciences politiques
Campus Saint-Jean, University of Alberta
1. INTRODUCTION
L’Alberta est née bilingue. En 1905, quand le premier ministre Wilfrid Laurier et son
gouvernement libéral ont créé la province, ils ont reconnu publiquement que l’Alberta
possédait, dès sa naissance, deux langues officielles, l’anglais et le français. Mais, ils ont
également avoué qu’ils ne feraient rien pour protéger ce bilinguisme, ni pour le perpétuer.
Au contraire, ils délégueraient à la nouvelle province le pouvoir de décider de son avenir
linguistique, tout en sachant qu’elle se ferait un plaisir de supprimer la langue française,
et cela, le plus rapidement possible. Aussitôt dit, aussitôt fait.
Ce que Laurier n’a pas anticipé, toutefois, c’était qu’une telle suppression serait illégale;
car, trente-cinq ans plus tôt, en 1870, la reine Victoria avait enchâssé ce bilinguisme
officiel dans la Constitution du Canada. Ainsi, le 2 juillet 2008, trois ans après le
centenaire de la province, le juge Leo Wenden de la Cour provinciale de l’Alberta a
confirmé le statut constitutionnel de la langue française, en décidant, dans la cause Caron,
que la Traffic Safety Act était inopérante, parce qu’elle n’avait pas été adoptée en
français.
2. ACTE DE L’ALBERTA, 1905
L’Alberta est née bilingue, en 1905, parce que sa loi constitutive, l’Acte de l’Alberta,
prévoyait, à l’article 16, la continuation des lois existantes. Parmi les lois existantes
maintenues en vigueur, se trouvait l’Acte des territoires du Nord-Ouest, et notamment
l’article 110, garantissant le statut officiel des langues anglaise et française à l’assemblée
législative et dans les cours de justice. D’après cette disposition :
« Toute personne pourra faire usage soit de la langue anglaise, soit de la langue
française, dans les débats de l’Assemblée législative des territoires, ainsi que dans les
procédures devant les cours de justice; et ces deux langues seront employées pour la
rédaction des procès-verbaux et journaux de l’Assemblée; et toutes les ordonnances
rendues sous l’empire du présent acte seront imprimées dans ces deux langues […] ».
Lors des débats sur l’Acte de l’Alberta, le ministre de la justice de l’époque, Charles
Fitzpatrick, a confirmé que, dans la mesure où l’article 110 était toujours en vigueur, il
aurait « force de loi dans la province après l’adoption du présent bill ».
Le gouvernement canadien aurait pu insérer l’article 110 directement dans l’Acte de
l’Alberta, ce qui aurait eu pour effet d’enchâsser explicitement le bilinguisme albertain
dans la Constitution du Canada. Ainsi, la langue française aurait été protégée de toute

abrogation unilatérale. L’Acte des territoires du Nord-Ouest était considéré comme une
loi ordinaire, et ses dispositions linguistiques étaient modifiables, semble-t-il, par le vote
d’un seul parlement, normalement celui qui les avait adoptées. L’Acte de l’Alberta, par
contre, était considéré comme une loi constitutionnelle, et ses dispositions linguistiques
auraient été modifiables, vraisemblablement, par l’accord de deux parlements, ceux de
l’Alberta et du Canada.
La Société Saint-Jean Baptiste d’Edmonton, le prédécesseur de l’ACFA régionale
d’Edmonton, a adopté une résolution implorant le gouvernement fédéral à insérer une
disposition sur le bilinguisme officiel dans l’Acte de l’Alberta. L’opposition officielle à
la Chambre des communes, et plus spécifiquement, le député conservateur et professeur
de droit constitutionnel, Frederick Monk, a même proposé un amendement au projet de
loi afin de constitutionnaliser le bilinguisme albertain.
Mais le premier ministre Laurier est resté implacable. En réponse à la Société Saint-Jean
Baptiste d’Edmonton, dans une lettre confidentielle adressée à Antonio Prince, ancien
député territorial de Saint-Albert, il a déclaré : « La question des écoles est déjà assez
embarrassante pour le gouvernement sans qu’elle soit compliquée par nos amis d’une
autre question tout aussi difficile et dont le règlement dans le sens que vous le voudriez
est absolument impossible ».
En réaction à l’opposition officielle, dans une intervention à la Chambre des communes
pour s’opposer à la proposition d’amendement, il a affirmé : « Je ne reconnais pas au
Parlement le droit d’imposer la langue française aux nouvelles provinces… Le
Parlement peut tout faire, mais je déplorerai le jour où les Canadiens-Français
demanderont au Parlement de faire une chose qu’il aura le pouvoir de faire sans en
avoir eu le droit » (p 8785-8786). Le parlement n’en avait pas le droit parce que, selon
Laurier, l’autonomie de la province devrait primer sur la protection de la minorité. En
outre, contrairement à la situation en 1877 lors de l’adoption de l’article 110, la
population anglophone était maintenant majoritaire. Alors, c’était normal, toujours selon
Laurier, que cette population majoritaire impose sa langue, la langue anglaise. D’où sa
conclusion : « je dis qu’on ne peut pas réclamer au nom de la justice l’usage officiel de la
langue française » (p. 8782).
3. SUPPRESSION DU FRANÇAIS
Nous en connaissons la suite. Formellement, le gouvernement de l’Alberta n’a abrogé
l’article 110 qu’en 1988, et cela, par l’adoption d’une Loi linguistique affirmant que :
« L’article 110 de l’Acte des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 50 des lois révisées du
Canada, 1886, en sa version du 1er septembre 1905, ne s’applique pas à l’Alberta pour
ce qui est des matières relevant de la compétence législative de celle-ci » (art. 7). Dans
la pratique toutefois, le gouvernement de l’Alberta l’avait supprimé dès 1905, et cela, par
le refus de reconnaître son existence et d’appliquer ses dispositions.
Premièrement, le gouvernement de l’Alberta a promulgué toutes ses lois uniquement en
anglais. La seule exception était la Loi linguistique, qu’il a dû adopter en anglais et en
français, afin d’assurer que l’abrogation de l’article 110 se faisait en bonne et due forme.

Deuxièmement, le gouvernement de l’Alberta a publié ses documents législatifs, dont ses
procès-verbaux et ses journaux, seulement en anglais. En 1919, il a même adopté une
modification à l’Interpretation Act imposant l’anglais pour tout document ou rapport
exigé par une loi : « Unless otherwise provided, where any Act requires public records to
be kept or any written process to be had or taken, it shall be interpreted to mean that
such records or such process shall be in the English language ». Cette disposition était
abrogée en 1980, lors de l’adoption des lois révisées.
Troisièmement, le gouvernement de l’Alberta a imposé l’emploi de la langue anglaise
dans les débats tenus à l’Assemblée législative. Ainsi, en 1987, quand le député Léo
Piquette s’est levé pour prononcer quelques mots en français, le président de l’Assemblée
a rétorqué, avec une ironie inconsciente : « En anglais s’il vous plaît…. The Chair directs
that the questions will be in English or the member will forfeit his position ». Pour éviter
que cette situation ne se reproduise, l’Assemblée a modifié son règlement permanent
pour affirmer que « the working language of the Assembly, its committees, and any
official publications recording its proceedings shall be in English ». Toutefois, la Loi
linguistique, adoptée l’année suivante, comme suite à la décision de la Cour suprême du
Canada dans l’affaire Mercure, dispose maintenant que « les membres de l’Assemblée
peuvent employer le français ou l’anglais dans l’Assemblée ».
Quatrièmement, le gouvernement de l’Alberta a exigé l’usage de la langue anglaise dans
ses tribunaux, les Rules of Court faisant de l’anglais la seule langue des plaidoyers et des
interrogatoires. La situation semblait connaître un revirement en 1988, quand la Loi
linguistique a permis l’usage du français pour les communications verbales, mais ce
nouveau droit est souvent enfreint par un manque et de sensibilisation et de ressources.
En 1996, dans la cause Desgagné, le juge Richard McIntosh de la Cour provinciale de
l’Alberta a annoncé : « With respect, you can do all the talking in French that you like
but in Alberta, with respect, Provincial matters are conducted in English, so if you’re
going to communicate with me you’ll have to do it in English, or you will have to have
somebody here that can assist you in English. But this trial is conducted in English.
That’s the law in Alberta, for Provincial Statutes ».
4. ENCHÂSSEMENT CONSTITUTIONNEL
Malheureusement, pendant toute cette période, ni le gouvernement albertain, ni le
gouvernement canadien ne tenaient compte du fait que, en 1870, la reine Victoria avait
publié un décret pour admettre la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à la
fédération canadienne, et que ce décret avait eu pour effet d’enchâsser le statut officiel de
la langue française dans la Constitution du Canada. Voici les circonstances entourant ce
décret si important, mais si peu connu.
Avant même la Confédération, le Canada convoitait jalousement la Terre de Rupert et le
Territoire du Nord-Ouest, ces vastes territoires britanniques qui s’étendaient de l’Alaska
jusqu’au Labrador et qui couvraient une superficie estimée à 7,2 millions de kilomètres
carrés.

Ainsi, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867, intitulé aujourd’hui la Loi
constitutionnelle de 1867, a prévu l’admission de la Terre de Rupert et du Territoire du
Nord-Ouest à la fédération canadienne, et cela, « aux termes et conditions, dans chaque
cas, qui seront exprimés dans les adresses et que la Reine jugera convenable
d’approuver […] » [art. 146]. Le 17 décembre 1867, lors de sa toute première session, le
parlement du Canada a adopté une telle adresse à la reine, la priant d’unir la Terre de
Rupert et le Territoire du Nord-Ouest à la Puissance du Canada et l’assurant de son
engagement « à prendre les mesures nécessaires pour que les droits légaux de toutes
corporation, compagnie ou particulier soient respectés et placés sous la protection de
cours de juridiction compétente ».
Quand les habitants métis de la Terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest ont
manifesté leur opposition à toute annexion faite sans leur consentement, le gouverneur
général du Canada, sir John Young, a cherché à les concilier en leur communiquant
directement les termes de cet engagement. Le 6 décembre 1869, il a émis une
proclamation au nom de la reine Victoria, adressée aux « fidèles sujets de Sa Majesté la
Reine dans Ses Territoires du Nord-Ouest » et déclarant que : « Par l’autorité de Sa
Majesté Je vous assure donc que sous l’Union avec le Canada, tous vos droits et
Privilèges civils et religieux seront respectés, vos propriétés vous seront garanties, et que
votre Pays sera gouverné, comme par le passé, d’après les lois anglaises et dans l’esprit
de la Justice Britannique ».
Le lendemain, le secrétaire d’État pour les provinces, Joseph Howe, a écrit au lieutenant-
gouverneur désigné, William McDougall, lui signalant l’expédition de cette proclamation
royale, et lui déclarant que : « You will now be in a position, in your communication with
the residents of the North-West, to assure them :– 1. That all their civil and religious
liberties and privileges will be sacredly respected. 2. That all their properties, rights,
and equities of every kind, as enjoyed under the Government of the Hudson’s Bay
Company, will be continued them. […] ».
Le 23 juin 1870, la reine Victoria a sanctionné cet engagement dans son Ordre en
conseil admettant la Terre de Rupert et le Territoire du Nord-Ouest, maintenant intitulé
le Décret en conseil sur la Terre de Rupert et le territoire du Nord-Ouest, et constituant
une partie intégrante de la Constitution du Canada.
Alors, quels étaient les droits légaux que le parlement du Canada s’est engagé à respecter,
et que la reine a accepté de sanctionner? Nos recherches démontrent de manière
concluante qu’ils comprenaient, parmi d’autres, le bilinguisme officiel au sein de
l’Assemblée législative et des cours de justice.
Premièrement, le Conseil d’Assiniboïa – le seul gouvernement civil dans la Terre de
Rupert – a promulgué ses lois en anglais et français. En 1846, il a également ordonné
que les lois soient lues à haute voix dans ces deux langues lors de certaines réunions
publiques.

Deuxièmement, le Conseil d’Assiniboïa devait publier ces documents publics en anglais
et en français. En 1851, son greffier a fait part de cette obligation à la Compagnie de la
Baie d’Hudson, et cela, pour justifier sa commande d’une imprimante équipée d’accents
français.
Troisièmement, le Conseil d’Assiniboïa a permis l’utilisation de l’anglais et du français
lors de ses réunions. Ses comptes rendus sont généralement rédigés en anglais, mais
comprennent parfois des interventions en français. Par contre, les comptes rendus de
diverses assemblées tenues en 1869 et 1870 indiquent que tout ce qui était dit en anglais
était interprété en français, et tout ce qui était dit en français était interprété en anglais.
Quatrièmement, le Conseil d’Assiniboïa a exigé l’usage de l’anglais et du français par sa
cour suprême, appelée communément la Cour générale. En 1849, par exemple, il a
adopté une résolution ordonnant que le juge en chef s’adresse à la cour dans ces deux
langues à chaque occasion impliquant des intérêts canadiens ou métis. En outre, lors des
procès où les intimés et les appelants étaient francophones, la procédure se déroulait
habituellement en français et les jurys étaient composés uniquement de francophones.
5. CONCLUSION
Alors, il n’est pas surprenant que l’évêque de Saint-Boniface, Alexandre Taché, avait
déclaré, en 1869, que : « La langue Française est non seulement la langue d’une grande
partie des habitants du N.O. elle est de plus elle aussi langue officielle … ».
Et, il n’est pas surprenant qu’une charte des droits adoptée par les habitants avait
revendiqué, en 1870, « That the English and French languages be common in the
Legislature and Courts, and that all public documents and Acts of the Legislature, be
published in both languages », et en plus, « That the Judge of the Supreme Court speak
the French and English languages ».
C’est sur la base de ces preuves que le juge Leo Wenden a conclu, le 2 juillet 2008, dans
la cause Caron, que la reine Victoria, par son Décret en conseil sur la Terre de Rupert et
le territoire du Nord-Ouest, avait effectivement enchâssé le bilinguisme officiel de la
future province de l’Alberta dans la Constitution du Canada. Ainsi, il a décidé que la Loi
linguistique de 1988, supprimant l’article 110, avait empiété sur les droits linguistiques
du défendant francophone, Gilles Caron. Il a également déclaré que la Traffic Safety Act,
et par implication toute législation albertaine, étaient inopérantes en vertu de leur
promulgation unilingue anglaise.
Le gouvernement de l’Alberta conteste cette décision, et la juge Kristine Eidsvik de la
Cour du banc de la Reine, qui a entendu son appel du 19 au 27 janvier 2009, devrait
annoncer son jugement cet automne. Néanmoins, on peut s’attendre encore à d’autres
appels, d’abord à la Cour d’appel de l’Alberta, et puis à la Cour suprême du Canada,
avant que la question soit réglée de manière définitive. Espérons que les Canadiens
apprendront un jour, non seulement que l’Alberta est née bilingue, mais aussi que
l’Alberta reste toujours bilingue.
1
/
5
100%