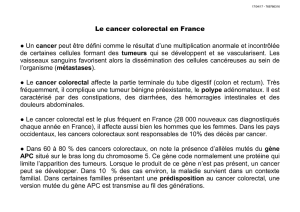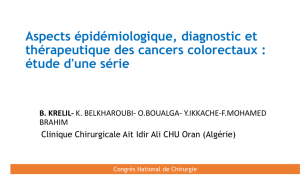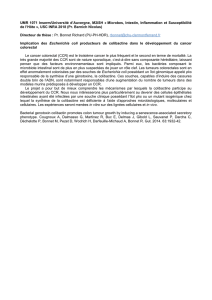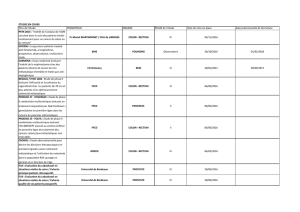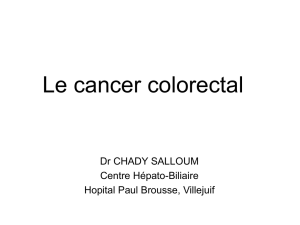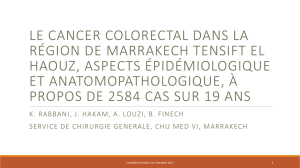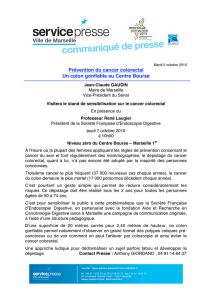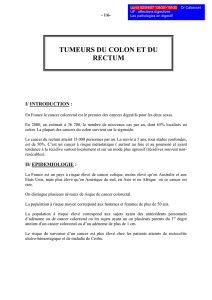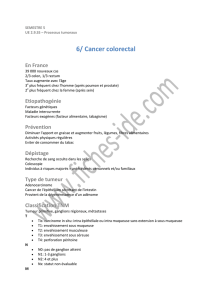GROS PLAN sur le cancer colorectal

Santé-Mag
- N° 03 Février 2012
28
Le cancer colorectal (CCR) est un problème, mondial, de santé publique. Avec une incidence, annuelle, d’environ 1,2 million de nou-
veaux cas et une mortalité, annuelle, de plus de 600000 décès, le nombre, absolu, de cas est en augmentation, constante, du fait du
vieillissement et de l’expansion des populations, dans le monde. L’incidence, la plus élevée, est trouvée en Amérique du nord et en
nouvelle Zélande ; la plus faible, en Afrique et en Asie.
Le cancer colorectal est la seconde cause de mortalité, dans le monde, par cancer, chez les deux sexes. En Algérie, le cancer colo-
rectal est classé en troisième position, après le cancer du poumon et de la vessie, chez l’homme et le cancer du sein et du col uté-
rin, chez la femme (INSP2007).
GROS PLAN
sur le cancer colorectal
Par le Dr Adda BOUNEDJAR
et le Pr Farida SMAILI, service d'oncologie
médicale, Centre anti cancer de Blida
La plupart des cancers colorectaux ré-
sultent de la dégénérescence d’adé-
nomes sporadiques et de polypes
adénomateux. Les formes familiales (PAF
et HNPCC) représentent 6 à 10%. Le
risque de cancer colorectal varie, selon les
pays. Il diffère, également, entre les indi-
vidus, selon leur alimentation, leur mode
de vie et les facteurs héréditaires.
Le cancer colorectal est le cancer diges-
tif, le plus fréquent, pour les deux sexes.
Selon Globocan 2008, base du centre in-
ternational de recherche, sur le cancer
(IARC CIRC), le cancer colorectal re-
présente 663000 nouveaux cas, dont
320000 décès, chez l’homme et 570000
nouveaux cas, dont 288000 décès, chez la
femme. En 2008, le cancer colorectal re-
présentait 9,7% de l’ensemble des cancers
pour les deux sexes. Il est plus fréquent en
Australie 46/100000, Nouvelle Zélande
44,1/100000 et certaines parties de l’Eu-
rope Allemagne 45,2 et Espagne
39,7/100000 ainsi qu’au japon
41,7/100000. Une incidence intermé-
diaire, supérieure à 20 par 100000, est ob-
servée en Amérique latine, en France, en
Suède et en Russie. Une incidence faible
< 20/100000 est enregistrée en Asie, en
Amérique du sud, et en Afrique (sauf
l’Afrique du sud.).
En Algérie, selon l’enquête nationale,
2002, de l’institut national de la sante pu-
blique (INSP), le cancer colorectal est au
deuxième rang, pour les deux sexes, avec
une prévalence de 2269 cas, soit 7,8%.
Chez l’homme, la prévalence a été de
1180 cas soit 7,1% après le cancer du pou-
mon. Chez la femme, la prévalence a été
de 1082 soit 7,1% après le cancer du sein
et du col utérin.
Le cancer colorectal est la troisième
cause de mortalité dans le monde, après
les cancers du poumon et du sein, avec
plus de 600000 cas de décès soit 8% de
l’ensemble des décès. Les taux de morta-
lité par âge pour le CCR, chez l’homme
et la femme, dans les pays occidentaux
sont restés stables, tout au long du XXe
siècle. Ils pourraient, maintenant, com-
mencer à diminuer. A l’inverse, des chan-
gements rapides sont en train de se
produire dans des pays considérés, jusque-
là, comme étant à risque faible.
En Europe, la mortalité a augmenté
dans les régions du sud et de l’est,
contrairement aux pays du nord et du
centre du vieux continent. Les données
épidémiologiques permettent de définir,
comme sujets à risque moyen, les indivi-
dus asymptomatiques des 2 sexes de plus
de 50 ans, sans antécédent personnel ou
familial, leur conférant un risque élevé.
Le risque, net moyen, d’être atteint d’un
cancer colorectal, avant 74 ans, est éva-
lué à 3,5%.
Des études, contrôlées et randomisées,
réalisées dans la population générale, chez
des personnes âgées de 45 à 75 ans, ont
démontré qu’un programme de dépistage,
basé sur le test Hémoccult ®, répété tous
les deux ans et suivi d’une coloscopie, en
cas de positivité, peut diminuer la morta-
lité, par CCR, de 15 à 18%, 8 à 10 ans,
après sa mise en place. Parmi les sujets à
risque élevé, le groupe le plus important
est représenté par les apparentés, au 1er
degré, de sujets atteints d’un cancer CCR.
Un tel antécédent est trouvé chez, envi-
ron, 15% des sujets atteints d’un CCR.
Le risque d’être atteint d’un CCR avant
74 ans, qui est de 3,5% dans la population
générale, augmente à 6%, lorsqu’il y a 1
apparenté au 1er degré et à 10%, lorsque
l’apparenté avait moins de 45 ans, au mo-
ment du diagnostic ou lorsqu’il y avait 2
apparentés, au 1er degré, atteints.
Les résultats, des différentes études de
cohorte et cas-témoin, ont permis d’éla-
borer, lors de conférence de consensus sur
le cancer du côlon (Paris, 1998) des re-
commandations, en matière de préven-
tion ; une coloscopie de dépistage est
conseillée chez tout apparenté, au 1er
degré, d’un malade atteint de CCR avant
60 ans, ou si 2 parents sont atteints d’un
CCR, quel que soit l’âge au diagnostic. La
coloscopie est faite à partir de 45 ans ou 5
ans avant l’âge, au diagnostic du cas index
le plus précoce. Des recommandations,
équivalentes, concernent les apparentés
au 1er degré de sujets atteints de gros adé-
nomes> 1 cm et /ou, avant 60 ans, égale-
ment, à risque élevé.
Les sujets atteints d’adénome unique
Le risque est multiplié par 4, chez les su-
jets, atteints d’un adénome avec struc-
tures villeuses ou de plus d’un centimètre
de diamètre et multiplié par 7, si ces adé-
nomes sont multiples.
Santé-mag >DOSSIER>CANCER

Santé-Mag
- N° 03 Février 2012 29
< 1 cm de diamètre n’ont pas un risque
de CCR supérieur à celui de la popula-
tion générale. Dans les autres cas, une sur-
veillance coloscopique, tous les 3 ans
suffit (sauf si la qualité de préparation co-
lique et/ou de l’exérèse coloscopique est
douteuse). Après une coloscopie nor-
male, la surveillance peut être espacée à 5
ans. Personnels d’adénome ou de cancer
colorectal chez les sujets atteints d’adé-
nomes colorectaux, le risque de cancer
colorectal dépend des caractéristiques des
adénomes découverts, initialement. Le
risque est multiplié par 4, chez les sujets
atteints d’un adénome avec structures vil-
leuses ou de plus d’un centimètre de dia-
mètre et multiplié par 7, si ces adénomes
sont multiples. Chez les sujets, atteints
d’un ou plusieurs adénomes de moins de
1 cm de diamètre, le risque de cancer co-
lorectal ne diffère pas, significativement,
de celui de la population générale. Dans 2
à 5 % des cas, le CCR survient dans un
contexte d’agrégation familiale, évoquant
le rôle d’un facteur génétique. Les mala-
dies, prédisposant au CCR, sont des ma-
ladies héréditaires, dont la transmission
est autosomique, à forte pénétrance (plus
de 90% des sujets, atteints d’une muta-
tion constitutionnelle, présentent un
CCR et à expressivité variable). Actuel-
lement, trois maladies, associées aux gènes
majeurs de susceptibilité du CCR, ont
été identifiées : Polypose adénomateuse
familiale (PAF) ; la polypose associée au
gène MYH(MAP).
Outre les facteurs génétiques, la res-
ponsabilité de l’environnement et des fac-
teurs alimentaires, dans le développement
des CCR est, maintenant, un fait établi.
Le colon est subdivisé en deux parties :
Le colon droit, sous la dépendance du pé-
dicule mésentérique supérieur, com-
prend : le caecum, le colon ascendant,
l’angle colique droit et les 2/3 droits du
colon transverse. Le colon gauche, sous la
dépendance du pédicule mésentérique
inférieur, comprend : le 1/3 gauche du
colon transverse, l’angle colique gauche,
le colon descendant et sigmoïde. Le Rec-
tum est le segment terminal du tube di-
gestif qui fait suite au colon sigmoïde. Il
comporte deux parties : le rectum pel-
vien, qui mesure 12 à 15 cm, dérivé de
l’intestin primitif, ayant un méso dorsal
(méso rectum) et le rectum périnéal, ou
canal anal, qui mesure 3- 4 cm, corres-
pondant aux sphincters ; repérable par le
toucher rectal. Le Rectum est divisé en
trois parties de 5 cm, chacune : le haut
rectum qui fait suite au sigmoïde, le
moyen et le bas rectum.
Le plus souvent atypique, vague ou lo-
calisée au cadre colique ou évoluant par
crise d’aggravation progressive et cédant
par une débâcle de selles ou de gaz ; trou-
vée, dans 50% à 60%, dans le cancer du
côlon droit et 60 à 80%, dans le cancer du
côlon gauche ; parfois sous forme de té-
nesme ou d’épreinte pour les tumeurs
rectales. Les troubles du transit sont fré-
quents, sous la forme d’une diarrhée re-
belle, constipation inhabituelle ou d’une
alternance des deux même ; un syndrome
dysentérique avec glaires muco-purulente
(tumeur villeuse). Ils sont trouvés dans
50 à 80% de tumeurs coliques gauches,
20 à 40 % de tumeurs coliques droites et
16% dans les tumeurs rectales.
Hémorragies : Révélées, soit par des
rectorragies dans 75% des tumeurs rec-
tales ou méléna, surtout dans les cancers
caecal ou coliques droits et parfois, des
anémies, chroniques, dans 5 à 20 % des
cas.
Autres Symptômes :
– Stade de complication : occlusion
aigue:
Le cancer est la première cause d’oc-
clusion ; observée dans 10 à 20 % des
cancers coliques gauches ; avec dilata-
tion colique; en amont.
•perforation colique : Elle survient dans 1
à 8% des cas, faite de brèche unique, sou-
vent située dans le caecum, parfois le
transverse ou les angles coliques.
• Fistules : Les fistules entéro cutanées,
par envahissement pariétal, sont excep-
tionnelles ; les fistules internes se font par
extension aux organes de voisinage.
•Révélation par des métastases – Lym-
phatiques : la palpation peut trouver un
ganglion sus claviculaire gauche (ganglion
de Troisier).
• Hépatiques : l’examen peut trouver une
hépatomégalie douloureuse.
• Péritonéale : avec une ascite, témoi-
gnant d’une carcinose péritonéale.
L’examen physique est, le plus souvent,
normal.
• On découvre, rarement, une masse ab-
dominale : il s’agit d’une masse ferme, ir-
régulière, peu sensible et bien limitée.
L’appréciation de la mobilité est une
étape, importante, de l’examen. Cepen-
dant, la palpation de cette masse est, sou-
vent, laborieuse, en raison de l’adiposité,
importante, de la paroi abdominale, chez
beaucoup de patients ; surtout si la tu-
meur est de siège colique droit.
• L’examen est complété par la mesure de
la flèche hépatique, à la recherche d’une
éventuelle hépatomégalie, dont il faut ap-
précier la surface et la consistance. – Tou-
cher rectal (TR) : Il permet le diagnostic
des tumeurs du bas rectum et apprécie ses
caractères : dure ou friable à base indurée,
irrégulière et le doigtier souillé de sang. Il
est combiné au toucher vaginal chez la
femme pour apprécier la cloison recto-va-
ginale.
• L’examen général : L’interrogatoire pré-
cise les antécédents carcinologiques per-
sonnels et familiaux, à la recherche d’une
maladie héréditaire et permet la réalisa-
tion d’un arbre généalogique. Il faudra re-
chercher, systématiquement, une
adénopathie sus claviculaire (Ganglion
de Troisier). La tumeur est, rarement, ac-
cessible à la palpation. Une hépatoméga-
lie avec hépatalgie et ictère évoque des
métastases hépatiques ; une ascite peut
évoquer une carcinose péritonéale. L’ex-
ploration d’une anémie microcytaire est
le mode de diagnostic de 10% des cancers
du côlon. Rechercher un amaigrissement
et apprécier son importance ; évaluer
l’état cardio-vasculaire, pulmonaire et
rénal du patient.
Coloscopie : C’est l’examen diagnostic
de référence ; il permet l’évaluation, cli-
nique, de la lésion, de faire des biopsies et
de rechercher des lésions associées. Avec
une sensibilité de 96,7 % et une spécifi-
cité de 98 %, explore la totalité du recto-
colon : Le colon ascendant et le Cæcum
sont atteints, dans 78% des examens; ses
complications diminuent, avec l’expé-
rience : 0.1 à 0.2% de perforations et
0.04% de mortalité. L’aspect macrosco-
pique, le plus souvent trouvé, est une lé-
sion ulcéro-végétante, hémorragique, au
contact de l’endoscope, obstruant, le plus
souvent, la lumière digestive. L’examen
permet, également, de réaliser des biop-
sies, dont le nombre doit être supérieur à
3, afin de réduire les faux négatifs - dont
le taux reste de l’ordre de 16%-, de préci-
ser les limites, supérieures et inférieures,
de la tumeur, par rapport à la marge anale,
L’aspect macroscopique, le plus
souvent trouvé, est une lésion ul-
céro-végétante hémorragique,
au contact de l’endoscope, obs-
truant, le plus souvent, la lu-
mière digestive.
Santé-mag >DOSSIER>CANCER

Santé-Mag
- N° 03 Février 2012
30
quand le franchissement tumoral est pos-
sible, d’explorer tout le recto-colon, à la
recherche d’un éventuel autre cancer,
dont la fréquence est, en moyenne, de 4.4
% et de polypes de plus de 1 cm de dia-
mètre. L’examen permet, en outre, l’ex-
ploration colique une exérèse à la pince
ou à l’anse diathermique de lésions poly-
poïdes, dont l’analyse anatomo - patho-
logique est systématique, entre autres.
Coloscopie virtuelle : Elle correspond à
la reconstruction virtuelle du colon, à
partir d’examen tomodensitométrique
(TDM) ou d’imagerie par résonance ma-
gnétique (IRM) 192.
Elle nécessite une préparation colique
de qualité, et ne permet pas de différen-
cier des stercorites des lésions muqueuses.
Cet examen peut être douloureux et
source de complications. Il ne permet pas
la réalisation de prélèvements histolo-
giques, et méconnaît les adénomes plans
à fort potentiel dégénératif.
Traitement spécifique :
Armes thérapeutiques : Chirurgie : C’est
le traitement curatif.
a) Le cancer du côlon : - l’exérèse de la tu-
meur primitive, avec des marges de colon
sain de 5 cm. Modalités: suivant la locali-
sation: Chirurgie radicale - Hémi-colec-
tomie Droite: exérèse du colon droit, -
Hémi-colectomie Gauche: exérèse du
colon Gauche - Sigmoidectomie: exérèse
du colon pelvien limite, à la jonction
recto-sigmoïdienne, avec un curage gan-
glionnaire - Colectomie segmentaire:
exérèse de la tumeur, en passant 4 cm
d’une part et d’autre de celle-là. Avec cu-
rage ganglionnaire - Colectomie totale ou
subtotale: emportant tout le colon
b) Cancer du rectum : Interventions
conservatrices : - Résection antérieure du
rectum : exérèse par voie abdominale du
rectum et du méso rectum.
L’anastomose est colorectale (ACR)
ou colo anale (ACA), manuelle ou méca-
nique. Interventions mutilantes: - Am-
putation abdomino-périnéale (AAP):
résection, par voie abdominale, du bas
sigmoïde, du rectum pelvien avec le méso
rectum - Intervention d’Hartmann: pas
de rétablissement de continuité. Elle se
termine par une colostomie iliaque
gauche, le plus souvent temporaire,
s’adressant aux cancers du haut et du
moyen rectum, chez les sujets fragiles, ou
dans le cadre de l’urgence .
Radiothérapie : elle est indiquée dans le
cancer du bas et moyen rectum : Chi-
miothérapie :
c) Protocoles utilisés : -FUFOL : Acide fo-
loinique (AF): 20 mg/m. J1. J5 (en 2
heures). 5FU : 425 mg/m. J1. J5 (en
bolus de 30 min) Cycle de 28 jours -
LV5FU2 AF : 200 mg/m. J1-J2 (en 2
heures 5FU : 400 mg/m. J1-J2 (en bolus
10 min. 5FU : 600 mg/m. J1-J2 (continu
de 22 heures) Cycle 14 jours. -FOLFIRI:
Irinotecan : 180 mg/m. J1+ LV5FU2
cycle de 14 jours -FOLFOX 4 : Oxalipla-
tine : 85 mg/m. J1 + LV5FU2 cycle de
14 jours -Xeliri : Irinotecan : 240 mg/m.
J et Xéloda : 1000 mg/m. en 2 prises J1.
J14 ; cycle de 21 jours -XELOX:OXA-
LIPLATINE 130mg/m² et Capécitabine
1000mg/m², deux fois par jours, pendant
14 jours ; un cycle tous les 21 jours.
érapie ciblées :
• depuis 2004,elles sont utilisées, en com-
binaison avec un protocole de chimio-
thérapie(Bevacizumab, Cetuximab) Elle
augmente la survie des cancers colorec-
taux métastatiques avec des survies mé-
dianes de 21-25 mois.
Modalités de chimiothérapie : Chimio-
thérapie néo-adjuvant. : Réservée aux
cancers colorectaux, avec métastases hé-
patiques, afin d’obtenir ou d’améliorer la
résécabilité, ou dans les cancers rectaux,
localement avancée.
Chimiothérapie adjuvante : Son but est
de lutter contre la composante micro mé-
tastatique et augmenter la survie Elle est
indiquée dans le cancer colique, stade III
ou stade II, avec facteurs de mauvais pro-
nostic.
Chimiothérapie palliative : Son but est
d’augmenter la survie et d’assurer le
confort du patient. Elle est indiquée, dans
les formes évoluées et métastatiques 9.
Surveillance, après un traitement, a visée
curative, d’un cancer colorectal : - un exa-
men clinique tous les 3 mois pendant 2
ans, puis tous les 6 mois, pendant 3 ans -
Une échographie abdominale, tous les 3
mois, durant les 3 premières années, puis
annuelle, les 2 ans suivantes. - Une radio-
graphie pulmonaire annuelle, pendant 5
ans - Une coloscopie 3 ans après l’inter-
vention, puis tous les 5 ans, si elle est nor-
male. - Dosages des marqueurs tumoraux
(ACE), tous les trois mois. Conclusion :
Le cancer colorectal est un problème
mondial de santé publique, avec une in-
cidence, annuelle, de plus de 1,2 million
de nouveaux cas et plus de 600000 décès,
par an.
En Algérie, le cancer colorectal est
classé en troisième position, après le can-
cer du poumon et celui de la vessie, chez
l’homme et le cancer du sein et du col
utérin, chez la femme.
Le risque de CCR varie, selon les pays
et même à l’intérieur d’un même pays. Il
diffère, également, entre les individus,
selon leur alimentation, leur mode de vie
et les facteurs héréditaires. La moitié des
cancers colorectaux sont diagnostiqués
tardivement (localement avancés et/ou
métastatiques). 70% des patients sont
porteurs de métastases hépatiques ?
Devant les récents progrès thérapeu-
tiques, enregistrés ces dernières années,
dans les traitements des cancers colorec-
taux avancés, grâce au traitement chirur-
gical, qui comprend la résection
chirurgicale des lésions en un ou plusieurs
temps, possiblement combinée avec la ra-
diofréquence ou la cryothérapie. Ainsi,
d’importants progrès ont été réalisés, avec
l’utilisation en pratique quotidienne de
l’oxaliplatine, de l’irinotecan, ou d’ana-
logues oraux de la 5 fluoro-uracile (capé-
citabine ou UFT).
L’identification de nouvelles cibles mo-
léculaires a permis le développement de
nouveaux agents anti-tumoraux, dirigés
contre des récepteurs de facteurs de crois-
sance ou contre les principaux facteurs
impliqués dans le processus d’angioge-
nèse. En 40 ans, les progrès des chimio-
thérapies des CCRM ont permis
d’améliorer la survie, médiane, des ma-
lades, de six à 20 mois.
La prise en charge des malades présen-
tant des CCRM doit être multidiscipli-
naire, selon les standards thérapeutiques,
pour donner aux patients une meilleure
prise en charge et mettre en place une
stratégie thérapeutique, complexe.•
Santé-mag >DOSSIER>CANCER
1
/
3
100%