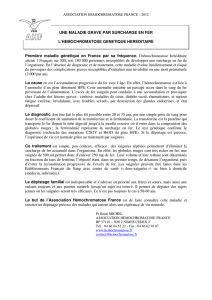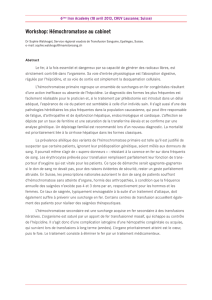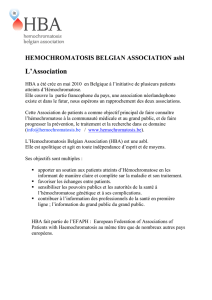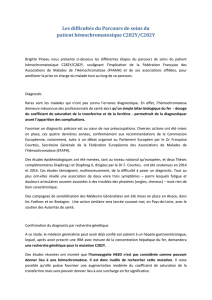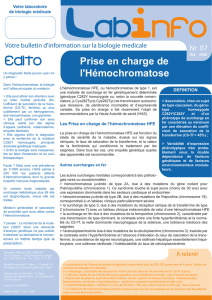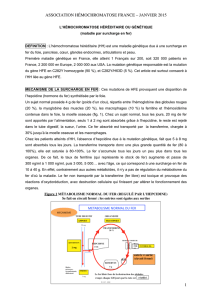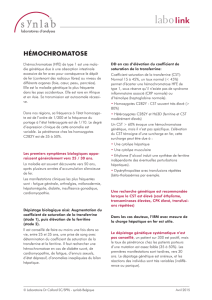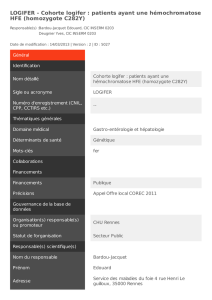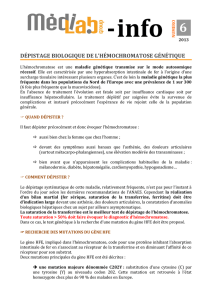Hémochromatose génétique HFE : aspects

doi:10.1684/abc.2012.0731
405
Pour citer cet article : Ropert-Bouchet M, Fajardy I, Michel H. Hémochromatose génétique HFE : aspects réglementaires et économiques du diagnostic et de la prise en
charge. Ann Biol Clin 2012 ; 70(4) : 405-11 doi:10.1684/abc.2012.0731
Synthèse
Ann Biol Clin 2012 ; 70 (4) : 405-11
Hémochromatose génétique HFE :
aspects réglementaires et économiques
du diagnostic et de la prise en charge*
Hereditary hemochromatosis HFE: regulatory and economic aspects
of diagnosis and medical management
Martine Ropert-Bouchet1
Isabelle Fajardy2
Henri Michel3
1Laboratoire de biochimie,
CHU de Rennes
<mar[email protected]>
2Institut de biochimie et biologie
moléculaire, Lille
3Association hémochromatose France,
Nîmes
Article rec¸u le 02 avril 2012,
accept´
e le 20 avril 2012
Résumé. L’hémochromatose génétique HFE est une affection de longue durée
(ALD no17 – Maladies métaboliques et héréditaires) qui reste la première
maladie génétique en France (60 % de l’ensemble des maladies génétiques).
Elle est parfaitement codifiée par la Haute autorité de santé (HAS) quant à la
liste des actes et des prestations autorisés et leur cotation, afin de limiter les
dépenses de santé inutiles. La recherche de la mutation C282Y du gène HFE
permettant de confirmer le diagnostic est prise en charge par la sécurité sociale
depuis 2007 (dans certaines conditions). Le traitement par saignées est bien
codifié. Il doit débuter en milieu hospitalier et est en général bien toléré. La
récupération du sang des patients (dons-saignées) depuis avril 2009 dans des
Établissements franc¸ais du sang était souhaitée par certains malades et assure
un apport supplémentaire à la transfusion sanguine. Cependant, si cette maladie
génétique est bien connue du point de vue scientifique (mécanisme et toxicité
de la surcharge en fer, gène...) et du point de vue thérapeutique (saignées), le
diagnostic est toujours trop tardif par méconnaissance des symptômes.
Mots clés : hémochromatose, réglementation, aspects économiques
Abstract. HFE hereditary hemochromatosis is a chronic illness (ALD
no17 – Maladies métaboliques et héréditaires) which is the first genetic disease
in France (60% of all genetic diseases). The list of medical acts and the services
supported by the French national health insurance fund are fully codified by
the French national authority for health (HAS) in order to reduce unnecessary
health care spending. The search for the C282Y mutation of the HFE gene to
confirm the diagnosis is supported by French national health insurance fund
since 2007 (under certain conditions). Treatment by phlebotomy is well esta-
blished. It should begin in hospital and is generally well tolerated. Since April
2009, the use of the patient’s blood (phlebotomy – blood donations) in French
blood centers provides an additional contribution to blood transfusion. However,
if this genetic disease is well known to the scientific viewpoint (mechanism and
toxicity of iron overload, gene...) and therapeutically (bleeding), the diagnosis
is always made too late by ignorance of the symptoms.
Key words: hemochromatosis, regulatory, economic aspects
∗Travail réalisé dans le cadre du Groupe de veille SFBC « Fer et hémochromatose ».
Membres du groupe : Patricia Aguilar-Martinez (Coordonnateur), Carole Beaumont, Muriel Bost,
Joël Corberand, Véronique David, Gérard Dine, Isabelle Fajardy, Victoria Gerolami, Jean-Louis
Berge-Lefranc, Anne-Marie Jouanolle, Henri Michel, Daniel Seifer, Jérôme Pfeffer, Catherine
Vallat, Martine Ropert, Victor Sieso, Jean-Pierre Vinel
Tirés à part : M. Ropert-Bouchet
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

406 Ann Biol Clin, vol. 70, n◦4, juillet-août 2012
Synthèse
Modalités de prise en charge
de la maladie et coût
La prise en charge
L’hémochromatose (HFE ou hémochromatose de type 1)
est une pathologie génétique de transmission autosomique
récessive, caractérisée par une surcharge en fer progressive
de l’organisme. Elle est liée majoritairement à la présence
à l’état homozygote de la mutation C282Y du gène HFE.
L’hémochromatose génétique HFE est une affection de
longue durée (ALD no17 – Maladies métaboliques et
héréditaires). Les modalités de prise en charge du sujet
homozygote pour C282Y dont le diagnostic vient d’être
établi ont été précisées par la Haute autorité de santé (HAS)
dans le cadre de recommandations professionnelles [1].
Cette prise en charge doit être adaptée au stade d’expression
phénotypique du patient. Les paramètres cliniques et biolo-
giques qui ont servi de base pour établir une classification
en 5 stades de sévérité croissante de l’expression de
l’homozygotie C282Y sont présentés dans le tableau 1.
La liste des actes et prestations pour la prise en charge d’un
patient atteint d’hémochromatose liée au gène HFE, définie
par la HAS en 2005 et actualisée en mars 2010 [1, 2], cible
les bilans qui peuvent apparaître justifiés pour un malade
en affection longue durée, lors d’un suivi ambulatoire. Elle
doit servir de base aux protocoles de soins pour les patients
en ALD. Cette liste comporte des actes de biologie et des
actes techniques réalisés par certains professionnels.
Concernant les actes de biologie, on trouve les paramètres
suivants :
– coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf) : bilan
initial (stades 0 et 1) et suivi ;
– ferritinémie : bilan initial (stades 0 et 1) et suivi ;
– hémogramme y compris plaquettes : bilan initial (stades
2, 3 et 4), et suivi ;
– transaminases (ASAT, ALAT) : bilan initial (stades 2, 3
et 4) et suivi si anomalie initiale ;
– glycémie : bilan initial (stades 2, 3 et 4) et suivi si ano-
malie initiale ;
– testostérone (sang) : bilan initial (stades 3 et 4) (homme).
Concernant les actes techniques, la liste des examens
trouve :
– échographie hépatique : bilan initial (stades 3 et 4) et suivi
si fibrose significative ;
Tableau 1. Les différents stades de l’hémochromatose génétique avec en corollaire l’expression clinique et biologique.
Stade 0 Stade 1 Stade 2 Stade 3 et 4
Expression clinique Pas de symptômes Pas de symptômes Pas de symptômes Phase d’expression clinique
Expression biologique *CS-Tf <45 % CS-Tf >45 % CS-Tf >45 % CS-Tf >45 %
Ferritinémie normale Ferritinémie normale Hyperferritinémie Hyperferritinémie
* CS-Tf : coefficient de saturation de la transferrine.
– échographie cardiaque : bilan initial (stades 3 et 4), et
suivi sur avis spécialisé, IRM plus rarement ;
– ostéodensitométrie : bilan initial (stades 2, 3 et 4) en
présence de cofacteurs d’ostéoporose ;
– IRM hépatique : bilan initial (stades 2, 3 et 4) en cas ou
non de cofacteurs d’hyperferritinémie (alcool, syndrome
métabolique, etc.) sur avis d’un spécialiste en hépatologie ;
– ponction biopsie hépatique : suspicion de cirrhose (ou de
cancer).
Ainsi, aux stades 0 et 1 (absence d’hyperferritinémie),
aucun examen paraclinique n’est recommandé en complé-
ment de l’examen clinique et du bilan martial standard
(CS-Tf et ferritinémie). Au stade 2, en plus de l’examen
clinique et du bilan martial, l’exploration doit compor-
ter un hémogramme, un dosage des transaminases, de la
glycémie ainsi que la réalisation d’une ostéodensitomé-
trie et d’une IRM hépatique. Aux stades 3 et 4, en plus
des examens précédemment cités, le bilan recherchera
d’éventuelles atteintes hépatiques, cardiaques ou gona-
diques avec des examens échographiques, et un dosage de
la testostéronémie. En fonction des données obtenues, le
patient sera orienté vers des consultations professionnelles
dites « en recours systématique » ou « en cas de nécessité »
(tableau 2). Ainsi, certaines situations particulières de
complications faisant l’objet d’hospitalisation peuvent être
à l’origine d’actes et de soins non listés ici.
À propos des professionnels en recours systématique,
l’Association hémochromatose France (AHF), association
de malades comportant 1 879 adhérents, propose d’ajouter
le médecin du travail et le psychiatre aux praticiens impli-
qués. En effet, la plupart des patients en activité souffrent
fréquemment de fatigue chronique, ainsi que d’un état
dépressif ignoré survenant en réaction de leur maladie, avec
un retentissement sur l’activité professionnelle. Ces mani-
festations sont d’autant plus évidentes dans les métiers où
les conditions de travail sont dites « pénibles ». La dimi-
nution de l’efficacité et de la productivité au travail sont
souvent mal tolérés par l’employeur, car la maladie « ne se
voit pas ». En effet, le patient hémochromatosique est rassu-
rant sur son aspect physique : les douleurs, l’état dépressif
ne transparaissent pas. Ainsi, la consultation de médecins
du travail ou de psychiatres permettrait à ces patients d’être
entendus.
En ce qui concerne les actes techniques, l’échographie
hépatique et le dosage de l’alpha-fœtoprotéine devraient
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Ann Biol Clin, vol. 70, n◦4, juillet-août 2012 407
Hémochromatose génétique
être réalisées tous les 6 mois dès que la ferritine dépasse
1 000 g/L, mais aussi en phase de désaturation. En effet,
le cancer primitif du foie peut survenir sur foie désaturé et
même non cirrhotique [3, 4].
Le coût des tests et examens biologiques
recommandés
La nomenclature et le coût des actes de biologie médicale
recommandés pour la prise en charge d’un patient atteint
d’hémochromatose sont présentés dans le tableau 3.
Concernant le bilan martial, la capacité totale de saturation
de la transferrine (CTST) est déterminée par calcul à partir
du dosage de la transferrine selon la formule suivante :
CTST (mol/L) = transferrine (g/L) x 25
En cas de prescription de coefficient de saturation en
fer de la transferrine (CS-Tf), c’est-à-dire du rapport fer
sérique/CTST, (exprimé en %) le laboratoire exécute et cote
les actes 0548 (fer) et 2000 (CTST) pour ce calcul, soit un
coût de 9,99 D. La cotation de l’acte 2000 (CTST) n’est pas
cumulable avec celle de l’acte 1819 (dosage de la trans-
ferrine, coté B25 s’il est réalisé isolément). Le nombre de
Tableau 2. Liste des professionnels médicaux impliqués dans la
prise en charge de l’hémochromatose génétique.
Professionnels Situations particulières
Recours systématique
Médecin généraliste Tous les patients
Hépato-gastro-entérologue Tous les patients
Recours en cas de nécessité
Rhumatologue
En fonction du stade et de
l’existence de complications
Endocrinologue
Cardiologue
Médecin interniste
Généticien
Hématologue
Radiologue
Infirmier Traitement à domicile
prescriptions du CS-Tf a augmenté de plus de 6 000 % entre
2005 et 2007. Il est passé de 9 000 à 609 000 [5].
Le coût de la recherche de la mutation du gène HFE en
C282Y homozygote correspond à B180, soit 48,60 Dselon
la valeur de la lettre clé B à 0,27 Dau 1er janvier 2011.
La recherche de la mutation (Journal officiel du 30 mars
2007, décision effective le 30 avril) a été retenue dans 2
indications : contexte individuel, contexte familial.
De nombreux actes sont réalisés avant que le diagnostic
d’HG soit posé. Selon une enquête de l’AHF effectuée
auprès de 257 patients entre 2003 et 2006, une dizaine
d’années serait nécessaire pour établir ce diagnostic. Selon
cette enquête, avant le diagnostic, les patients ont consulté 4
généralistes et 5 spécialistes (rhumatologue : 17 %, gastro-
entérologues : 25 %, cardiologues : 18 %, urologues:6%,
gynécologues:3%,divers:3%).Ilsontbénéficié de
bilans sanguins (12 %), d’échographies diverses (2 %),
de radiographies osseuses (19 %), pulmonaires (12 %),
d’ostéodensitométries (20 %). Certains d’entre eux ont dû
être hospitalisés. Des prothèses de hanche (9 %), épaule
(2 %), ont été réalisées chez des malades dont le diagnostic
d’HG n’était pas posé. Des arrêts de travail ont été prescrits
(25 %) parfois sur un an. Des invalidités complètes (8 %)
ou partielles ont été prescrites (2 %).
Coût des différentes stratégies
diagnostiques
Un arbre décisionnel proposé en 2001 [6] permet de conce-
voir à partir du coefficient de saturation les différentes
stratégies aussi bien individuelles qu’en dépistage de masse.
Le diagnostic individuel
Dans le cadre du diagnostic individuel, deux situations sont
possibles :
– au cours d’un bilan systématique où est retrouvée une
augmentation de la ferritine et/ou du coefficient de satu-
ration de la transferrine plus exceptionnellement. Après
Tableau 3. Nomenclature des actes de biologie médicale, codes et cotations des différents examens.
Paramètres Codes nomenclature Cotation clé B Valeur euros*
Fer sérique 0548 B9 2,43
Capacité totale de saturation de la transferrine (CTST)** 2000 B20 5,4
Coefficient de saturation de la transferrine (CS-Tf)*** 0548 + 2000 B12 + B25 7,83
Ferritine 1213 B40 10,80
Hémogramme 1104 B32 8,64
Transaminases (ASAT + ALAT) 522 B20 4,05
Glycémie 552 B5 1,35
Testostérone 357 B65 17,55
* Selon la valeur de la lettre clé B à 0,27 Dau 1er janvier 2011 ; ** La CTST a remplacé la capacité de fixation du fer avec dosage du fer (2007).
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

408 Ann Biol Clin, vol. 70, n◦4, juillet-août 2012
Synthèse
avoir vérifié que cette augmentation n’est pas secondaire
à une autre étiologie (dysérythropoïèse, transfusions, insuf-
fisance hépatocellulaire, syndrome néphrotique, inflamma-
tion, alcoolisme...), le test HFE est réalisé et l’homozygotie
C282Y repérée ;
– au cours d’un bilan orienté chez un patient qui présente
des signes suggérant une hémochromatose. Le diagnostic
doit être évoqué devant une présentation polymorphe avec
des symptômes chroniques tels qu’une asthénie chronique,
des arthralgies des 2eet 3edoigts, une impuissance sexuelle,
une mélanodermie, un diabète. Les signes biologiques
peuvent retrouver une élévation des marqueurs sériques du
fer (CS-Tf, ferritinémie), une hyperglycémie, une hyper-
transaminasémie modérée. Le diagnostic est confirmé par
la recherche de la mutation C282Y.
Ce dépistage individuel est exceptionnel entre 20 et 35 ans :
l’Association hémochromatose France estime à moins de
10 % le pourcentage des malades aujourd’hui diagnostiqués
à cette période de la vie. La plupart de ces diagnostics indi-
viduels sont faits à 50-60-70 ans sur des manifestations qui
sont des complications de l’HG : diabète de type 1, dégâts
articulaires, cardiomyopathies, cirrhoses ou même hépato-
carcinomes. Les saignées, qui sont toujours à réaliser, sont
moins efficaces (tableau 5).
L’examen des caractéristiques génétiques est encadré par
la législation franc¸aise (décret 2000-570 du 23 juin 2000)
[7]. Il pose en effet des problèmes spécifiques car il touche
l’individu dans sa nature intime et dans ses liens avec sa
famille. Le résultat, quel qu’il soit, peut avoir des répercus-
sions sur la vie personnelle et familiale ; il peut être ressenti
comme une anormalité, voire une discrimination.
La pratique des tests génétiques [7] implique donc le respect
d’un certain nombre de règles qui sont résumées ci-dessous :
– le test ne peut pas être réalisé comme un examen de
routine et ne doit pas être prescrit en première intention ;
– avant le test, le sujet doit avoir compris la nature de
l’examen, la signification des résultats, et les conséquences
éventuelles en termes de suivi ou de traitement ;
– l’information doit être donnée par un médecin qui a des
compétences en génétique médicale. Elle doit être directe
et orale pour permettre un dialogue, puis consignée sur un
document écrit ;
– le sujet doit avoir donné spécifiquement son consente-
ment écrit avant la réalisation du test. Une fois testé, il peut
refuser de connaître ses résultats et son droit de ne pas savoir
doit toujours être respecté ;
– l’annonce des résultats doit être faite directement au sujet
(probant) par un médecin qui, par sa compétence, peut
expliquer la signification des résultats ;
– le secret médical doit être respecté vis-à-vis des tiers,
y compris les autres membres de la famille. Ces derniers
ne doivent pas être sollicités directement par le médecin.
Si un sujet refuse de faire connaître à sa famille le risque
révélé par le test génétique qu’il a subi, le médecin est dans
l’impossibilité de contacter les apparentés. Il doit infor-
mer le sujet testé de sa responsabilité et tout faire pour le
convaincre d’informer ses proches.
Le dépistage familial
Il est accepté et pris en charge par la sécurité sociale. Une
fois le diagnostic d’hémochromatose C282Y homozygote
porté chez l’un des membres d’une famille, le dépistage
familial chez les apparentés de premier degré du probant
homozygote C282Y est recommandé [1]. Ainsi, le probant
doit être informé personnellement par le médecin traitant
ou spécialiste de la maladie, sur les avantages (et les incon-
vénients éventuels) d’une démarche de dépistage pour les
membres de sa famille et les probabilités pour chacun
d’entre eux d’être homozygote C282Y et de développer
la maladie. Il est demandé au probant d’informer tous les
membres de sa fratrie, ses enfants majeurs et ses parents sur
l’intérêt de réaliser des examens biologiques (Cs-Tf, ferri-
tinémie) ou génétiques (test HFE). Seul le probant a le droit
d’informer ses apparentés.
Chez un sujet hétérozygote simple pour la mutation C282Y,
aucun suivi n’est nécessaire sauf en cas d’anomalie des
paramètres biologiques indiquant une surcharge martiale.
La confirmation génétique chez les parents n’interviendra
qu’en fonction des résultats des premiers tests biologiques
et après confirmation de leur valeur supérieure à la normale.
Pour les apparentés au 2nd degré, la démarche d’information
peut être adaptée et proposée en fonction des données de
l’arbre généalogique.
Compte tenu de l’histoire naturelle de la maladie, le dépis-
tage, biologique ou génétique, chez les enfants mineurs du
probant n’est qu’exceptionnellement utile. Selon les textes
réglementaires en vigueur, étant non nécessaire, il n’est
donc pas légitime de le réaliser que ce soit sous la forme
d’un dépistage biologique ou génétique. Pour ce cas parti-
culier des mineurs, le décret du 23 juin 2000 précise que
les examens des caractéristiques génétiques « ne peuvent
être prescrits que si ces derniers (les enfants mineurs) ou
leur famille peuvent personnellement bénéficier de mesures
préventives ou curatives immédiates ». Ces recommanda-
tions sont à mettre en parallèle avec les avis du Comité
consultatif national d’éthique franc¸ais. L’avis no25 de 1991
porte sur l’application des tests génétiques aux études indi-
viduelles et familiales ainsi qu’aux études de population. Il
a servi de base à l’élaboration du décret du 23 juin 2000
et indique que l’analyse du génotype d’un enfant mineur
demandée par les parents ne doit être effectuée que si la
maladie liée à ce génotype peut se déclarer avant 18 ans ou
si l’enfant mineur peut bénéficier de mesures préventives
instaurées avant 18 ans. Compte tenu de l’histoire naturelle
de la maladie, les cas d’hémochromatose symptomatique
chez des enfants mineurs sont exceptionnels.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Ann Biol Clin, vol. 70, n◦4, juillet-août 2012 409
Hémochromatose génétique
Le dépistage dans la population générale
Le dépistage de l’hémochromatose génétique HFE dans
la population générale, qu’il soit phénotypique ou géno-
typique, n’est pas, à ce jour, recommandé par la HAS [1].
Cependant, l’HG correspond aux critères définis par l’OMS
[8] pour les maladies devant bénéficier d’un dépistage. En
effet :
– l’HG représente un problème de santé publique impor-
tant : 1 Franc¸ais sur 300 est porteur de mutations du gène
HFE et l’hémochromatose est responsable d’une dimi-
nution significative de la durée de vie chez les malades
porteurs de complications au moment du diagnostic, alors
que les malades diagnostiqués et traités avant l’apparition
de ces complications ont une durée de vie identique à celle
de la population générale ;
– l’histoire naturelle de la maladie est connue ;
– son diagnostic (tests biologiques précis, test génétique de
confirmation) et son traitement (saignées) sont faciles ;
– il existe une reconnaissance possible des formes débu-
tantes (taux de ferritine, CS-Tf) ;
– le coût du cas diagnostiqué est raisonnable ;
– le dépistage est applicable dans le système de santé en
vigueur ;
– un test efficace est disponible ;
– ce test est acceptable par la population ;
– le traitement simple, efficace et peu coûteux est accepté
par les personnes atteintes de la maladie (les saignées sont
bien tolérées dans 77 % des cas [9]) ;
– il existe un consensus sur les indications de traitement
(saignées).
De nombreuses conditions sont donc remplies pour for-
maliser un dépistage précoce, lequel permettrait d’éviter
les complications sévères parfois invalidantes ou mortelles
dont peuvent souffrir les patients chez lesquels le diagnostic
a été établi tardivement. Force est de constater que ce sont
surtout des considérations économiques qui freinent la mise
en place du dépistage dans la population générale. Si l’on
considère 20 millions de sujets caucasiens (les autres popu-
lations étant exceptionnellement atteintes) de 20 à 35 ans,
en estimant à 20 Dle prix de réalisation du coefficient de
saturation et de la ferritinémie, le coût du dépistage serait
de 400 millions d’euros.
L’Association hémochromatose France milite depuis plu-
sieurs années pour le dépistage systématique de la maladie.
Son action a probablement contribué à une meilleure
connaissance de l’hémochromatose par les patients, les
médecins et le grand public.
Le dépistage dans la population générale a progressé
comme en témoigne l’augmentation du nombre de pres-
criptions médicales pour le test de coefficient de saturation
de la transferrine (examen indispensable au diagnostic ini-
tial). Comme indiqué plus haut, la prescription de ce test a
augmenté de 6 000 % entre 2005 et 2007 [5]. Concernant
le dépistage de l’hémochromatose génétique à la naissance,
une étude pilote réalisée pendant trois ans dans des mater-
nités de Picardie [10] conclut qu’il n’est pas recommandé
car il pose de nombreux problèmes d’ordre éthique qui
s’amplifient pour le nouveau-né. En effet, dans le cas de
l’hémochromatose HFE, il existe un risque de stigmati-
sation du génotype C282Y homozygote avant l’âge de
l’apparition des premières anomalies biochimiques.
Traitements
Les saignées
Les saignées constituent le traitement de référence [2]. Elles
ont démontré leur efficacité sur la survie des patients et la
régression de certaines des complications associées à la sur-
charge martiale [11] et ceci d’autant plus que le traitement a
été commencé précocement, c’est-à-dire avant l’apparition
des complications. En effet, elles sont peu efficaces à 50-60
ans sur les complications cardiaques, articulaires, les états
dépressifs ou le diabète (tableau 4).
Lieu des saignées
Les saignées peuvent être réalisées en centre hospitalier,
dans un établissement franc¸ais du sang (EFS), en cabinet
médical ou par une infirmière libérale. La prise en charge
Tableau 4. Efficacité du traitement déplétif sur la symptomatologie perc¸ue de l’hémochromatose HFE (d’après Mc Donnell et al., 1999
[12]).
Symptômes Amélioration* Aggravation* Stabilisation*
Mélanodermie 59 4 37
Asthénie 54 17 29
Dépression 41 10 49
Douleurs abdominales 22 12 66
Baisse de la libido 13 28 59
Arthralgie 9 34 57
Troubles du rythme 6 10 84
(*) : données exprimées en pourcentage rapportées au nombre de sujets exprimant ce symptôme.
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%