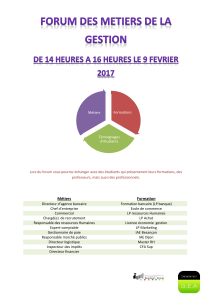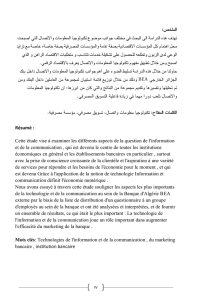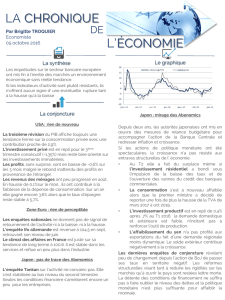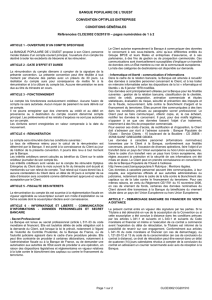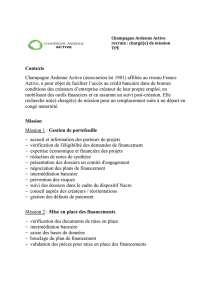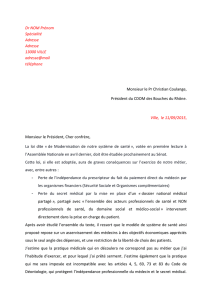Vous ne voulez pas télécharger Flash mais simplement lire cette

la pratique du droit bancaire français et européen
BANQUE
DROIT
n° 155
mai-juin 2014
ISSN 1777-5752
Bimestriel 70 euros
revue-banque.fr
ARTICLES
3 Recours collectifs
Les actions de groupe à la française :
un rendez-vous manqué ?
Emmanuel JOUFFIN, docteur en Droit
16 Emprunts toxiques
L’issue de la crise passe par une liberté contractuelle
« encadrée » des collectivités locales
Analyse du cadre légal et réglementaire (partie 2)
François MORARD, Crédit Agricole SA
25 Cass. crim., 22 janvier 2014, n° 12-83.579
Abus de marché et règle non bis in idem
Boubou KEITA, Université Paris 13
CHRONIQUES
30 DROIT BANCAIRE Thierry BONNEAU et Geneviève HELLERINGER
36 DROIT FINANCIER ET BOURSIER Jean-Jacques DAIGRE, Jean-Pierre BORNET et Anne-Claire ROUAUD
52 GESTION COLLECTIVE Fabrice BUSSIÈRE
54 BANCASSURANCE Pierre-Grégoire MARLY, Sylvestre GOSSOU et Michel LEROY
58 DROIT DES SÛRETÉS Nicolas RONTCHEVSKY, François JACOB et Emmanuel NETTER
62 DROIT PÉNAL BANCAIRE Jérôme LASSERRE CAPDEVILLE
68 DROIT DES SOCIÉTÉS Isabelle RIASSETTO, Michel STORCK et Quentin URBAN
73 DROIT FISCAL Carine SABOT
80 NOMINATIONS
81 BIBLIOGRAPHIE Alain CERLES


3
Banque & Droit nº 155 mai-juin 2014
Recours collectifs
Les actions de groupe
à la française :
un rendez-vous manqué ?
« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle s’emplit »
Beaumarchais, Le Mariage de Figaro, acte I, scène 1.
L’action de groupe à la française comporte un
certain nombre de particularismes justifiant
son « appellation d’origine ». Outre le monopole
d’initiative des associations agréées de
consommateurs, on remarquera une procédure
à nulle autre identique placée entre les mains
du juge, encore qu’en matière d’atteintes
à la concurrence, ce dernier soit soumis à
« l’autorité de chose décidée » par les autorités
de concurrence. À ceci s’ajoutent, notamment,
un régime d’opt-in dissimulant la réalité
d’un opt-out, sans oublier le choix critiquable
d’une gestion uniquement judiciaire de ce type
de litige, la médiation professionnelle ayant
été oubliée. Si l’effort imaginatif est à saluer,
se pose la question de la cohérence de cette
hybridation.
A
près quarante années de débats
1
, la France s’est
dotée, au travers de la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation (dite loi Hamon),
d’une action de groupe, tandis qu’au niveau européen,
le 11 juin 2013, la Commission européenne a adopté une
proposition de directive et une recommandation 2 invi-
tant les États membres à se doter d’un système national
de recours collectif.
Sans prétendre à une analyse exhaustive du chapitre pre-
mier de la loi Hamon, nous nous bornerons à un bref exa-
men des lignes de force de ces futures actions. Tout d’abord,
1. E. Jouffin, « Droits des consommateurs : les actions de groupe… avant les actions de
groupe », Banque et Droit n° 154.
2. Cf. le communiqué de presse : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-524_fr.htm.
nous décrirons sommairement le cadre procédural (I.), puis
nous nous attarderons sur la notion d’action de groupe « à
la française » (II.), avant d’aborder (III.) la procédure d’action
de groupe simplifiée visée par l’article L. 423-10 du Code
de la consommation (1.) et, enfin, les actions de groupe
relatives à la concurrence (2.).
I. PRÉSENTATION SOMMAIRE DU CADRE
PROCÉDURAL
1. Très schématiquement, l’action de groupe telle que
voulue par la loi Hamon se décompose en une procédure
« générale » et deux procédures particulières, l’une dite « sim-
plifiée » et l’autre consacrée aux actions conduites en matière
de concurrence.
2. Tout d’abord, l’introduction des actions de groupe
relève de la seule compétence des associations agréées de
consommateurs représentatives au niveau national (article
L. 423-1 du Code de la consommation)
3
. À cet égard, on relè-
vera que cette disposition ne saurait faire obstacle à l’appli-
cation de l’article 15, paragraphe 1, c) 4, du règlement (CE)
n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000
5
dit Règlement
Bruxelles I, lequel permet de soumettre aux tribunaux de
l’État membre dans lequel est domicilié le consommateur
tout litige de consommation, dès lors que le commerçant
cocontractant a « dirigé » son activité vers ledit État. La doc-
trine a vu dans ce monopole 6 attribué aux associations de
consommateurs agréées françaises une discrimination à
3. Actuellement au nombre de 16, ces associations sont soumises aux dispositions des
articles L. 411 et R. 411-1 et suivants du Code de la consommation. L’article R. 411-
1-a) indique que le nombre de cotisants nécessaire à l’agrément doit être de 10 000.
4. « Lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités
commerciales ou professionnelles dans l’État membre sur le territoire duquel le consommateur a
son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs
États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités. » Sur ce sujet,
cf. E. Jouffin, « Bref panorama des recours collectifs – Les actions de groupe… avant
les actions de groupe », Banque & Droit n° 154, mars-avril 2014, spéc. p. 7., § 18.
5. Règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des
décisions en matière civile et commerciale (JOUE 12 du 16 janv. 2001, p. 1).
6. Au sens de « […] privilège d’exclusivité reconnu par la loi à une entreprise pour l’exercice de
son activité » : L. Rapp et Ph. Terneyre, Droit public des affaires, Lamy, n° 2274.
EMMANUEL
JOUFFIN
Docteur
en Droit

SÉMINAIRES
Rencontre
Banque & Droit
LE STOCKAGE ET L’ARCHIVAGE
ÉLECTRONIQUES DANS
LA BANQUE : QUELS ENJEUX ?
Lieu
Amphithéâtre Thomson
Reuters Transactive
6/8 Bd Haussmann 75009
Tarifs
360 euros TTC
Tarif réservé aux
membres de l’ANJB :
270 euros TTC
Contact
Magali Marchal
Tél.: 01 48 00 54 04
marchal@revue-banque.fr
Mardi
30 septembre
2014
9h00 - 12h00
DIF
I
n
s
c
r
i
p
t
i
o
n
s
u
r
r
e
v
u
e
-
b
a
n
q
u
e
.
f
r
8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner
9h00 Introduction et animation de la séance
Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et de la communication,
société d’avocats Caprioli & Associés
Panorama des problématiques informatiques et libertés
- La délibération n° 2013-270 du 19 septembre 2013 portant recommandation relative aux
services dits de « co re-fort numérique ou électronique » destinés aux particuliers
- Les risques d’intrusion et de piratage
- Aspects de sécurité
Mathieu GRALL, chef du service de l’expertise technologique, CNIL
Aspects juridiques liés à l’archivage dans la banque et l’assurance
- Distinctions : stockage, sauvegarde et archivage ; archivage et conservation
- Archivage interne v. Archivage externe ; Le statut du tiers archiveur
- Régime juridique : droits et obligations en matière de Co re-fort numérique
Eric CAPRIOLI, avocat à la Cour, docteur en droit, spécialiste en droit des nouvelles
technologies, de l’informatique et de la communication,
société d’avocats Caprioli & Associés
Point de vue du prestataire : le coffre-fort numérique :
de la sécurité à la conformité
Arnaud BELLEIL, directeur associé, Cecurity.com
Les systèmes d’archivage dans la banque
- Quels sont les enjeux juridiques, durée de conservation, etc. ?
René PINON, directeur juridique adjoint groupe, Crédit Agricole Consumer Finance
- Quels sont les enjeux de sécurité ?
- Quelles problématiques métier et quelle mise en œuvre pratique ?
Cédric CLEMENT,
Head of trust services
, Informatique CDC
12h00 Clôture de la séance
SSOCIATION
ATIONALE DES
URISTES DE
ANQUE
A
N
J
B
En partenariat avec

36 Banque & Droit n° 155 mai-juin 2014
Chronique
droit financier et boursier
■n jurisprudence
Intermédiaire en biens divers – Notion
– Obligations – AMF – Sanction.
Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 7 avril 2014, Société MAI.
En organisant l’acquisition, la vente, la diversification,
la conservation et la valorisation d’un stock d’œuvres
d’art propriété du client, en promettant des plus-values
financières à l’issue de chaque trimestre d’au moins 4 % et
en assurant la conservation des œuvres, la société a réalisé
des opérations sur biens divers.
Le fait de proposer des biens divers s’entend de tout mode
de commercialisation s’appuyant sur une publicité ou
l’utilisant dans sa relation avec l’investisseur, que cette
publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des
intermédiaires concernés.
Se sont comportées en intermédiaires en biens divers les
personnes qui ont proposé ces opérations à titre habituel ou
qui ont recueilli des fonds à cet effet ou qui ont été chargées
de la gestion de ces biens.
L’AMF se préoccupe de plus en plus de la commercia-
lisation des produits dits atypiques qui, n’étant pas des
instruments financiers, peuvent être librement distribués
par toute personne, sauf s’il s’agit d’opérations sur « biens
divers ». En effet, depuis une loi du 3 janvier 1983
1
, modi-
fiée très récemment par la loi Hamon 2, l’activité d’inter-
médiaire en biens divers est encadrée et définie comme (i)
le fait, directement ou indirectement, par voie de publicité
ou de démarchage, de proposer à titre habituel à des tiers
de souscrire à des rentes viagères ou d’acquérir des droits
sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acqué-
reurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque
le contrat offre une faculté de reprise ou d’échange et la
revalorisation du capital investi ou (ii), le fait de recueil-
lir des fonds à cette fin ou (iii), le fait de se charger de la
gestion de ces biens (art. L. 550-1-I du Code monétaire
et financier). Le champ de la réglementation est donc
1. Loi n° 83-1 du 3 janvier 1983, modifiée par les lois n° 85-1321 du 14 décembre 1985
et n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; aujourd’hui art. L. 550-1 et s. et R. 550-1 et s. du
Code monétaire et financier.
2. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Voir le commentaire
dans cette chronique.
déterminé par la nature de l’activité, une intermédiation,
plus que par celle de son objet, puisqu’il s’agit de tous
les droits sur des biens mobiliers ou immobiliers autres
que ceux qui font l’objet d’une réglementation spéciale.
D’où l’importance toute particulière des trois notions
qui délimitent les intermédiations réglementées : la pro-
position de biens divers, le recueil de fonds à cette fin et
la gestion de ces biens. Ceux qui s’y adonnent doivent
remplir un certain nombre d’obligations : établir et faire
viser par l’AMF un document d’information destiné au
public, procéder à un reporting annuel auprès de l’AMF,
se constituer sous forme de société par actions et faire
désigner le commissaire au compte en justice après avis
de l’AMF. Cette affaire est l’occasion pour la Commis-
sion des sanctions de l’AMF de préciser plus nettement
sa doctrine sur ces divers points, à la suite des décisions
Akzenta AG et Solabios 3.
La première notion, celle de proposition est, à défaut
de définition dans la loi, entendue très largement par la
commission des sanctions, ce qui n’est pas nouveau,
comme celle de commercialisation des produits finan-
ciers : il s’agit de « tout mode de commercialisation s’appuyant
sur une publicité, ou l’utilisant dans la relation avec l’investisseur,
que cette publicité ait été ou non conçue ou diffusée par chacun des
intermédiaires en biens divers concernés ». Il en résulte, d’une
part, qu’une simple proposition suffit, même si elle n’est
pas suivie d’effet et, d’autre part, qu’il est indifférent que
la publicité ait été conçue par l’intermédiaire ou par autrui
dès lors qu’à l’occasion « de ses contacts avec les investisseurs
[il] s’appuyait sur ou utilisait une publicité faite en amont, par
voie de presse ou par tout autre moyen, notamment Internet ». Il
reste qu’il faut que la publicité soit suffisamment précise
pour constituer une proposition, ce qui, selon la décision,
suppose qu’elle expose, d’une part, les caractéristiques
du produit, et, d’autre part, suggère sa souscription. On
est très près de l’offre au public d’instruments financiers :
« Une communication adressée sous quelque forme que ce soit et
par quelque moyen que ce soit à des personnes et présentant une
3. Décision de la Commission des sanctions de l’AMF du 3 novembre 2005, affaire
Akzenta AG : Droit des sociétés 2006, commentaire n° 93, note Th. Bonneau. Décision
de la Commission des sanctions de l’AMF du 23 juillet 2013, affaire Solabios : BJB
février 2014, p. 90, note H. Bouthinon-Dumas ; RDBF septembre-octobre 2013,
p. 56, n° 177, note P. Pailler ; Banque et Droit, novembre-décembre 2013, n° 152,
p. 22, obs. J.-J. Daigre. Pour la jurisprudence, voir CA Paris, 1re H., 25 avril 2000,
n° 199/22757, SA Elevage et Patrimoine : BJB septembre-octobre 200, p. 449, n° 93,
note Th. Granier ; Cass. crim. 4 septembre 2002, n° 01-84503 : Banque et Droit
mars-avril 2003, p. 35, obs. H. de Vauplane et J.-J. Daigre.
JEAN-JACQUES
DAIGRE
Professeur
de droit
Université
Paris I
JEAN-PIERRE
BORNET
Professeur
associé
Université
Paris Sud
Responsable
Compliance
BPCE
ANNE-CLAIRE
ROUAUD
Maître
de conférences
Université
Paris I
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%