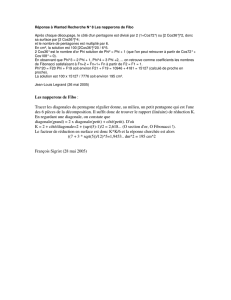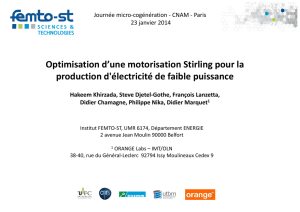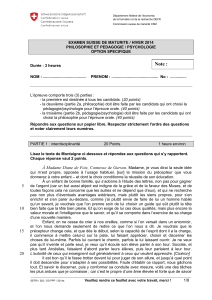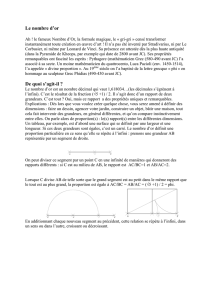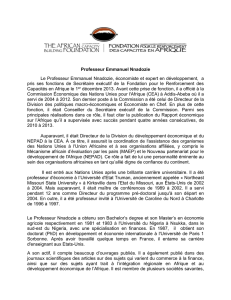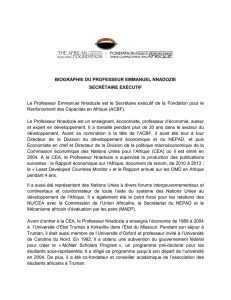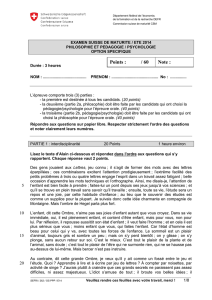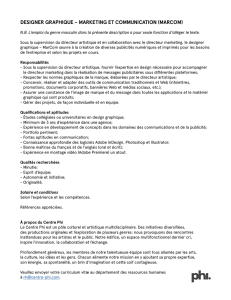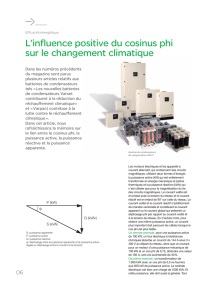examen suisse de maturite / printemps 2006

SER / 632-006 / OS PPP / H12 Veuillez rendre ce feuillet avec votre travail, merci !
1/9
Département fédéral de l'intérieur DFI
Commission suisse de maturité CSM
EXAMEN SUISSE DE MATURITE / HIVER 2012
PHILOSOPHIE ET PEDAGOGIE / PSYCHOLOGIE
OPTION SPECIFIQUE
Durée : 3 heures
NOM : ........................................ PRENOM : ........................................... No : ...............
L’épreuve comporte trois (3) parties :
- la première est destinée à tous les candidats. (20 points)
- la deuxième (partie 2a, philosophie) doit être faite par les candidats qui ont choisi la
pédagogie/psychologie pour l’épreuve orale. (40 points)
- la troisième (partie 2b, pédagogie/psychologie) doit être faite par les candidats qui ont
choisi la philosophie pour l’épreuve orale. (40 points)
Répondre aux questions sur papier libre. Respecter strictement l'ordre des questions
et noter clairement leurs numéros.
PARTIE 1 : interdisciplinarité 20 Points 1 H environ
Lisez le texte suivant de Voltaire et répondez aux questions qui s’y rapportent. Chaque
réponse vaut 2 points.
Le droit naturel est celui que la nature indique à tous les hommes. Vous avez élevé votre
enfant, il vous doit du respect comme à son père, de la reconnaissance comme à son
bienfaiteur. Vous avez droit aux productions de la terre que vous avez cultivée par vos
mains. Vous avez donné et reçu une promesse, elle doit être tenue.
Le droit humain ne peut être fondé en aucun cas que sur ce droit de nature ; et le grand 5 principe, le principe universel de l'un et de l'autre, est, dans toute la terre : « Ne fais pas ce
que tu ne voudrais pas qu'on te fît. » Or on ne voit pas comment, suivant ce principe, un
homme pourrait dire à un autre : « Crois ce que je crois, et ce que tu ne peux croire, ou tu
périras. » C'est ce qu'on dit en Portugal, en Espagne, à Goa. On se contente à présent,
dans quelques autres pays, de dire : « Crois, ou je t'abhorre ; crois, ou je te ferai tout le mal 10 que je pourrai ; monstre, tu n'as pas ma religion, tu n'as donc point de religion : il faut que tu
sois en horreur à tes voisins, à ta ville, à ta province. »
S'il était de droit humain de se conduire ainsi, il faudrait donc que le Japonais détestât le
Chinois, qui aurait en exécration le Siamois ; celui-ci poursuivrait les Gangarides, qui
tomberaient sur les habitants de l'Indus ; un Mogol arracherait le cœur au premier Malabare 15 qu'il trouverait ; le Malabare pourrait égorger le Persan, qui pourrait massacrer le Turc : et
tous ensemble se jetteraient sur les chrétiens, qui se sont si longtemps dévorés les uns les
autres.
Le droit de l'intolérance est donc absurde et barbare : c'est le droit des tigres, et il est bien
horrible, car les tigres ne déchirent que pour manger, et nous nous sommes exterminés 20 pour des paragraphes.
Voltaire, Traité sur la tolérance, chapitre VI,
http://www.voltaire-integral.com/Html/25/01_Tolerance.html. Consulté le 5 janvier 2012.
Note :

2/9
1. 1 - Dites en quelques lignes quelle est la thèse défendue par Voltaire dans ce texte.
1. 2 - Dans le texte, quel est le sens des mots
a- principe (ligne 6, 1er mot)
b- universel (ligne 6)
c- religion (ligne 11)
d- absurde (ligne 19)
1. 3 - Le propos du texte relève-t-il - de la philosophie ?
- de la psychologie ?
Justifiez votre réponse.
1. 4 - Quelles sont les valeurs humaines que Voltaire met du côté du droit naturel
(lignes 1-4)?
1. 5 - En quoi la phrase "Crois..." (ligne 8) contredit-elle le principe universel énoncé plus
haut ?
1. 6 - Pourquoi n'y a-t-il pas besoin de savoir qui sont les Gangarides ou les Malabares
pour comprendre le troisième paragraphe du texte?
1. 7 - Expliquez la différence que fait Voltaire, dans le dernier paragraphe, entre
"intolérance" des tigres et intolérance des hommes.
1. 8 - En quoi pourrait consister, selon vous, une pédagogie de la tolérance?
1. 9 - Certains pensent que toute affirmation de croyance contient un germe d'intolérance.
Qu'en pensez-vous?
1. 10 - Y a-t-il selon vous des limites à la tolérance? Justifiez votre réponse.

3/9
PARTIE 2a : philosophie 40 Points 2 H environ
Partie réservée aux candidats présentant la pédagogie/psychologie à l’oral
Lisez attentivement le texte suivant :
Une philosophie de la perception, qui veut réapprendre à voir le monde, restituera à la
peinture et en général aux arts leur vraie place, leur vraie dignité et nous disposera à les
accepter dans leur pureté.
Qu'avons-nous appris, en effet, à considérer le monde de la perception? Nous avons appris
que dans ce monde, il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître. 5 Certes, quand je définis une table comme le fait le dictionnaire – plateau horizontal soutenu
par trois ou quatre supports et sur lequel on peut manger, écrire, etc. –, je peux avoir le
sentiment d'atteindre comme l'essence de la table et je me désintéresse de tous les
accidents dont elle peut s'accompagner, forme des pieds, style des moulures, etc., mais ce
n'est pas là percevoir, c'est définir. Quand au contraire je perçois une table, je ne me 10 désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table et c'est la façon
chaque fois singulière dont elle porte son plateau, c'est le mouvement, unique, depuis les
pieds jusqu'au plateau, qu'elle oppose à la pesanteur qui m'intéresse et qui fait chaque table
distincte de toutes les autres. Il n'y a pas de détail ici – fibre du bois, forme des pieds,
couleur même et âge de ce bois, graffiti ou écorchures qui marquent cet âge – qui soit 15 insignifiant et la signification "table" ne m'intéresse qu'autant qu'elle émerge de tous les
"détails" qui en incarnent la modalité présente. Or, si je me mets à l'école de la perception, je
me trouve prêt à comprendre l'œuvre d'art, car elle est, elle aussi, une totalité charnelle où la
signification n'est pas libre, pour, ainsi dire, mais liée, captive de tous les signes, de tous les
détails qui me la manifestent, de sorte que, comme la chose perçue, l'œuvre d'art se voit ou 20 s'entend et qu'aucune définition, aucune analyse, si précieuse qu'elle puisse être après coup
et pour faire l'inventaire de cette expérience, ne saurait remplacer l'expérience perceptive et
directe que j'en fais.
Cela n'est pas si évident d'abord. Car enfin, la plupart du temps, un tableau représente,
comme on dit, des objets, souvent un portrait représente quelqu'un dont le peintre nous 25 donne le nom. Après tout, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches indicatrices
dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie ou vers le quai?
Ou encore à ces photographies exactes qui nous permettent d'examiner l'objet en son
absence et en retiennent tout l'essentiel? Si c'était vrai, le but de la peinture serait le trompe-
l'œil, et sa signification serait toute hors du tableau, dans les choses qu'il signifie, dans le 30 sujet. Or c'est précisément contre cette conception que toute peinture valable s'est
constituée et que les peintres luttent très consciemment depuis cent ans au moins.
Maurice MERLEAU-PONTY (Maurice), Causeries, chapitre VI, vventresque.free.fr/
IMG/pdf/Merleau-Ponty_Causeries.pdf. Consulté le 5 janvier 2012
Répondez dans l’ordre aux questions ci-dessous.
A. Connaissances préalables et carte d’identité du texte (6 points)
Phi 1 - En utilisant vos propres mots, définissez la "philosophie de la perception " proposée
par Merleau-Ponty dans ce texte.
Phi 2 - Avec sa "philosophie de la perception", on peut dire que Merleau-Ponty tourne le dos
aux pensées de : a) Platon, et b) Kant. Expliquez pourquoi.

4/9
B. Explication de détail/compréhension (12 points)
Phi 3 - En considérant la suite du texte, dites en quoi consiste la "pureté" des arts dont il est
question à la ligne 3.
Phi 4 - Montrez sur quoi repose l'opposition que Merleau-Ponty établit entre "perception" et
"définition".
Phi 5 - Pourquoi Merleau-Ponty précise-t-il que, quand il perçoit une table, il ne se
"désintéresse pas de la manière dont elle accomplit sa fonction de table" (ligne 11)?
Phi 6 - Que veut dire l'auteur lorsqu'il dit d'une table ou d'une oeuvre d'art qu'elle est une
"totalité charnelle" (ligne 18)?
Phi 7 - Expliquez la phrase: "Après tout, la peinture n'est-elle pas comparable à ces flèches
indicatrices dans les gares qui n'ont d'autre fonction que de nous diriger vers la sortie
ou vers le quai?" (lignes 26-27).
Phi 8 - Comme l'indique Merleau-Ponty en disant : "Cela n'est pas si évident d'abord. Car
enfin..." (ligne 24), le contenu du dernier paragraphe semble en contradiction avec ce
qui précède. Quelle est cette contradiction apparente?
C. Maîtrise des notions philosophiques (10 points)
Dites à quel terme du vocabulaire philosophique, présent dans le texte sous la forme
d’un nom ou d'un verbe, correspond chacune des 10 définitions suivantes. Voici un
exemple :
Définition : « Fait d’être unique, seul de son espèce ».
Réponse : « Singularité ».
Phi 9 - Activité d'un individu capable grâce à son système nerveux d'interpréter les
sensations reçues du monde extérieur. Résultat de cette activité.
Phi 10 - Au sens intellectuel : décomposition d'un ensemble en ses éléments constituants.
Phi 11 - Ce qui peut être ou ne pas être dans une chose sans modifier sa nature profonde.
Phi 12 - Ce à quoi renvoie un signe ou un ensemble de signes.
Phi 13 - Activité rationnelle critique s'efforçant de découvrir le sens des choses. Elle
s'articule traditionnellement autour de deux valeurs, l'une théorique, de vérité, et
l'autre pratique, de bien.
Phi 14 - [Il s'agit d'un verbe, présent dans le texte sous forme conjuguée.] Rendre présent
ou sensible, par le moyen de signes (mots, images), quelque chose d'invisible ou
d'absent.
Phi 15 - Forme particulière que prend une chose, une action, une pensée (par exemple à
un moment donné).

5/9
Phi 16 - Nature propre et nécessaire d'une chose; ce qui fait qu'elle est ce qu'elle est.
Phi 17 - Fait d'éprouver quelque chose, considéré comme susceptible d'enrichir la
connaissance.
Phi 18 - Acte de mettre en équivalence un terme avec l'expression de son essence. Cette
expression même. Proposition affirmative permettant de faire comprendre un mot.
D. Questions générales (12 points)
Phi 19 - "Il est impossible de séparer les choses et leur manière d'apparaître" (ligne 5).
- Quel est votre propre point de vue sur cette thèse?
- Si cette thèse était vraie, la science serait-elle possible? Justifiez votre réponse.
Phi 20 - A votre avis, le trompe-l'oeil (l'imitation parfaite) peut-il représenter aujourd'hui un
idéal artistique valable? Donnez une réponse développée à cette question.
Phi 21 - Critiquant la métaphysique occidentale, Nietzsche propose une philosophie de la
vie. Pour vivre, "il importe de rester bravement à la surface, de s’en tenir à
l’épiderme, d’adorer l’apparence, de croire à la forme, aux sons, aux paroles, à tout
l’Olympe de l’apparence !". Pouvez-vous faire vôtre cette manière de concevoir le
rapport entre l'homme et le monde? Justifiez votre réponse.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%