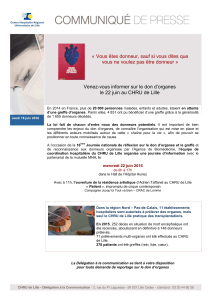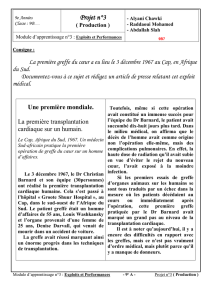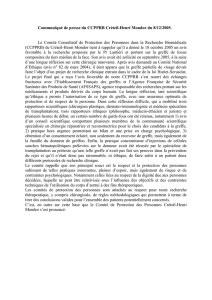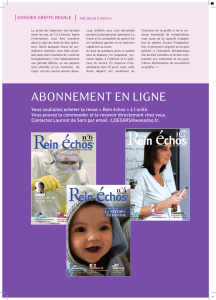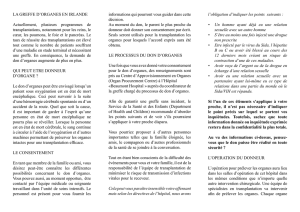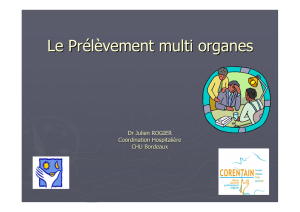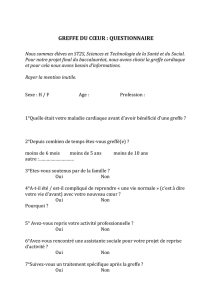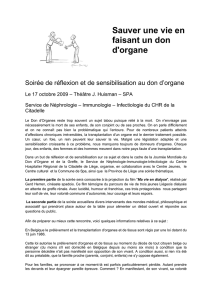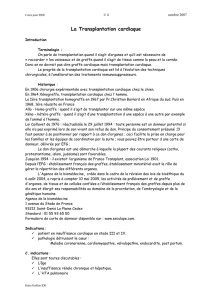Du don à la greffe ou la chaîne de la vie

DossIer
Du don à la greffe
ou la chaîne de la vie
Don, prélèvement et greffe d’organes
Véritables enjeux de santé publique, le don, le prélèvement et la greffe sont inscrits dans la loi de bioéthique révisée en
1994. L’indication de greffe est posée lorsqu’il n’y a pas d’alternative thérapeutique curatrice et que le receveur est inscrit
sur une liste d’attente nationale gérée par l’Agence de Biomédecine.
Axe essentiel défini dans son projet d’établissement, le CHRU de Montpellier a développé une expertise reconnue dans ce
domaine. En 2006, 181 transplantations y ont été effectuées et le CHRU reste l’établissement incontournable de la région
en matière de greffes.
Outre la technicité et le professionnalisme de tous les acteurs médicaux qui participent à cette chaîne de vie, soulignons
leur courage, leur volonté et leur engagement dans ce combat pour la vie.
Ce mois-ci, Objectif Lettre les rencontre.
Le maillon central du prélève-
ment s’appelle “CHP”
La Coordination Hospitalière de Prélève-
ments, créée en 1988, est au cœur de l’orga-
nisation du prélèvement.
Elle travaille en interface avec l’Agence Ré-
gionale d’Hospitalisation et l’Agence de Bio-
médecine et génère au CHRU une dynamique
certaine, en impliquant tous les acteurs du
prélèvement.
Composée d’un médecin coordonnateur (le
Dr Florence VACHIERY), d’un cadre de santé
et de quatre infirmières, la CHP a trois mis-
sions essentielles :
◗
Accueillir les proches et organiser le
prélèvement d’organes et de tissus
La CHP accompagne les proches lors de l’an-
nonce de la mort cérébrale du futur donneur
en partenariat avec le service de réanimation.
Elle est en première ligne pour prendre en
charge des familles souvent atterrées et
dans un désarroi extrême. L’erreur dans le
discours n’est pas permise car au bout de
cette annonce, il y a la survie d’une autre
personne. Après recueil de la non-opposition
du défunt au don auprès des proches, elle
organise le prélèvement multi-organes et de
tissus et s’assure de la qualité des greffons
en réalisant les bilans obligatoires dans le ca-
dre de la sécurité sanitaire.
Un prélèvement représente, en moyenne,
24h00 de travail non-stop pour la CHP.
◗
Former les acteurs médicaux et soignants
au cours de sessions organisées par la CHP.
◗
Informer et sensibiliser le grand public
En plus de promouvoir le don d’organes au
sein même de l’institution, la Coordination
informe l’ensemble de la population par
différentes actions (participation aux journées
de sensibilisation, démarches auprès des collè-
ges et des lycées, etc…).
Dans un futur proche, la CHP a pour pro-
jet de mettre en place une activité de for-
mation action au sein des secteurs de réani-
mation et de blocs (bourse obtenue dans le
cadre de “Grand Sud transplant”).
La Région Languedoc-Roussillon mobili-
sée autour du prélèvement
La professionnalisation de l’activité de pré-
lèvement a permis la création d’une struc-
ture régionale inter-hospitalière fondée sur
la complémentarité des partenaires : le Ré-
seau RE-PRE-LAR. C’est aussi la CHP qui en
assure l’encadrement médical et paramédical
(cf page 6 du dossier).
Au début de la chaîne,
la réanimation
“L’équipe d’Anesthésie Réanimation est le
premier maillon de la chaîne “don, prélève-
ment et greffe d’organes”. C’est une charge
lourde, qui nécessite courage et détermina-
tion”
, déclare le docteur Patrick CHARDON
(SAR A).
Les services de réanimation du CHRU sont
souvent confrontés à des patients qui vont
évoluer vers la mort encéphalique (coma
dépassé). Le SAR A du CHRU, qui reçoit plus
spécifiquement des polytraumatisés, est le
premier concerné.
DossIer
p3
Objectif
Lettre
DOSSIER
Rédaction : B. Boutin-Mostefa et M. Dechavanne.
Avec la collaboration de : Pr B. Albat, Dr P. Chardon, Pr J.F. Eliaou, Dr S. Jaber,
Pr G. Mourad, Pr F. Navarro, Pr G.P. Pageaux, Pr. J.F. Rossi, Dr F. Vachiery.
La Coordination Hospitalière de Prélèvement
Sans don ni prélèvement, pas de greffe !

DossIer
p4
Objectif
Lettre
DOSSIER
10 heures pour un nouveau
coeur
Seules les insuffisances cardiaques termi-
nales, inaccessibles aux traitements médi-
camenteux ou chirurgicaux conventionnels
peuvent bénéficier de cette technique.
Le CHRU de Montpellier assure une moyen-
ne annuelle de 12 interventions par an,
dans les cas suivants :
◗
Cardiomyopathies (il s’agit d’une atteinte
primitive du muscle cardiaque),
◗
Cardiopathies ischémiques (atteinte des
vaisseaux coronaires),
◗
Cardiopathies valvulaires.
Le délai moyen d’attente est de 5 mois, pé-
riode durant laquelle le patient “receveur”
est régulièrement suivi par l’équipe. Un bi-
lan complet est effectué pour déceler toute
contre-indication à la greffe.
Fait extraordinaire, un cœur peut suppor-
ter l’absence de vascularisation pendant 5
heures. L’équipe de greffe prépare déjà le
receveur lorsque le prélèvement débute.
L’acte de greffe en lui même dure 5 heures
en moyenne.
Un service prêt à transplanter 24h sur
24h
Au CHRU, c’est le service de Chirurgie tho-
racique et cardio-vasculaire du Pr Bernard
ALBAT qui est au centre de cette activité
avec deux chirurgiens cardiaques.
Après intervention, le patient est en iso-
lement (en réanimation puis dans le service)
une vingtaine de jours, car les conditions
d’hygiène doivent être draconiennes.
Par la suite, les patients sont régulière-
ment suivis (d’un point de vue clinique et
psychologique) dans le service.
Les transplantations cardiaques assurent
80 % de survie à 1 an et 70% à 5 ans.
La transplantation rénale
Dans ce domaine, le CHRU a développé
une expertise certaine et bénéficie d’une
reconnaissance nationale. Le Service de
Néphrologie, Transplantation et Dialyse
péritonéale du Pr Georges MOURAD est le
seul à pratiquer la transplantation dans la
région.
La majorité des greffes s’effectue grâce
à des prélèvements sur des donneurs dé-
cédés. Cependant,
le service procède
aussi à plus de 10 %
de greffes avec
donneurs vivants
(famille et proches
du receveur).
La transplantation
de donneurs vi-
vants est complexe
et respecte un pro-
tocole strict basé
sur la motivation,
la psychologie et la
santé du donneur
vivant.
Une étroite colla-
boration a été mise
en place avec la
CHP, le laboratoire
d ’ I m m u n o l o g i e
(Pr J-F ELIAOU) et
avec le service
d’Urologie (Pr GUI-
TER, Dr F. IBORRA),
qui effectue la
chirurgie des pré-
lèvements et les
greffes.
3 missions :
◗
Le suivi immédiat de la transplantation
rénale, avec donneur décédé ou vivant,
◗
Le suivi immédiat de la greffe combinée
rein-pancréas pour les diabétiques,
◗
Le suivi au long cours des transplantations.
Le délai d’attente moyen pour obtenir un
rein est de 30 mois. 120 greffes rénales
par an sont réalisées au CHRU pour une
liste d’attente de 300 patients. Avec ce
chiffre, le service est une des 5 premières
équipes françaises dans ce domaine.
La survie des patients greffés est de 95 %
à 1 an ; elle est de 60 % à 10 ans.
A chaque organe, sa transplantation
Une des 5 premières équipes
françaises pour
la tranplantation rénale
Itinéraire d’une annonce douloureuse …
Après avoir constaté la mort encéphalique
(ou mort cérébrale) du patient, le méde-
cin-réanimateur annonce cet état à la fa-
mille du malade.
Aidé de la CHP, il évoque la question du
don d’organes. Rien n’est gagné d’avance
et ce sont des minutes ou heures doulou-
reuses qui vont s’égrainer avant que la fa-
mille donne son accord.
Après les différents contrôles obligatoires,
la prise en charge du patient se poursuit
dans le service, durant une vingtaine d’heu-
res, avant le départ au bloc opératoire.
Des formations à la mesure des diffi-
cultés humaines rencontrées
Consciente du rôle important que jouent
les équipes de réanimation, la CHP va met-
tre en place un plan de formation pour
aider les médecins et les soignants des
SAR dans leurs démarches auprès des fa-
milles de patients.

DossIer
p5
Objectif
Lettre
DOSSIER
Il était un foie...
Au CHRU, la greffe hépatique est assurée
par un trinôme : Le Service d’Hépato-Gas-
tro-Entérologie (Pr G.-Philippe PAGEAUX),
l’Unité de Réanimation et de Transplanta-
tion du Service d’Anesthésie Réanimation
B (Dr Samir JABER) et le Service Médico-
Chirurgical des Maladies de l’Appareil Di-
gestif et Transplantation Hépatique (Pr
Francis NAVARRO).
◗
Un suivi ante et post greffe,
C’est en hépato-gastro-entérologie que le
patient se rendra pour un bilan pré-greffe
(examens cardiologiques, pulmonaires vas-
culaires mais aussi psychologiques) et va-
lider son inscription sur la liste d’attente
des demandeurs. A noter que ce n’est pas
son ancienneté d’inscription mais son état
qui définira l’attente. La moyenne d’attente
est de 6 mois pour obtenir un foie. Pendant
ce délai, le patient est fréquemment suivi par
le service.
Après la greffe, le patient viendra en consul-
tation très régulièrement pour effectuer un
suivi clinique et psychologique. Les médecins
s’attachent particulièrement à l’impact psy-
chologique d’une telle étape dans la vie.
◗
Pour le foie, l’urgence est au rendez-
vous
Comment parler de la greffe sans parler du
prélèvement ? Appelé souvent la nuit et en
urgence, le préleveur part en “croisade” pour
aller prélever ce foie qui n’attendra pas long-
temps.
La transplantation hépatique est un acte
chirurgical très lourd car le foie est un
organe complexe avec de nombreux vais-
seaux, veines et artères et cette technique
ne peut supporter une aide mécanique (il
n’existe pas de foie artificiel ou de machine
capable de se substituer à cet organe).
L’opération dure 12 heures et assure une
réussite immédiate de 90 %.
«Sur pied» 24h/24h, c’est le chirurgien
qui prend la décision de la transplanta-
tion hépatique. Prévenu directement par
la Coordination, il se base sur une dizaine
de critères (biologiques, morphologiques,
etc…) pour rapide-
ment donner son
accord sur le gref-
fon proposé.
◗
Attention ! com-
plications possi-
bles
Après intervention,
un patient greffé
reste environ une
dizaine de jours
dans l’Unité de
Réanimation et de
Transplantation.
L’a c te chir ur gic al
étant très lourd, il
y a donc une sur-
veillance continue et
longue afin d’éviter
les complications
précoces (infections,
rejet, etc…) qui peu-
vent très vite s’avé-
rer fatales.
Au CHRU, seuls un
médecin préleveur
et de deux médecins
greffeurs sont en
charge de la trans-
plantation hépatique.
Le taux de survie est de 70 % après 5 ans
et
50 à 60 interventions sont faites
chaque année.
Et pour les maladies du sang
L’activité de greffe hématologique du ser-
vice d’Hémato-Oncologie du Pr J.-François
ROSSI est rassemblée depuis peu, au sein
d’un Centre de greffe adulte-enfant
engagé dans une démarche d’accrédita-
tion européenne JACIE (Drs N. FEGUEUX, G.
MARGUERITTE et F. BERNARD). Son activité
est en lien étroit avec la recherche biolo-
gique (Institut de Recherche en Biothérapie
et Unité de Thérapie Cellulaire, Pr Bernard
KLEIN) ainsi que le laboratoire d’Immuno-
logie (Pr J.-François ELIAOU) pour la recher-
che des donneurs et leur typage, dans une
ambiance de recherche clinique s’appuyant
sur le CIC-Biothérapie. .
Le service effectue deux types de greffes :
◗
la greffe autologue est une ré-infu-
sion de cellules souches hématopoïétiques
provenant du patient lui-même (cancers
chimio-sensibles tels que les lymphomes, le
myélome ou autres maladies du sang et de
la moelle). 120 autogreffes par an sont
pratiquées.
Fait unique, depuis deux ans, 26 autogref-
fes de patients habitant dans l’agglomé-
ration de Montpellier, ont été réalisées au
CHRU avec suivi précoce à domicile, grâce
à une équipe d’infirmiers libéraux, conven-
tionnés avec l’établissement et connais-
sant parfaitement le type de prise en
charge, en lien étroit avec le service ;
◗
la greffe allogénique permet de rem-
placer les cellules malades d’un patient par
les cellules saines d’un donneur, en res-
taurant un contrôle immunitaire défaillant
(techniques réservées à certaines leucémies
ou autres cancers du sang ou de la moelle
en rechute).
Une nouvelle voie à la médecine régé-
nératrice
La possibilité d’utiliser plusieurs greffons
compatibles provenant de cordons ombi-
licaux (récupérés au décours de l’accouche-
ment) permet de traiter plus de patients.
44 allogreffes sont pratiquées par an
et probablement 70 dès l’an prochain.
Sur un plan régional, le CHRU est le seul
site de transplantation. Tous ces éléments
expliquent l’extraordinaire essor et dyna-
misme autour de cette activité et justifie la
place grandissante du CHRU de Montpel-
lier parmi les grands centres de Thérapie
Cellulaire et de Greffe.
Le CHRU est le 1
er
centre de
transplantation hépatique du Grand
Sud et le service est reconnu à l’échelle
internationale pour les
interventions sur cirrhoses alcooliques.

DossIer
L’immunogénétique au
service des transplantations
En plus de sa fonction de plate-forme pour
toutes les transplantations, l’immunogé-
nétique travaille aussi dans le domaine des
cellules souches.
L’Unité d’Immunogénétique du laboratoire
d’Immunologie (Pr J.F. ELIAOU) a un rôle clé
dans la chaîne don, prélèvement et greffe .
◗
Elle orchestre la compatibilité entre
les donneurs et receveurs pour toutes
les transplantations d’organes. Elle établit
le typage HLA (éléments du sang spécifi-
ques à chaque individu et qui intervient dans
les défenses naturelles) du donneur et le
communique à la Coordination.
Le laboratoire effectue le «cross-match»
en vérifiant que le receveur ne possède
pas d’anti-corps contre les déterminants
HLA du donneur (situation qui ne permet
pas la transplantation, le cas échéant, le
laboratoire émet une contre-indication de
transplantation);
◗
Pour la greffe de cellules souches
(cellules qui assurent la régénération) du
sang, celles-ci peuvent avoir trois origines,
la moelle osseuse, le sang, les cellules du
cordon ombilical. Une compatibilité HLA
stricte entre le donneur et le receveur est
ici indispensable avant toute greffe. Les
aspects biologiques, techniques et logis-
tiques de ces greffes sont assurés par le
laboratoire.
Comment faire un don ?
L’unité accueille les personnes souhaitant
faire un don volontaire anonyme et gratuit
de cellules souches sanguines.
Le laboratoire, qui est centre
référent de l’Agence de la Bio-
médecine effectue alors une
première analyse pour établir
le typage HLA du futur donneur
et les résultats sont retranscris
dans le Registre national des
donneurs.
Si la compatibilité entre un don-
neur et un receveur est établie
alors, on procède à une seconde
analyse plus poussée avant le prélèvement
mais aucun stock n’est fait à l’avance.
Le laboratoire assure une garde 24h/24 et
l’équipe effectuera près de 6000 typages
en 2007.
Une communication “grand public”
autour du don
Le laboratoire participe activement à la mis-
sion d’information sur le don et la greffe et
communique régulièrement sur le sujet. L’ob-
jectif pour 2008 est d’atteindre l’inscription
sur le Registre national de 1400 nouveaux
donneurs de cellules souches sanguines ré-
sidant dans la région Languedoc-Roussillon.
p6
Objectif
Lettre
DOSSIER
Laboratoire d’immunologie
Tous les acteurs médicaux de la Région
réunis en réseau
Fort de sa position de Centre Hospitalier Régional Universitaire, notre établissement a voulu développer le
partenariat entre hôpitaux et la complémentarité de chacun dans le domaine.
Le réseau RE.PRE.LAR. est né de cette volonté.
En Languedoc-Roussillon, RE.PRE.LAR est
un réseau structuré, dynamique, organisé
et motivé, basé sur la complémentarité de
tous les partenaires.
◗
Structuré : Ce réseau compte dix établis-
sements organisés par grades afin de coor-
donner le don d’organe, du prélèvement à
la transplantation. Les Centres Hospitaliers
de Narbonne, Sète, Alès, Bagnols-sur-Cèze
et Mende recensent les morts encépha-
liques et prennent en charge les familles.
Béziers, Perpignan, Carcassonne, Nîmes et
Montpellier assurent les prélèvements. Seul
le CHRU de Montpellier transplante.
◗
Dynamique : L’objectif général est de
concourir à la prise en charge des «don-
neurs potentiels» d’organes et de tissus,
sur la région Languedoc-Roussillon pour sa-
tisfaire les patients en attente de greffe.
RE.PRE.LAR s’est fixé pour objectif d’augmen-
ter la détection des donneurs potentiels.
◗
Organisé :
Le réseau est organisé autour
de deux cellules :
Les cellules opérationnelles, présentes
dans tous les établissements de la Région,
participent aux activités de Prélèvements
d’Organes et de Tissus. Elles développent
aussi une mission d’éducation en créant
des activités de formation, d’information
et de sensibilisation.
La cellule animation du réseau, menée
par l’encadrement médical et soignant de la
CHP, crée la dynamique régionale. Elle coor-
donne et anime le fonctionnement géné-
ral du réseau, apporte un appui technique
et logistique sur tous les établissements,
standardise et harmonise les pratiques au
sein du réseau, pilote les groupes de tra-
vail et développe la recherche.
Enfin, elle mène une action d’information,
de formation et de sensibilisation.
Le CHRU est par ailleurs engagé dans la
mise à disposition de son plateau techni-
que (laboratoire de virologie, typage HLA,...)
En conclusion
Ce tour d’horizon du prélèvement à la
greffe place le CHRU de Montpellier
dans le peloton de tête des centres
hospitaliers universitaires français.
Des équipes de haut niveau contribuent
chaque jour à donner un rayonnement
international à leurs pratiques.
Les techniques, la recherche, sans
oublier l’organisation autour de cette
chaîne de vie, sont en perpétuelle évolu-
tion et le travail des équipes hospitaliè-
res montpelliéraines en est la preuve.
N’oublions pas que nous sommes tous
concernés par cette chaîne de vie.
Anonyme, gratuit et volontaire, le don
représente une vraie chance de vie. En
informant nos familles sur notre posi-
tion face au don, nous rentrons dans la
chaîne.
1
/
4
100%