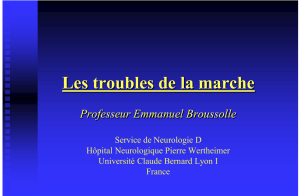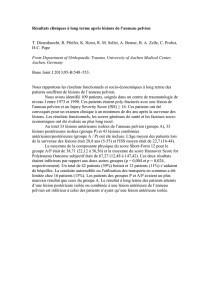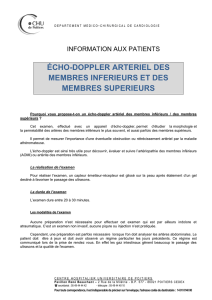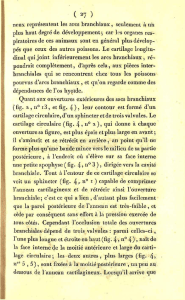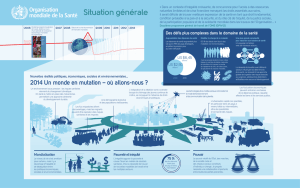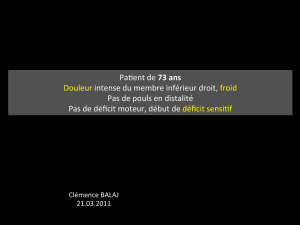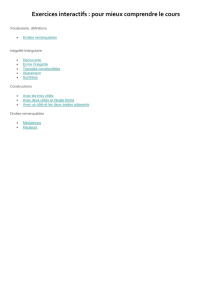Podologie et anneau pelvien - Institut Supérieur de Thérapeutique

© Sauramps Médical. La photocopie non autorisée est un délit.
L’anneau pelvien n’est pas suspendu.
De cette évidence découle l’importance de
l’examen des membres inférieurs dont la mor-
phologie statique et dynamique retentit sur
l’équilibre du bassin.
L’observation d’une bascule du bassin est
d’une telle fréquence que cela en devient une
banalité, d’autant qu’il est difficile d’en évaluer
son retentissement pathologique sur le seg-
ment lombo-pelvi-fémoral.
L’étude des conséquences biomécaniques
est la première étape de ce chapitre.
D’autre part, le lien mécanique entre rotation
du segment fémoral et anneau pelvien repose
sur les muscles pelvi-trochantériens dont le
muscle obturateur interne est un élément
majeur. La rotation du membre pelvien est en
relation étroite avec la position du calcanéum
en valgus/varus. Il est utile d’en connaître les
facteurs de correction. Cela constitue la
deuxième partie de ce travail.
INÉGALITÉ DE LONGUEUR DES
MEMBRES INFÉRIEURS ET BASSIN
[1-2-3-4-5-6]
La mise en évidence d’une inégalité de lon-
gueur des membres inférieurs est d’une telle
fréquence que certains la considèrent comme
une variante de la normale tant qu’elle
demeure en deçà des 20 m/m de différence.
Mais ce déséquilibre génère des mécanismes
de compensation en regard des éléments
moteurs du squelette axial et appendiculaire,
indispensables au maintien de l’horizontalité
des capteurs céphaliques de l’équilibre (œil et
vestibule).
Ce déséquilibre est responsable sur le plan
biomécanique d’une asymétrie de répartition
des contraintes sur les différentes pièces
squelettiques et sur les articulations dont la
tolérance et leur absorption seront limitées
dans le temps en fonction d’un grand nombre
de facteurs tant physiques, (amplitude, fré-
quence, intensité et durée des sollicitations
mécaniques), physiologique (alimentation et
hydratation), climatique que psychique.
Ainsi, entre la sole plantaire et la jonction cer-
vico-céphalique, l’organisme va utiliser toutes
les ressources biomécaniques disponibles
pour corriger cette perturbation :
•au niveau pelvien et sous-pelvien en “allon-
geant” le membre inférieur court et en “rac-
courcissant” le membre inférieur long ;
• et au niveau rachidien pour conserver
l’horizontalité des condyles occipitaux en
jouant sur les degrés de liberté articulaire
de chaque segment inter-vertébral.
1 )–
Podologie et anneau pelvien
D. BONNEAU
Service de Gynécologie-Obstétrique - CHU Carémeau - 30000 Nîmes
Institut Supérieur de Thérapeutique Manuelle - 23, avenue des Lierres - 84000 Avignon
www.medecinemanuelle.fr

Il est aisé de comprendre qu’une inégalité
modérée de 5 à 15 m/m peut être parfaite-
ment tolérée pendant de nombreuses années
chez un sujet sédentaire, mais chez un sportif
de loisir ou de compétition, une intense sollici-
tation mécanique peut décompenser les fac-
teurs de correction et déclencher une patholo-
gie mécanique patente tant sur le mode chro-
nique qu’aigu.
S’il est classique de rattacher une lombalgie
qui se majore en station debout à l’asymétrie
du socle pelvien (syndrome du cocktail), il faut
aussi penser à l’inégalité de longueur des
membres inférieurs (ILMI) chez le sportif autant
que chez le sédentaire (enfant ou adulte) lors
de manifestations algiques articulaire et péri-
articulaire de surcharge des membres infé-
rieurs, surtout lorsqu’elles sont unilatérales.
Etiologie
Le plus souvent idiopathique lorsqu’elles sont
inférieures à 20 m/m.
Plus rarement secondaire et dans ce cas il
faut garder en mémoire qu’une inégalité de
longueur des membres inférieurs peut être
due certes à un retard de croissance, mais
aussi à une accélération de la croissance, le
membre inférieur court étant le membre nor-
mal de référence comme dans le syndrome
de Klippel-Trenaunay.
On ne reprendra pas la liste exhaustive des
étiologies des affections congénitales, infec-
tieuses, paralytiques ou tumorales respon-
sables des troubles de la croissance osseuse,
mais nous insisterons sur les étiologies trau-
matiques, telle que la stimulation de croissan-
ce dans la fracture diaphysaire du membre
inférieur de l’enfant mais aussi et surtout les
traumatismes du cartilage métaphysaire
méconnus (Salter V), responsables en outre
parfois d’un trouble d’axe.
Etude biomécanique
L’organisme humain possède un système
hautement sophistiqué de régulation de la sta-
tion érigée. Sans développer le vaste domai-
ne de la posturologie, il demeure intéressant
d’observer les mécanismes d’adaptation seg-
mentaire articulaire lors de l’existence d‘une
inégalité de longueur des membres inférieurs.
Cette adaptation est due à l’action des
muscles, dont l’activité se majore de façon
asymétrique d’où les contraintes au niveau
des tendons et des enthèses.
Les modifications débutent au niveau du pied
où l’articulation sous-talienne permet non seu-
lement au calcanéum de se valgiser ou se
variser, mais grâce au couplage fonctionnel
avec le médio-pied (symbolisé par l’axe de
Hencke), il entraîne une chute ou une éléva-
tion de ce dernier dont la clef de voûte est l’os
naviculaire (scaphoïde tarsien).
Comme l’ont montré les études électromyo-
graphiques, le triceps sural du membre infé-
rieur court est plus actif, générant une ten-
dance à l’équin.
Au niveau du genou, les modifications sont
essentiellement sagittales (flexum ou récurva-
tum) mais aussi frontale (varus ou valgus).
Algies pelvi-périnéales et thérapies manuelles
–( 2
Fig. 1 : Inégalité de longueur secondaire
à une pathologie coxo-fémorale

Au niveau pelvien, l’étude est tridimen-
sionnelle :
- dans un plan frontal, bascule du côté court
générant un découvert relatif de la tête
fémorale du côté long.
- dans un plan sagittal, chaque os coxal pro-
fite de l’autonomie, restreinte mais présen-
te, au niveau symphysaire et sacro-iliaque,
pour subir un mouvement de rétroversion et
d’antéversion.
- dans le plan horizontal une rotation qui se
traduit par une anté-position ou rétro-posi-
tion évaluée sur un sujet debout par la saillie
fessière.
Les études radiographiques montrent le jeu
simultané du sacrum.
Au niveau lombaire, l’obliquité du plateau
sacré entraîne une inclinaison de la colonne
lombaire qui est neutralisée par la contrac-
tion des muscles opposés à la bascule
(psoas, carré des lombes, para-vertébraux
dorsaux), et l’attitude scoliotique classique-
ment décrite peut s’associer dans le temps à
une composante rotatoire due non seule-
ment à la répartition des pressions sur le
segment intervertébral et son tripode (disque
et articulaire postérieur), mais aussi à
l’action musculaire du psoas.
L’ensemble aboutit à une attitude scoliotique
convexe du côté du membre inférieur court, et
quand la rotation survient l’arc dorsal se dirige
vers la concavité de la courbe.
Nous limiterons l’étude des composantes de
compensation au segment lombaire, mais il
est fondamental de ne pas négliger le réglage
ultime de l’horizontalité du segment cépha-
lique grâce au cardan sous occipital C0-C1-
C2 et à son système de mobilisation tridimen-
sionnelle musculaire.
En résumé
Du côté du membre court
- varus calcanéen sous l’action du triceps,
surcharge du système tricipito-achilléo-cal-
canéo-plantaire,
- récurvatum du genou,
- rétroversion de l’hémi-bassin homo latéral.
Du côté du membre inférieur long
- valgus calcanéen qui peut se prolonger vers
l’avant-pied par un hallux valgus secondaire,
- flexum et valgus du genou,
- pseudo-découvert frontal de la tête fémorale.
Au niveau pelvien
- dans un plan frontal, bascule du côté court
générant un découvert relatif de la tête
fémorale du côté long,
Podologie et anneau pelvien
3 )–
© Sauramps Médical. La photocopie non autorisée est un délit.
Fig. 2 : Muscles sous-occipitaux
et cardan occiput-atlas-axis

- dans un plan sagittal, chaque os coxal pro-
fite de l’autonomie, restreinte mais présen-
te, au niveau symphysaire et sacro-iliaque,
pour subir un mouvement de rétroversion et
d’antéversion,
- dans le plan horizontal une rotation qui se
traduit par une anté-position ou rétro-posi-
tion évaluée sur un sujet debout par la saillie
fessière.
Au niveau du rachis lombaire
- attitude scoliotique convexe du côté du
membre inférieur court sans rotation verté-
brale, pouvant se structuraliser dans le
temps.
Étude clinique
Évoquer une inégalité de longueur des
membres inférieurs fait partie intégrante de la
démarche diagnostique étiologique en méde-
cine devant une pathologie mécanique de
l’appareil locomoteur :
- coxopathie (côté long),
- sciatalgie (côté long),
- lombalgie bilatérale à la station debout pro-
longée,
- tendinopathie d’Achille du côté court et péri-
patellaire du côté long.
Mais aussi, chez le jeune péri-pubertaire :
- Sever du côté court,
- Osgood Schlatter ou Sinding-Larsen du
côté long.
Rechercher l’inégalité de longueur des
membres inférieurs à l’examen clinique néces-
site un faisceau d’arguments convergents :
- debout, de face et de dos, les membres
inférieurs en extension. Plus que le repéra-
ge des épines iliaques postérieures et supé-
rieures, on privilégie la palpation du sommet
des crêtes iliaques, qui est plus fiable pour
juger de l’horizontalité de la ligne virtuelle
qui les unit. La recherche de la déviation de
l’axe occipital grâce au fil à plomb est un
excellent mode d’appréciation de
l’asymétrie de répartition des contraintes
(fig. 3). Certains associent cette étape à la
mesure des forces de réaction au sol par
l’intermédiaire de balances du commerce
sous chaque pied ou par une plate-forme de
stabilométrie, plus fiable, qui fournit en outre
des informations sur la projection au sol du
centre de masse ou de gravité.
- debout, de face membre inférieur en exten-
sion, on demande une flexion antérieure du
tronc et on contrôle l’horizontalité du relief
fessier et l’éventuelle structuralisation de
l’attitude scoliotique par la mise en évidence
d’une gibbosité lombaire.
- en décubitus, MI en extension, la mesure de
la distance EIAS-ML (Epine iliaque antéro-
supérieure - malléole latérale), manque de
Algies pelvi-périnéales et thérapies manuelles
–( 4
Fig. 3 : Recherche de la déviation
de l’axe occipital dans le plan frontal

fiabilité essentiellement due à l’asymétrie
positionnelle des os coxaux. Une rotation
asymétrique des membres inférieurs oriente
vers le côté court dont la rotation latérale
spontanée est plus importante.
- en décubitus, en double flessum (genoux et
hanches) avec positionnement symétrique
des pieds, par un regard tangentiel on
apprécie l’éventuel décalage entre la hau-
teur des deux genoux (plan patellaire).
- en position assise. Faisant suite aux précé-
dentes, le sujet “roulant” sur ses ischions, il
supprime une contracture musculaire
lombo-pelvienne de compensation, notam-
ment celles du carré des lombes.
- on peut compléter l’examen par l’obser -
vation des segments, le sujet assit les
jambes pendantes.
Mais il existe des pièges fréquents que l’on
rencontre durant l’examen :
- Le premier est l’inversion du côté de
l’inégalité en position debout et couché, le
côté long en position debout devenant
court en position couchée, ce paradoxe est
en rapport avec la contraction ou la rétrac-
tion du carré des lombes et des para-ver-
tébraux du côté long. Il est donc important,
lors de ce temps d’examen, de réaliser un
étirement post-isométrique des carrés des
lombes.
- Le deuxième piège se retrouve en dehors
de toute inégalité vraie des membres, lors
de perturbation du système postural où
une anomalie du capteur oculaire ou vesti-
bulaire génère des perturbations descen-
dantes dont l’ultime adaptation est podale
(varus ou valgus).
- Le dernier piège, bien connu des ostéo-
pathes, repose sur les dysfonctions lom-
baires et pelviennes où des asymétries de
contraction ou du tonus musculaire créent
de fausse inégalité de longueur des
membres inférieurs.
Etude radiographique
Elle permet d’affirmer l’inégalité de longueur
des membres inférieurs.
La méthode de Bell Thompson, orthoradiogra-
phie des membres inférieurs avec repère
opaque intercalé, permet de mesurer avec
précision les longueurs sur ces repères.
Henrard a proposé une méthode plus simple
et aussi précise, en réalisant un cliché de face
du bassin en charge, avec un écart entre les
bords médiaux du pied de 19 cm (écart inter-
acétabulaire) sujet à 1,80 m de l’ampoule.
Mais l’imagerie nous apporte bien d’autres
renseignements sur les clichés standards tels
que celui du bassin de face en charge, les
incidences de face et de profil du rachis lom-
baire et de la jonction lombo-sacrée (fig. 4).
Sur le cliché du bassin de face en charge :
- Agrandissement du trou obturateur du côté
court.
- Augmentation de la hauteur du pubis du
côté court.
- Amincissement de l’ilion du côté court.
- Insuffisance cotyloïdienne relative du côté
long.
Podologie et anneau pelvien
5 )–
© Sauramps Médical. La photocopie non autorisée est un délit.
Fig. 4 : Bassin de face : mise en évidence
des modes de compensation d’une ILMI
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%