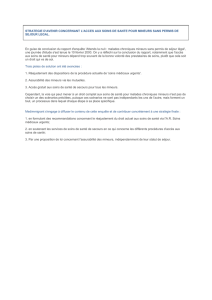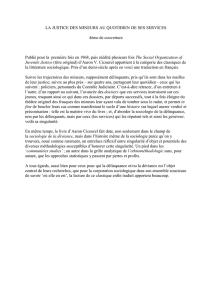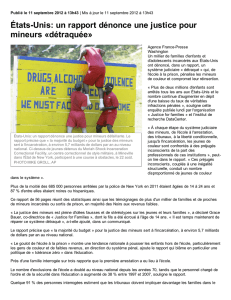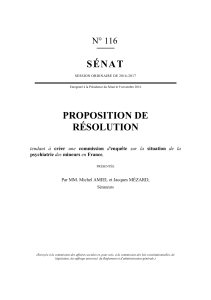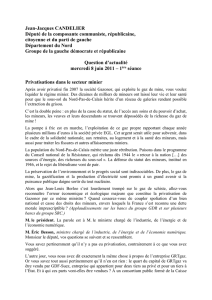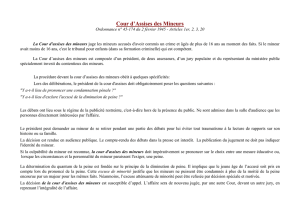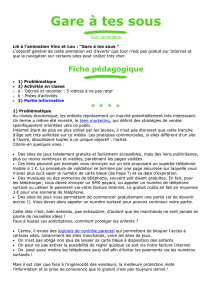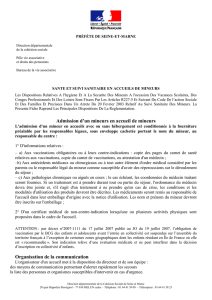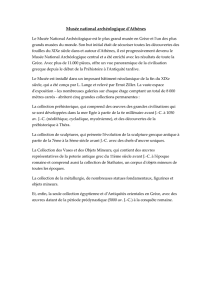Justice, délinquance des enfants et des adolescents

Justice, délinquance
des enfants et des adolescents
Etat des connaissances
Actes de la journée du 2 février 2015
www.justice.gouv.fr

JUSTICE, DÉLINQUANCE DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS
État des connaissances
Actes de la journée du 2 février 2015
Ministère de la Justice
Mai 2015

2

3
« Ainsi seront conciliés les intérêts de la société,
de la victime et du mineur »…
par Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice
Lors de son discours du 18 janvier 2013 devant la Cour de cassation, le Président de la République a
afrmé la nécessité de transformer en profondeur la justice des mineurs. Parce que cela concerne
la jeunesse, il a rappelé que c’était l’une de ses priorités. Il lui est apparu indispensable de clarier
et simplier le droit pénal appliqué aux moins de 18 ans, de consolider le rôle du juge des enfants,
de moderniser la procédure en permettant de prononcer rapidement la culpabilité du mineur,
avec, le cas échéant, un droit immédiat à la réparation pour les victimes, et la réinsertion comme
impératif pour éviter la récidive. « Ainsi seront conciliés les intérêts de la société, de la victime et
du mineur », concluait alors le Président François Hollande.
Pendant deux ans, le ministère de la Justice a conduit un processus de concertation sur la justice
des mineurs, à l’instar de ce qui avait été fait pour la réforme pénale (Conférence de consensus
sur la prévention de la récidive en 2013) et la Justice du 21e siècle. De nombreux professionnels,
des universitaires, des élus, le milieu associatif et de nombreux acteurs de la société civile, se
sont mobilisés. Un état des connaissances a été dressé, an de dépasser les présupposés
et les malentendus, les peurs et les fantasmes, qui font du jeune délinquant l’une des gures
contemporaines du mal, pour reprendre les termes du député Dominique Raimbourg.
Ainsi le travail sur l’état des connaissances a souligné la coexistence de deux jeunesses : d’un
côté, une jeunesse bénéciant de tous les relais éducatifs, en phase avec les transformations de
la société et son inscription dans le monde. De l’autre, une jeunesse à l’avenir incertain, enclavée
dans des quartiers populaires et des territoires ruraux délaissés et sous équipés, une jeunesse pour
laquelle les promesses d’insertion et d’accès à la citoyenneté ne sont pas tenues. Il est apparu
que la prolongation des études et l’accès difcile à un premier emploi retardaient, pour tous les
jeunes, l’entrée dans la vie adulte. De même, la disparition de rites de passage comme le service
militaire - une séquence qui permettait aux jeunes de milieux populaires ou ruraux de sortir de
chez eux et d’apprendre un métier - a supprimé des lets de sécurité pour les plus fragiles.
Le travail sur l’état des connaissances a également mis en lumière que la délinquance juvénile
n’était pas plus précoce qu’avant, qu’elle concernait principalement des garçons de 16 et 17 ans,
et que ces adolescents, pour la majorité d’entre eux, n’avaient affaire qu’une seule fois à la justice
pénale. Les autres – environ un tiers –, y reviennent au moins une fois. Quelques-uns, moins de 10%,
s’installent dans un parcours chaotique et délinquant, et semblent mettre en échec les décisions
judiciaires et les prises en charge éducatives. C’est principalement pour s’occuper mieux de ces
adolescents récidivistes que la réexion a été conduite, an d’améliorer le fonctionnement de la
justice des mineurs et d’identier les modalités de prises en charge les plus appropriées.
Pendant deux ans, des débats sereins ont eu lieu. Un consensus s’est établi pour adapter
l’ordonnance de 1945 à l’évolution de notre société, en conserver les principes – un adolescent
n’est pas un adulte et la société a la charge de l’éduquer et de lui faire sa place de citoyen –,
mais la nettoyer des incohérences accumulées au l de multiples modications, qui ont largement
creusé l’écart entre l’esprit du texte d’origine et sa difcile mise en œuvre aujourd’hui.

4
Il est nécessaire d’actualiser la justice des mineurs car, si les jeunes délinquants ont changé depuis
1945, c’est au rythme des changements de la société et de la justice. Aujourd’hui, la société
sollicite la justice pour apporter des réponses à des situations qui relevaient jadis d’interventions
non judiciaires. Il en est ainsi des incivilités urbaines ou scolaires et des violences entre jeunes.
Pour répondre à cette injonction de « tout juger », la justice a d’ores et déjà imaginé des réponses
nouvelles, telles que la mesure de réparation, qui invite à une nouvelle conception de la justice
pénale. Elle met en relation l’adolescent délinquant, la victime et leur environnement social.
Ce type de mesure requiert l’adhésion et l’engagement des personnes concernées et construit
la responsabilisation du jeune. Il favorise sa prise de conscience des autres. Dans un même
mouvement, il aide ce jeune à trouver une juste place dans la société en lui donnant l’occasion
d’y apporter une contribution positive.
La justice des mineurs doit mettre en œuvre des sanctions et des prises en charge qui
responsabilisent, réinsèrent et accompagnent mieux les adolescents. Une justice à la fois
contraignante et éducative, qui sanctionne ce qui doit l’être et assure un suivi individualisé, qui
rende complémentaires la logique éducative et la logique de sanction, qui sache adapter la
prise en charge au parcours souvent chaotique des mineurs délinquants, intensier le contrôle
quand il le faut et le relâcher si nécessaire.
Le monde change et il faut savoir porter un regard critique constant sur les pratiques professionnelles
pour répondre mieux aux questions de nos contemporains. L’action de cette justice de demain
devra s’inscrire davantage dans la durée. Elle sera organisée pour éviter les ruptures de prise en
charge, les abandons de suivi, les « sorties sèches » d’institutions. Idéalement, il ne devrait y avoir
aucun trou, aucun vide entre les décisions de justice et leur prise en charge. Dans la pratique
quotidienne, il y a encore du chemin à faire.
La justice des mineurs devra aussi opérer un effort de simplication et de lisibilité de ses décisions,
car comprendre l’acte délictueux et les causes de l’interdit n’est possible que si le jeune et sa
famille en perçoivent le sens. De même, elle devra s’ouvrir sur l’extérieur pour que ses partenaires,
élus et acteurs sociaux, comprennent mieux ce qu’elle fait et pourquoi elle le fait.
Elle devra également engager une double accélération : d’abord dans les prises en charge,
faute de quoi l’adolescent délinquant est conforté dans sa toute-puissance; ensuite, dans la
reconnaissance des victimes et de leurs droits, an de les dédommager sans attendre des mois,
voire des années, comme on le voit encore souvent aujourd’hui.
La justice des mineurs, par sa nalité éducative, a un objectif premier, la sortie de délinquance des
adolescents dont elle est saisie, et un objectif plus lointain, leur donner la capacité de participer
à la fois au renouvellement du monde dont ils seront les acteurs et à sa continuité. « Ainsi seront
conciliés les intérêts de la société, de la victime et du mineur »…
Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
 147
147
 148
148
 149
149
 150
150
 151
151
 152
152
 153
153
 154
154
 155
155
 156
156
 157
157
 158
158
 159
159
 160
160
 161
161
 162
162
 163
163
 164
164
 165
165
1
/
165
100%