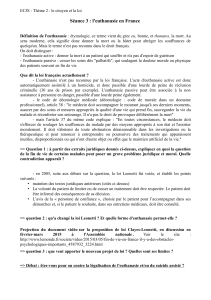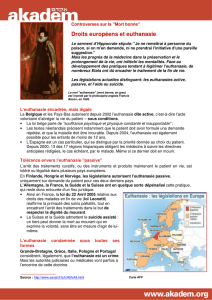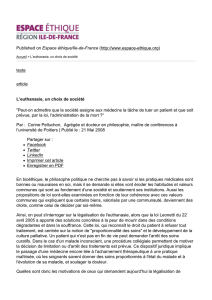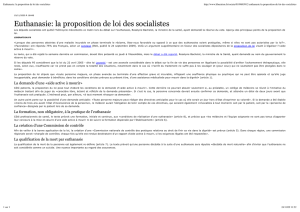Le bilan de l`application de la loi dépénalisant l`euthanasie Le bilan

LE JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE
L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
LE JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE
L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 TRIMESTRIEL – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
BELGIQUE/BELGIË
PP/PB
B-714
Bureau de dépôt Bruxelles X Brussel
Éditeur responsable: Harry Bleiberg, 1 rue Héger-Bordet, 1000 Bruxelles – N° d’agréation: P501016 – Autorisation de fermeture B-714 – Ne paraît pas en juillet-août
DOSSIER EUTHANASIE:
Rédacteur invité: Marc Englert,
membre de la Commission Fédérale de contrôle
et d’évaluation de l’euthanasie
Le bilan de l’application
de la loi dépénalisant
l’euthanasie p. 5
L’avis du médecin praticien,
de l’éthicien, du juriste… pp. 8-16
Titre et compétences
en oncologie: une nécessité…
mais sous contrôle! p. 2
QU’EN PENSENT-ILS?
Grossesse et cancer du sein,
prévention du cancer du sein.
Prophylaxie anticoagulante pp. 21-22
DOSSIER EUTHANASIE:
Rédacteur invité: Marc Englert,
membre de la Commission Fédérale de contrôle
et d’évaluation de l’euthanasie
Le bilan de l’application
de la loi dépénalisant
l’euthanasie p. 5
L’avis du médecin praticien,
de l’éthicien, du juriste… pp. 8-16
Titre et compétences
en oncologie: une nécessité…
mais sous contrôle! p. 2
QU’EN PENSENT-ILS?
Grossesse et cancer du sein,
prévention du cancer du sein.
Prophylaxie anticoagulante pp. 21-22

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
1
ÉDITORIAUX
2
Titre et compétences en oncologie: une nécessité… mais sous contrôle!
Dominique de Valeriola
3
La loi Belge de dépénalisation de l’euthanasie médicale
Marc Englert
DOSSIER EUTHANASIE
5Le bilan de l’application de la loi dépénalisant l’euthanasie
Marc Englert
8
La législation de la pratique de l’euthanasie
Bernard Hanson
9
Euthanasie et techniques palliatives en fin de vie
Dominique Lossignol
14
L’euthanasie: le patient est-il suffisamment informé?
Dominique Bron
15
L’interdiction de l’euthanasie: conséquences médicales et humaines
Jacqueline Herremans
INFORMATION SCIENTIFIQUE
17
La radiothérapie guidée par l’imagerie (Image Guided Radiotherapy ou IGRT)
Paul Van Houtte
18
Pour une prise en charge raisonnée des œdèmes post-thérapeutiques?
Pierre Bourgeois
24
Nouveauté thérapeutique dans la prise en charge précoce
de l’extravasation aux anthracyclines
Yassine Lalami
QU’EN PENSENT-ILS?
20
Tamoxifen prevents breast cancer in women with an increased risk profile
Jacques De Grève
21
Grossesse et cancer du sein: quand est-ce raisonnable?
Jean-François Baurain
21
Méta analyse: prophylaxie anticoagulante pour prévenir
l’apparition de thromboses veineuses symptomatiques chez les patients
hospitalisés pour raisons médicales
Marie-Agnès Azerad
AU-DELÀ DE LA MÉDECINE
26
Pourquoi je n’aime pas les Nouveaux Réalistes
Pierre Sterckx
RÉDACTEURS EN CHEF
Harry BLEIBERG
Ahmad AWADA
Recherche Clinique
Ahmad AWADA
Recherche Translationnelle
Fatima CARDOSO
Recherche Fondamentale
Christos SOTIRIOU
Gilbert VASSART
Hémato-oncologie
Willy FERREMANS
Philippe MARTIAT
Psycho-oncologie
Nicole DELVAUX
Darius RAZAVI
Spécialistes en oncologie
Vincent NINANE
Jean-Luc VAN LAETHEM
Bordet-IRIS
Jean-Pierre KAINS
Martine PICCART
Wallonie
Vincent RICHARD
Erasme
Thierry VELU
COMITÉ DE RÉDACTION
Ahmad AWADA
Harry BLEIBERG
Arsène BURNY
Vincent NINANE
Jean-Claude PECTOR
Martine PICCART
Jean-Luc VAN LAETHEM
CONSEILLERS SCIENTIFIQUES
Marc ABRAMOWICZ
Guy ANDRY
Michel AOUN
Jean-Jacques BODY
Dominique BRON
Dominique DE VALERIOLA
Olivier DEWITT
André EFIRA
Patricia EWALENKO
Patrick FLAMEN
Thierry GIL
Michel GOLDMAN
André GRIVEGNEE
Alain HENDLISZ
Jean KLASTERSKY
Denis LARSIMONT
Marc LEMORT
Dominique LOSSIGNOL
Thi Hiyen N’GUYEN
Thierry ROUMEGUERE
Eric SARIBAN
Jean-Paul SCULIER
Philippe SIMON
ASSISTANTE À LA RÉDACTION
Martine HAZARD – Tél. 02/541 32 01
jcancer[email protected]
COMITÉ DE LECTURE
Marianne PAESMANS
Jean-Claude PECTOR
Marielle SAUTOIS
Le contenu des articles publiés
dans ce journal n’engage
que la responsabilité de leur(s) auteur(s)
www.jcancerulb.be
helps build in cellular protection against oral mucositis
Resp. Editor. : A. Hubert/AMGEN/2007/1820
Summary of Product Characteristics
Name of the medicinal product: Kepivance 6.25 mg powder for solution for injection. Qualitative and quantitative composition: Each vial contains 6.25 mg of palifermin. Palifermin is a human keratinocyte
growth factor (KGF), produced by recombinant DNA technology in Escherichia coli. Reconstituted Kepivance contains 5 mg/ml of palifermin. Excipients: L-histidine, Mannitol, Sucrose, Polysorbate 20, Diluted
Hydrochloric acid. Therapeutic indications: Kepivance is indicated to decrease the incidence, duration and severity of oral mucositis in patients with haematological malignancies receiving myeloablative therapy
associated with a high incidence of severe mucositis and requiring autologous haemopoietic stem cell support. Posology and method of administration: Kepivance treatment should be supervised by a physician
experienced in the use of anti-cancer therapy. Adults: The recommended dosage of Kepivance is 60 micrograms/kg/day, administered as an intravenous bolus injection for three consecutive days before and three
consecutive days after myeloablative therapy for a total of six doses (see below). Kepivance should not be administered subcutaneously due to poor local tolerability. Reconstituted Kepivance should not be left at
room temperature for more than one hour, and should be protected from light. Prior to administration, visually inspect the solution for discolouration and particulate matter before administration. Pre- myeloablative
therapy: The first three doses should be administered prior to myeloablative therapy, with the third dose 24 to 48 hours before myeloablative therapy. Post- myeloablative therapy: The last three doses should be
administered post myeloablative therapy; the first of these doses should be administered after, but on the same day of haematopoietic stem cell infusion and at least four days after the most recent Kepivance
administration. Children and adolescents: The safety and efficacy of Kepivance in children and adolescent patients have not been established, Kepivance should not be used in children or adolescents until further
data become available. Renal impairment: Dose adjustment in patients with renal impairment is not necessary. Hepatic impairment: Safety and efficacy has not been evaluated in patients with hepatic impairment.
Elderly: Safety and efficacy has not been evaluated in the elderly. Contraindications: Hypersensitivity to palifermin or to any of the excipients, or to Escherichia coli-derived proteins. Undesirable effects: Safety
data are based upon 650 patients with haematological malignancies enrolled in 3 randomised, placebo-controlled clinical studies and a pharmacokinetic study. Patients received Kepivance (n = 409) or placebo
(n = 241) either before, or before and after, myelotoxic chemotherapy with or without total body irradiation and peripheral blood progenitor cell (PBPC) support. Adverse reactions were consistent with the
pharmacologic action of Kepivance on skin and oral epithelium (see Table 1). These reactions were primarily mild to moderate in severity and were reversible. Median time to onset was 6 days following the first
of 3 consecutive daily doses of Kepivance, with a median duration of 5 days. The adverse reactions of pain and arthralgia were consistent with Kepivance treated patients having received less opioid analgesia
than placebo-treated patients.
Table 1. Adverse reactions occurring with > 5% higher incidence with Kepivance compared to placebo
System organ class Undesirable effect
Nervous system disorders
Gastrointestinal disorders
Skin and subcutaneous tissue disorders
Musculoskeletal and connective tissue disorders
General disorders and administration site conditions
Very common (> 1/10)
Taste perversion
Mouth/tongue thickness or discolouration
Rash, pruritus and erythema
Arthralgia
Oedema, pain and fever
Haematopoietic recovery following PBPC infusion was similar between patients who received Kepivance or placebo, and there were no observed differences in disease progression or survival. Kepivance may
cause increased lipase and amylase levels in some patients with or without symptoms of abdominal pain or backache. The incidences of these changes, presented for Kepivance relative to placebo, were: lipase
(28% vs. 23%) and amylase (62% vs. 54%). No overt cases of pancreatitis have been reported in this patient population. Fractionation of increased levels of amylase revealed the increase to be predominantly
salivary in origin. Dose limiting toxicities were observed in 36% (5 of 14) patients receiving 6 doses of 80 micrograms/kg/day administered intravenously over 2
weeks (3 doses preceding and three doses following myeloablative therapy). These events were consistent with those observed at the recommended dose but were
generally more severe. Marketing authorisation holder: Amgen Europe B.V., Minervum 7061, NL-4817 ZK Breda, The Netherlands. Marketing authorisation numbers:
EU/1/05/314/001Date of first authorisation: 25/10/2005. Date of revision of the text: 12/04/2007. Classification of the medicine: Medicinal product subject to
restricted medical prescription More information available at: Amgen n.v/s.a; Arianelaan, 5, Avenue Ariane, B-1200 Brussel-Bruxelles, tel: 02/775 27 11. 2007/April
849,18 E per vial Ahf
(ambulatory patient)
Adénopathie cervicale d’une tumeur
de la base de langue
Reconstruction en technique de rendu
volumique à partir de données TDM
(tomodensitométrie). Le volume de la lésion
identifiée par la couleur bleue est calculé
et sa localisation par rapport aux éléments
profonds bien démontrée.
PHOTO DE COUVERTURE

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
2 3
EDITORIAUX
Titre et compétences en oncologie:
une nécessité… mais sous contrôle!
Au-delà des querelles intestines entre le Nord et le Sud du pays pour savoir qui paiera nos pensions, la
Belgique, comme tous les pays européens, aura à l’avenir à relever un important défi de santé publique lié
au vieillissement de la population, la prise en charge d’un nombre croissant de patients atteints de cancer.
L’incidence du cancer en Belgique est, en effet, estimée à 66.000 cas pour 2015, soit une augmentation
de 50% en 20 ans. Si nous pouvons nous enorgueillir d’avoir un des taux de survie à 5 ans après cancer
parmi les meilleurs d’Europe, beaucoup de chemin reste encore à parcourir.
Tout le monde s’accorde pour dire que la formation des professionnels de la santé et la multidisciplinarité
de la prise en charge des patients sont deux importants garants de l’amélioration des résultats.
La récente reconnaissance d’une nouvelle spécialité, l’oncologie médicale, et de la compétence particulière
en oncologie pour diverses spécialités par l’A.M. du 11 mai 2007 représente une avancée significative, attendue depuis de
nombreuses années par certains, quoique fortement controversée par d’autres.
Si certaines des raisons avancées, telles que les conséquences négatives de l’hyperspécialisation des médecins, peuvent être
entendues, force est de constater que la motivation de nombreux détracteurs de la reconnaissance de l’oncologie médicale
est surtout la crainte de la perte du monopole auprès de leurs patients et par voie de conséquence d’une partie de leurs revenus.
L’oncologie médicale est apparue comme discipline à part entière aux États-Unis depuis 1973, en France depuis 1988. La
reconnaissance européenne de la spécialité a été obtenue en 1997 et de nombreux pays européens forment des oncologues
médicaux depuis de nombreuses années. En Belgique, cela faisait plus de 15 ans que la reconnaissance tentait d’être
obtenue par un nombre toujours croissant de médecins internistes consacrant la totalité de leur activité à l’oncologie.
Établir de manière efficiente le stade de la maladie par les techniques diagnostiques les plus appropriées, bien maîtriser la
physiopathologie complexe des cancers, leurs facteurs pronostiques et prédictifs de réponse à certains traitements mais
aussi manier correctement et de manière rationnelle l’ensemble de l’arsenal thérapeutique en prenant le temps d’informer
et d’écouter les patients, justifient pleinement cette formation particulière et cette nouvelle spécialité.
Le défi des oncologues médicaux sera d’utiliser les agents cytotoxiques, l’immunothérapie ou encore les thérapies biologiques
(des traitements souvent très coûteux) à bon escient et en en minimisant les effets secondaires à court et à long terme.
L’apparition d’un nombre toujours plus grand de médicaments anticancéreux à mécanismes d’action de plus en plus variés et
sophistiqués nécessitera de leur part un important effort d’adaptation et de formation continue. Mais leur plus grand chal-
lenge sera assurément d’encourager et de dynamiser la multidisciplinarité de prise en charge des patients par les différents
spécialistes concernés. C’est là un gage de la réussite des traitements.
La reconnaissance d’une compétence en oncologie, en particulier pour les spécialités filles de la médecine interne, la chirurgie,
la gynécologie ou l’urologie est sans nul doute justifiée pour un certain nombre de spécialistes de ces disciplines qui ont suivi
une formation spécifique dans le domaine et consacrent l’essentiel de leur activité au cancer. Cette reconnaissance devrait
assurer une amélioration de la qualité des soins aux patients cancéreux, en particulier pour ceux qui présentent des tumeurs
plus rares ou nécessitant des techniques thérapeutiques sophistiquées. Les principales difficultés résideront dans la définition
de critères d’octroi suffisamment stricts et équitables à travers les différentes spécialités, et dans la détermination des actes
réservés à ces médecins experts en oncologie. Il faut éviter en effet que cette compétence particulière en oncologie ne soit
galvaudée. Par ailleurs, l’introduction de cette qualification représente un risque, si l’on n’y prend garde, celui de réduire l’ap-
proche multidisciplinaire de la prise en charge en induisant un cloisonnement par organe. Ceci pourrait survenir si un même
spécialiste, motivé par exemple par des considérations financières, assurait lui-même et de bout en bout les examens diag-
nostiques, la prise en charge thérapeutique et les examens de suivi de son patient sans prendre l’avis d’autres confrères.
Ce risque de cloisonnement par organe pourrait à terme limiter les avancées thérapeutiques. Trop segmenter les soins et la
recherche sur les nouveaux médicaments par organe aurait pour conséquence de gâcher des occasions de développement
de nouvelles stratégies thérapeutiques utiles à d’autres types de cancer. Certaines nouvelles approches en effet ne sont plus
organe-spécifiques mais plutôt ciblées sur des marqueurs biologiques de la cellule cancéreuse ou de son environnement. Ces
marqueurs peuvent concerner plusieurs types de cancers développés à partir d’organes différents. Il conviendra donc d’être
vigilant en terme d’organisation des soins afin de faire prévaloir la culture multidisciplinaire, garante de la qualité en oncologie.
Avec ces reconnaissances, une importante étape vient d’être franchie en Belgique. Cette nouvelle donne devra être intégrée
rapidement dans la réflexion sur le numerus clausus, réflexion qui s’impose de toute urgence si nous voulons conserver une
médecine de qualité en Belgique, en particulier pour cette pathologie en constante progression.
Dominique de Valeriola
Oncologie Médicale
Directeur Général Médical
Institut Jules Bordet
La loi Belge de dépénalisation
de l’euthanasie médicale
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
Un dossier consacré à la question délicate et controversée de la dépénalisation légale de l’euthanasie médicale dans notre
pays nécessite avant tout un rappel clair et succinct de ce qu’est la loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie et du
contexte qui a entouré sa promulgation.
LE CONTEXTE
La loi dépénalisant l’euthanasie sous certaines conditions fait partie d’un groupe de trois législations relatives à la fin de la vie
adoptées par le Parlement belge en 2002. Celles-ci sont toutes les trois axées sur le respect de l’autonomie du malade et de
celle du médecin, sans imposer quoi que ce soit à ceux dont les conceptions éthiques privilégient le respect absolu de la vie.
La première, intitulée «Loi relative aux droits du patient», énumère une série de droits qui sont reconnus à tout patient.
L’un de ces droits, en particulier, permet de refuser un traitement quel qu’il soit et donne donc la possibilité, en fin de vie,
d’éviter tout acharnement thérapeutique. Le refus de traitement peut être acté par une déclaration anticipée pour le cas où
l’évolution de l’affection rendrait le patient incapable d’exprimer ses volontés et cette déclaration peut comporter la désigna-
tion d’un mandataire chargé de faire respecter ces volontés. Si le refus de traitement est clairement précisé, le mandataire peut
exiger que le médecin le respecte. Dans le cas où aucun mandataire n’a été nommément désigné, la loi énumère, selon un
ordre de priorité, les personnes chargées de représenter le patient, mais dans ce cas, le médecin garde un pouvoir d’appré-
ciation quant au meilleur intérêt du patient.
La seconde, dite «Loi relative aux soins palliatifs», adoptée simultanément à la loi dépénalisant l’euthanasie, crée les
conditions médicales et matérielles permettant d’assurer l’accès aux soins palliatifs à tout patient en fin de vie. Précisée par
toute une série d’arrêtés royaux, cette loi a permis à la Belgique de disposer actuellement d’un réseau de soins palliatifs
extrêmement étendu, tant en milieu hospitalier qu’au domicile du patient.
La troisième, la «Loi relative à l’euthanasie» fait l’objet du présent dossier. Elle précise les conditions qui rendent l’eutha-
nasie non punissable. En-dehors de ces conditions, l’euthanasie reste en effet un homicide avec préméditation.
LA DÉFINITION
La loi définit l’euthanasie comme un acte pratiqué par un tiers qui met intentionnellement fin à la vie d’une personne à la
demande de celle-ci. Pour qu’il puisse ne pas être considéré comme un délit, cet acte doit être pratiqué par un médecin à un
patient se trouvant dans une situation médicale sans issue, définie par les différents articles de la loi.
Il faut distinguer cet acte de l’arrêt ou de la non-instauration d’un traitement susceptible de prolonger la vie ainsi que du traite-
ment intensif de la douleur ou d’autres symptômes. Ces décisions médicales sont éventuellement susceptibles d’abréger la
vie mais si cet effet n’est pas intentionnellement recherché, elles sont considérées comme des pratiques médicales normales
et relèvent de la simple déontologie de la profession.
LES JUSTIFICATIONS
Les principaux arguments qui ont été invoqués en faveur de la dépénalisation conditionnelle de l’euthanasie sont les sui-
vants:
- Une plus grande autonomie de décision du patient sur sa vie et sa mort est légitime.
- Une grande partie de la société refuse l’obligation idéologique de subir une mort «naturelle» au moment imposé par la maladie.
- La mort par simple arrêt de traitement est souvent insuffisante pour provoquer une mort sans souffrances.
- Les soins palliatifs ont leurs limites et connaissent des échecs.
- L‘interdiction de l’euthanasie a des conséquences funestes:
- Lorsque le médecin veut abréger la vie, pour se protéger d’une éventuelle accusation d’homicide, il n’utilise pas les techni-
ques médicales les plus adéquates mais se borne à augmenter les doses d’analgésiques et de sédatifs qui peuvent
entraîner un semi-coma prolongé et pénible.
- On assiste à des actes de compassion sans contrôle.
- On assiste à des suicides par des moyens violents.
>>>

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
4 5
EDITORIAUX
LES ÉTAPES
La législation dépénalisant l’euthanasie a été examinée par différentes instances entre 1996 et 2002, date de son adoption
par le Parlement. Ces étapes sont résumées ci-après:
1996: Demande d’avis au Comité consultatif de Bioéthique par les présidents de la Chambre et du Sénat
concernant l’opportunité d’un règlement de la question de l’euthanasie.
1997: 1er avis du Comité consultatif de Bioéthique (patients conscients et capables).
1999 : 2eavis du Comité consultatif de Bioéthique (patients incapables d’exprimer leur volonté).
1999: Dépôt au Sénat de deux propositions de loi: l’une relative aux soins palliatifs et l’autre à l’euthanasie.
1999-2001: Débat et 40 auditions d’experts et de témoins devant les commissions sénatoriales de la Justice
et de la Santé.
Déc. 2001: Adoption des deux propositions de loi par les commissions sénatoriales.
Juillet 2001: Avis du Conseil d’État notamment en ce qui concerne la compatibilité de la législation avec
la Convention européenne des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Oct. 2001: Adoption des deux lois au Sénat.
Mai 2002: Adoption des deux lois à la Chambre.
L’ESSENTIEL DE LA LOI RELATIVE À L’EUTHANASIE
La dépénalisation concerne l’euthanasie pratiquée par un médecin à
- un patient majeur ou mineur émancipé, conscient et capable ou
- un patient irréversiblement inconscient ayant rédigé une déclaration anticipée.
Conditions de l’absence d’infraction
- Affection incurable grave (maladie ou accident).
- Souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et inapaisables.
- Demande volontaire et ferme, répétée, sans pression extérieure.
Remarque: le caractère insupportable des souffrances est subjectif et dépend des conceptions du patient
(décision de la commission de contrôle).
Procédures à suivre
- Informer le patient de son état de santé, des possibilités thérapeutiques ou palliatives.
- S’assurer de la volonté ferme et réitérée du patient (demande écrite, entretiens répétés).
- Consulter au moins un autre médecin indépendant (si le décès n’est pas prévisible à brève échéance,
consulter deux médecins et respecter un délai d’un mois après la demande écrite).
- S’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe et avec les proches si telle est la volonté du patient.
- S’assurer que le patient a pu s’entretenir avec les personnes souhaitées par lui.
- Dans les 4 jours suivant le décès, déclarer l’euthanasie pratiquée à la commission de contrôle sur le document légal.
REMARQUES
Aucun médecin n’est tenu de pratiquer une euthanasie (dans ce cas, il doit en informer le patient).
L’euthanasie est considérée au point de vue légal comme une mort naturelle (déclaration de décès, assurances, etc.)
Aucune personne n’est tenue de participer à une euthanasie.
Note: le texte intégral de la loi, le formulaire de déclaration et les publications de la Commission fédérale de contrôle
et d’évaluation peuvent être consultés sur le site du Service public fédéral www.health.fgov.be/euthanasie
Marc Englert
Rédacteur invité
Membre de la Commission Fédérale
de contrôle et d’évaluation
de l’euthanasie
Le bilan de l’application de la loi
dépénalisant l’euthanasie
Rapports de la Commission Fédérale de contrôle
et d’évaluation
Marc Englert, Professeur honoraire à l’ULB
Membre de la Commission Fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie
Composée de 16 membres nommés par arrêté royal sur propo-
sition du Sénat, elle comprend 8 médecins dont 4 professeurs
d’université, 4 juristes ou professeurs de droit et 4 membres
d’organismes qui s’occupent de patients en fin de vie. Elle exa-
mine le volet anonyme du document d’enregistrement envoyé
par le médecin qui a pratiqué une euthanasie et peut, en cas de
doute, ouvrir le volet nominal pour demander des explications
complémentaires au médecin. Elle a le droit, aux 2/3 des voix,
de transmettre le dossier à la justice si elle estime que les
conditions de la loi n’ont pas été respectées1.
La vérification porte sur le respect des trois conditions essen-
tielles de la loi:
- affection incurable grave par maladie ou accident;
- souffrances physiques ou psychiques constantes,
insupportables et inapaisables;
- demande volontaire et ferme, répétée, sans pression
extérieure;
et sur le respect des procédures:
- informer le patient de son état de santé, des possibilités
thérapeutiques ou palliatives;
- s’assurer de la volonté ferme et réitérée du patient
par un écrit et des entretiens répétés;
- consulter au moins un autre médecin indépendant
(si le décès n’est pas prévisible à brève échéance,
deux médecins et observer un délai d’un mois après
la demande écrite);
- s’entretenir avec l’équipe soignante si elle existe;
- s’entretenir avec les proches si telle est la volonté du patient;
- s’assurer que le patient a pu s’entretenir avec
les personnes souhaitées par lui.
Les rapports aux Chambres législatives sont publiés tous les
deux ans et comportent, outre des données statistiques, une
évaluation de l’application de la loi2.
LE BILAN
Le nombre d’euthanasies pratiquées
dans le respect de la loi
Au 1er mai 2007, soit 4 ans et demi après l’entrée en vigueur de
la loi, plus de 1500 déclarations ont été examinées.
Les moyennes mensuelles ont été de 8 en 2002, de 19 en
2003, de 29 en 2004, de 33 en 2005 et de 36 en 2006. L’eutha-
nasie concerne actuellement environ 0,4% des décès.
Les données relatives aux euthanasies
83% des cas étaient des cancers généralisés ou gravement
mutilants dont la plupart avaient subi de multiples traitements
à visée curative et/ou palliative.
7% étaient des affections neuromusculaires évolutives mortelles
et, dans une moindre mesure, des séquelles neurologiques dues
à une maladie ou un accident. Les autres affections ont été rare-
ment à l’origine d’une euthanasie.
98% ont été pratiquées sur demande consciente et 2% chez
des patients inconscients sur base d’une déclaration anticipée.
93% ont été pratiquées pour des affections dont le décès était
prévisible à brève échéance et 7% alors que le décès n’était pas
prévu à brève échéance*
77% concernaient des malades d’âge moyen (entre 40 et 79 ans).
45% ont été pratiquées au domicile des patients et 54% en
milieu hospitalier.
Chez la plupart des malades, plusieurs types de souffrances,
constantes, insupportables et inapaisables, tant physiques que
psychiques, étaient présents simultanément*.
Une mort calme et rapide en sommeil profond
Dans près de 90% des cas, le décès a été obtenu en induisant
d’abord par injection une inconscience profonde (en général par
injection de 1 à 3 gr de Pentothal), et (sauf si le décès se produit
en quelques minutes dès cette injection ce qui est fréquent avec
le Pentothal) en injectant ensuite un paralysant neuromusculaire
qui provoque le décès par arrêt respiratoire**.
>>>
DOSSIER EUTHANASIE
* La commission a tenu à préciser qu’une échéance «non brève» devait être interprétée comme un décès non attendu avant plusieurs mois.
La commission a considéré que si certains facteurs objectifs peuvent contribuer à estimer le caractère insupportable de la souffrance, celui-ci est en
grande partie d’ordre subjectif et dépend de la personnalité du patient, des conceptions et des valeurs qui lui sont propres.
** La commission note que, d’après les données disponibles de la littérature médicale, une telle manière d’agir est effectivement la plus adéquate pour
remplir les conditions requises pour une euthanasie correcte: décès rapide et calme, sans souffrance ni effets secondaires.

JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
JOURNAL DU RÉSEAU CANCER DE L’UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES
N°8 – JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE 2007
6 7
DOSSIER EUTHANASIE
2. En Communauté française, l’euthanasie sur déclaration anti-
cipée est nettement plus exceptionnelle qu’en Flandre.
3. En ce qui concerne la technique la plus utilisée (thiopental ou
similaire, suivi ou non d’un curarisant), il n’y a pas de diffé-
rence entre les deux communautés.
4. En ce qui concerne les deux pathologies les plus fréquemment
en cause (le cancer et les affections neuromusculaires, soit plus
de 90% des cas), la disproportion entre le nombre d’euthana-
sies en Flandre et en Communauté française est nettement
moindre en ce qui concerne les affections neuromusculaires
qu’en ce qui concerne le cancer. Elle est également moindre
lorsque l’euthanasie est pratiquée pour une affection dont
le décès n’est pas prévisible à brève échéance, ce qui est
essentiellement le cas des affections neuromusculaires.
On peut conclure que s’il y a moins d’euthanasies déclarées
en Communauté française qu’en Flandre, la différence est
essentiellement due au nombre d’euthanasies pour cancer.
L’interprétation de cette différence n’est pas évidente.
Il est possible que les demandes d’euthanasie émanant de
malades cancéreux soient moins fréquentes en Communauté
française qu’en Région flamande mais il est improbable qu’el-
les le soient dans une mesure aussi énorme. Même si cer-
tains s’en prévalent, il est tout aussi improbable qu’un grand
nombre de médecins francophones, après avoir pratiqué une
euthanasie avérée, préfèrent le risque d’une inculpation à l’in-
convénient mineur de la rédaction d’un rapport simple, légi-
time et qui ne demande que quelques minutes d’attention. Il
faut donc admettre qu’il existe entre la Flandre et la Commu-
nauté française une différence dans la manière de gérer les
demandes d’euthanasie des patients cancéreux.
On sait qu’il est partout fréquent, en réponse à une demande
d’euthanasie de la part d’un patient cancéreux – mais non de
la part d’un patient atteint d’une affection neuromusculaire –
d’augmenter les doses d’antalgiques, couplées ou non avec
des sédatifs divers. Cette manière d’agir induit en cas de décès
une ambiguïté sur la nature de l’acte – traitement de la douleur et
de la souffrance ou mort délibérément provoquée? – et permet
donc d’éluder la nécessité de la déclaration.
Il n’en est pas de même en cas d’utilisation de produits létaux,
en raison de leur signification incontestable. Or, l’information
concernant ces produits, qui ont l’avantage majeur d’assurer
une fin de vie rapide, sans souffrance et au moment souhaité, est
plus disponible et mieux connue des médecins en Flandre qu’en
Communauté française (publications médicales hollandaises
et flamandes, existence d’un important «Forum» de plusieurs
centaines de médecins formés aux problèmes de la fin de vie
et pouvant agir comme consultants, débats dans les médias,
etc.). On peut donc comprendre que ces produits soient utilisés
plus fréquemment – et très légitimement – en Flandre, avec
comme corollaire la disproportion constatée dans le nombre de
déclarations issues des deux régions du pays.
L’analyse des documents de déclaration suggère que l’énorme
disproportion constatée entre le nombre d’euthanasies déclarées
en français et en néerlandais résulte d’une attitude différente
en ce qui concerne les demandes d’euthanasie des patients
cancéreux. Il est vraisemblable qu’en réponse à une demande
d’euthanasie, l’administration des produits létaux assurant une
fin de vie rapide, sans souffrances et au moment souhaité mais
ne permettant guère d’éluder l’obligation de la déclaration, soit
plus fréquente en Flandre qu’en Communauté française, pro-
bablement en raison d’une information médicale plus disponible
sur leur utilisation et la qualité de la fin de vie qu’ils assurent.
■
Référence
(1) Englert M, Hanson B, Lossignol D: Deux années d’euthanasie dépéna-
lisée en Belgique: comparaison avec les Pays-Bas. Premier bilan d’une
unité de soins palliatifs. Rev Med Brux 2005, 26, pp.145-151.
>>>
*** La commission a considéré que cette manière de procéder est autorisée par la loi pour autant que les conditions et les procédures légales pour que
l’euthanasie soit autorisée aient été respectées et que l’acte se soit déroulé sous la responsabilité du médecin présent et prêt à intervenir: la loi n’im-
pose pas, en effet, la manière dont l’euthanasie doit être pratiquée.
Dans 10% des euthanasies, l’inconscience a été obtenue par
administration de 9 à 12 gr d’un barbiturique en potion que le
malade a avalé lui-même («suicide assisté»). Dans certains de
ces cas, un paralysant neuromusculaire a été injecté après
que le patient soit devenu inconscient***.
Beaucoup de déclarations mentionnent que le décès est
survenu rapidement et calmement, dans une atmosphère
sereine avec un accompagnement par des proches pen-
dant l’acte et que des remerciements ont été adressés
au médecin.
Une surprise: 86% des déclarations sont rédigées
en néerlandais!
Les médecins francophones sont-ils plus réticents à répondre
favorablement à une demande d’euthanasie que leurs confrères
flamands? La population francophone est-elle moins encline à
demander la mort par euthanasie? Ou cette discordance est-elle
simplement due à une réticence des médecins francophones à
remplir le formulaire de déclaration? Ou plusieurs facteurs s’ad-
ditionnent-ils? Une analyse détaillée de cette discordance peut
être trouvée en annexe.
Aucune déclaration ne comportait d’éléments faisant douter du
respect des conditions de la loi et aucun dossier n’a donc été
transmis à la justice.
COMMENTAIRES
1) Les données recueillies par la Commission de contrôle
montrent que la loi a atteint son objectif qui était de permettre
une pratique correcte et contrôlable de l’euthanasie avec les
moyens les plus adéquats pour assurer une mort sans souf-
france. Une manière nouvelle de concevoir sa fin de vie est
entrée incontestablement peu à peu dans les mœurs. Cepen-
dant, l’euthanasie reste peu fréquente surtout en Communauté
française et on peut supposer que des demandes d’euthanasie,
même émanant de patients se trouvant dans des situations
médicales sans issue et entrant dans le cadre des conditions
légales, restent non honorées.
2) La loi a-t-elle supprimé la pratique de l’euthanasie clandestine
et non déclarée? En dehors de cas isolés, il est peu probable, en
raison de la nécessité d’une prescription dont l’intention létale
est évidente, que des médecins pratiquent, sans les déclarer, de
véritables euthanasies au sens propre du terme (acte provo-
quant intentionnellement la mort à la demande du patient).
Cependant, la comparaison des données recueillies en Flandre
et en Communauté française laisse supposer qu’en fin de vie,
l’utilisation, en lieu et place d’une euthanasie, de doses élevées
d’antalgiques et sédatifs pour accélérer le décès, reste fréquente
surtout en Communauté française3.
Références
1. Loi du 28 mai 2002 relative à l’euthanasie.
2. Commission fédérale de contrôle et d’évaluation de l’euthanasie.
Rapports aux Chambres législatives. www.health.fgov.be/euthanasie/fr
3. Englert, M. La pratique dépénalisée de l’euthanasie en Belgique:
évolution de 2002 à 2005 et interprétation des différences entre le nord
et le sud du pays. Rev MED Brux. Accepté pour publication 2007.
ANNEXE
Attitudes face au cancer en fin de vie
au nord et au sud du pays
Pour tenter de mieux cerner l’origine de l’importante différence
entre le nombre d’euthanasies déclarées en néerlandais et en
français, nous avions, dans un travail antérieur(1), comparé le
nombre de décès par euthanasie déclarée dans chacune des
deux langues en 2002-2003 proportionnellement aux chiffres
de mortalité en région flamande et en région wallonne pour les
deux diagnostics principaux concernés (le cancer et les affec-
tions neuromusculaires), qui totalisent à eux seuls plus de 90%
des déclarations. Les approximations utilisées ne permettaient
pas de conclusion ferme mais suggéraient que les médecins en
Communauté française pratiquaient proportionnellement un
nombre similaire d’euthanasies pour affection neuromusculaire
que leurs confrères flamands mais un nombre nettement moin-
dre pour cancer.
Nous avons repris la comparaison pour les euthanasies décla-
rées en 2004 et 2005 en l’étendant aux autres données essen-
tielles du rapport de la commission de contrôle et d’évaluation
(tableau ci-dessous).
NOMBRE DE DÉCLARATIONS EN FONCTION
DE LA LANGUE (2004-2005)
NL FR Rapport NL/FR
Nombre total Rapport
636 106 6
DEMANDE CONSCIENTE OU DÉCLARATION ANTICIPÉE
DEMANDE CONSCIENTE
624 105 5,9
DÉCLARATION ANTICIPÉE
12 1 12
ÉCHÉANCE PRÉVISIBLE DU DÉCÈS
ÉCHÉANCE BRÈVE
598 93 6,4
ÉCHÉANCE NON BRÈVE
38 13 2,9
DIAGNOSTICS
CANCERS
533 85 6,2
AFFECTIONS NEUROMUSCULAIRES
36 14 2,6
LIEU DE L
’
EUTHANASIE
DOMICILE
265 26 10,2
HÔPITAL
322 76 4,2
MAISON DE REPOS ET DE SOINS
34 3 11,3
UTILISATION DU THIOPENTAL POUR L
’
EUTHANASIE
541 87 6,2
Ce tableau permet les constations suivantes:
1. En Communauté française, l’euthanasie est moins fréquem-
ment pratiquée au domicile du patient qu’en Flandre.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%