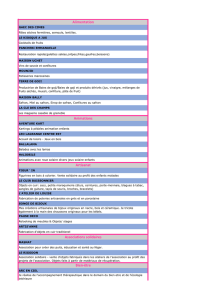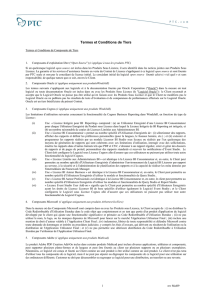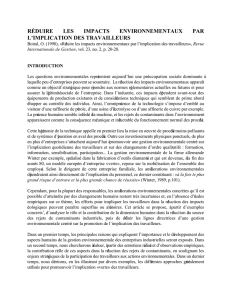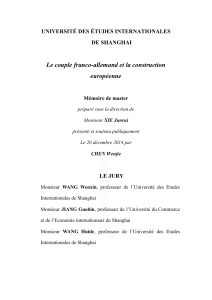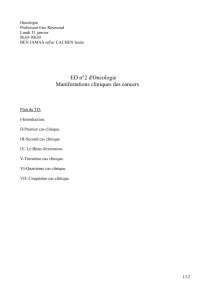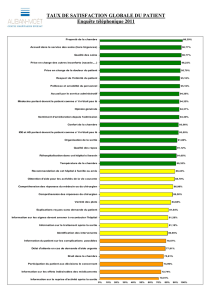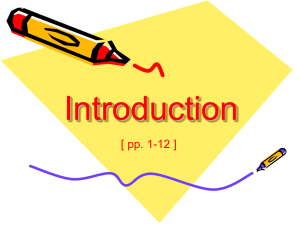Yves Lecomte - Un regard sur ce qui change

1
Laurence et Romain ont réussi àme mettre aujourd'hui dans une situation
difficile. J'avais en effet juré, lorsque j'ai pris ma retraite il y a maintenant plus de
cinq ans, de ne plus m'exprimer dans une réunion médicale. J'ai toujours cru -et je
le crois encore- qu'un chirurgien ne détient le droit de s'exprimer que de
l'enseignement qu'il tire de son activitéquotidienne, répétée, en salle d'opération.
En d'autres termes, je crois plus au discours du combattant qu'àcelui de l'ancien
combattant. J'ai essayé, pour préparer cet exposé, d'adopter le regard de l'historien
plutôt que celui du vieil acteur mais il est évident que l'historien a du puiser dans
l'expérience singulière de l'acteur de quoi alimenter sa réflexion. Exercice périlleux
dont je vais essayer de me tirer avec honnêteté…
Pour continuer àculpabiliser Laurence et Romain, je dois dire que je n'ai
pas très bien compris le sujet qu'ils voulaient me voir traiter : j'ai retenu de leur
propos le désir de savoir ce que je pensais ou ressentais de l'évolution de notre
pratique médicale. C'est ce que je vais essayer de faire.
Ce que je vais vous dire est sous-tendu par une idée simple : nous vivons,
vous vivez, depuis quelques années, la fin d'une époque de la médecine
occidentale. Rassurez-vous, je ne veux pas pleurer sur la disparition d'un monde
que j'ai connu et aimé. Quand je parle de fin d'unépoque, je pense au contraire
àtout ce qui est àimaginer, àconstruire, pour que la médecine garde sa place, son
sens et son efficacitédans un contexte en profonde mutation. Ce dont je voudrais
essayer de vous convaincre, c'est que cet avenir ne peut se construire sur des
fondements qui sont sinon en voie de disparition, du moins gravement fragilisés.
Je tiens àpréciser que, pendant tout cet exposé, j'utiliserai le terme de
"médecine" dans son acception de médecine de soin. Il existe bien d'autres types de
pratique respectables et utiles mais je n'en parlerai pas.
J'ai vécu toute ma carrière sans jamais me poser la question du but de
mon activité. L'aurais-je fait que la réponse aurait étéévidente et d'une grande
banalité: j'étais une personne, détentrice d'un savoir et d'une compétence, ayant la
charge, le devoir si vous voulez, de mettre celles-ci àla disposition d'une autre
personne, requérant mon aide dans l'analyse, le pronostic et le traitement de ce

2
qu'il ressentait comme un mal, une maladie. Ce cadre traditionnel de la médecine
occidentale s'appelle, dans le jargon des textes français traitant de ce sujet, le
colloque singulier. Il privilégie un rapport interpersonnel entre médecin et patient,
"la rencontre d'une confiance et d'une conscience" pour reprendre une expression
célèbre. Je vous avoue volontiers que je me suis senti àl'aise dans ce cadre
traditionnel. J'y ai trouvé, comme tant d'autres, une manière simple, peut-être
simpliste, de donner un sens et une orientation aux divers aspects de mon activité.
Le but était de répondre le mieux possible àune demande, explicite ou implicite.
Bien sûr, cette demande est souvent complexe, exige réflexion et analyse, elle n'est
jamais parfaitement satisfaite et, du fait même de cette imperfection, elle est la
référence exclusive de la critique que le médecin fait de son action, de ses résultats
et des techniques qu'il emploie. C'est l'incapacitéàrépondre correctement àla
demande du patient qui était, jusqu'àmaintenant, le principal moteur de progrès. Je
sais, bien sûr, que ce primat de la personne n'est pas universel. Je ne parle pas ici
de pays pratiquant des médecines traditionnelles non occidentales mais de pays de
traditions plus proches de la nôtre. Par exemple, le premier code de l'American
Medical Association affirmait, en 1847 : "le premier objectif de la profession
médicale est de rendre service àl'humanité, en respectant pleinement la dignitéde
l'homme et les droits des patients". C'est un monde de différence avec notre
tradition ! Il me semble cependant qu'il persiste, en France, un attachement profond
àce type de relation médecin/patient. J'en veux pour preuve l'affirmation répétée
par le code de déontologie, dans ses versions les plus récentes, du primat de cette
relation. Et pour illustration, une anecdote survenue pendant que je préparais cet
exposé. J'ai opéré, il y a une dizaine d'années, la petite fille d'un des plus célèbres
réalisateurs français de cinéma. Je l'avais, àcette occasion, rencontréquelques
minutes, pendant lesquelles il m'avait paru àla fois indifférent et distant. A ma
grande surprise, il vient de publier, dans une rubrique de Paris-Match, un article
déclarant que cette rencontre avait étéun des évènements les plus importants de sa
vie. Bel exemple de l'attachement àl'image, au mythe si vous voulez, du "bon
docteur" !

3
Pourtant, cette conception traditionnelle de la médecine est sinon
menacée d'extinction du moins fortement érodée par les changements de tous
ordres que vit notre société. C'est de cette érosion, àlaquelle j'ai assistétout au long
de ma carrière que je vais essayer de vous parler parce qu'elle me semble arriver
àson terme et annoncer des changements profonds de la finalitémême de notre
activité. Cette évolution est liée àde multiples facteurs. Je vous propose de nous
arrêter sur cinq d'entre eux :
-la vulgarisation des connaissances
-l' encadrement collectif des connaissances et des décisions
-la primautéde l'économique
-la multiplication et l'autonomisation des techniques
-la naissance et le développement d'une médecine anténatale
Vulgarisation des connaissances.
Le savoir spécifique du médecin était la base de sa relation traditionnelle
avec le patient : c'est parce que ce dernier savait ne pas savoir qu'il avait recours au
médecin. S'établissait, sur cette base, un contrat moral qui, en termes vulgaires,
pouvait s'exprimer ainsi : le patient accordait sa confiance àcelui qui savait, ce
dernier ayant comme devoir de faire ce qu'il savait faire sans profiter de la
situation.
Les outils modernes qui permettent un accès généralisé, facile et rapide
àla connaissance fragilisent évidemment cet équilibre. Je pense bien sûr àl'internet.
Vous savez, mieux que moi maintenant, que le patient ou sa famille préparent
généralement avant même le premier entretien leur bagage de connaissances pour
les confronter avec ce que leur dira le médecin. Très souvent, ils auront consultédes
sites d'associations, de réseaux sociaux sur lesquels ils auront cherchédes cas
analogues au leur. Le rapport médecin-malade est donc fondéaujourd'hui sur la
confrontation de deux savoirs. Cette nouvelle distribution des cartes a sans doute
l'avantage de mettre fin aux abus, si souvent dénoncés et raillés dans la littérature,

4
que se permettaient les médecins àl'abri d'un savoir réel ou supposé. Elle n'en
facilite pas pour autant l'harmonie de la nouvelle relation et ce pour deux raisons.
La première est l'impossibilitépour le patient ou sa famille de trier, dans le flot des
connaissances auxquelles il accède, ce qui fait la spécificitéde son cas. Le discours
du médecin, fondéjustement sur ce qui fait que le patient est unique, est souvent
dé-crédibilisépar des données concernant des groupes hétérogènes, voire sans
rapport réel avec ce patient. La seconde difficultéest plus subtile. L'accès facile aux
informations favorise l'illusion que la charge d'angoisse qui accompagne la maladie
peut être effacée par la connaissance technique. On voit ainsi certains patients,
certaines familles poursuivre une course folle au recueil d'informations, par
l'internet, par la multiplication des consultations, des demandes d'avis, sans se
résoudre àaffronter la réalitéde la maladie et finalement àprendre leur part,
essentielle, de la prise en charge efficace de cette maladie. Trop souvent, la
vulgarisation des connaissances rend plus difficile la confiance dans le médecin
dont le malade a besoin.
Organisation d'un encadrement collectif des connaissances et des
décisions
Nous avons assisté, depuis quelques années, àla construction de tout un
système d'encadrement collectif des connaissances et des pratiques : haute autorité,
commissions, sociétés savantes, académies, conférences de consensus, rivalisent de
rapports, d'analyses d'experts, pour élaborer une véritéofficielle, une bonne
conduite officielle pudiquement appelée "recommandations". J'ai senti, lors de mes
dernières années d'exercice, s'accélérer ce passage d'une activitédictée par un savoir
et une interprétation individuels -avec tous les risques que cela comportait- àune
activitébalisée jusque dans ses moindres détails par des normes collectives. Ces
normes, au fil des années, ont infiltrél'ensemble de nos activités, du nettoyage des
locaux àl'élaboration des stratégies chirurgicales. L'image qui me vient àl'esprit est
celle de nos panseuses, attentives àne pas perdre les dizaines d'étiquettes qu'elles se

5
collaient sur leur veste de pyjama avant de les recoller sur une fiche du dossier
pour respecter les normes de traçabilitédu matériel, jusqu'àla moindre compresse.
Elles étaient si attentives àces étiquettes que les moins douées d'entre elles
devenaient inattentives àl'opération et donc dangereuses. Je lisais il y a quelques
jours un rapport d'expertise judiciaire qui, àpropos d'un accident chirurgical
mortel, se référait, de la première àla dernière ligne, àla conformitéaux
recommandations sans, une seule fois, exprimer un avis personnel. Je connaissais
ce cas et les circonstances de l'accident, manifestement duàla non-assistance d'un
jeune chirurgien par un aînéplus compétent. Je ne suis pas sûr que ce malade sera
content d'être mort en conformitéavec les recommandations. Le bien-fondéd'un
acte médical, son exécution, son jugement en cas d'échec reposent de moins en
moins sur une appréciation individuelle, de plus en plus sur le respect d'un
règlement.
On comprend bien les motifs de cette dérive : éviter au patient les risques
auxquels l'exposeraient l'ignorance, la paresse, la téméritéou d'autres défauts de
son médecin. A cela s'ajoutent, nous y reviendrons, les préoccupations
économiques de la collectivité: l'édiction de normes empêche le médecin de
dépenser sans compter. Cependant, on voit bien àquel point cet encadrement
collectif du savoir et de la décision change la nature même de la relation
médecin/malade, l'ampute, en même temps que de ses risques, d'une bonne partie
de sa richesse et de son efficacité. Je suis absolument certain, pour prendre
l'exemple de la chirurgie des cardiopathies congénitales, que, dans le contexte
actuel, aucun des progrès majeurs auxquels j'ai assistén'aurait étépossible. Au fil
des ans, j'ai vu des techniques mises au point par quelques individus, sous le
regard critique ou hostile de la majorité, devenir l'objet d'un consensus. C'est dans
la fin des années 80 que sont nés le concept et l'appellation
d'evidencebasedmedicine, qui est le fondement même de tout cet encadrement
collectif de la médecine àprétention scientifique. On ne peut nier l'intérêt de cette
EBM lorsqu'elle est utilisée comme garde-fou. En d'autres termes, c'est un excellent
outil pour savoir ce qu'il ne faut pas faire, àcondition toutefois de ne pas faire dire
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
1
/
15
100%