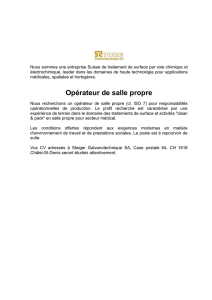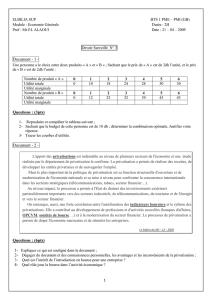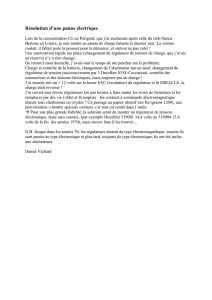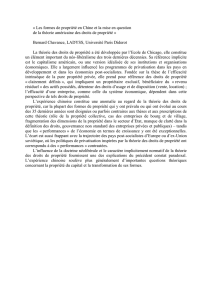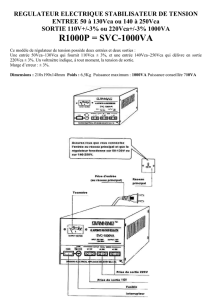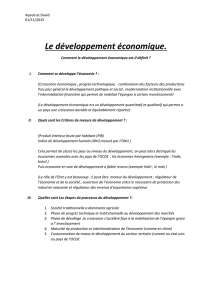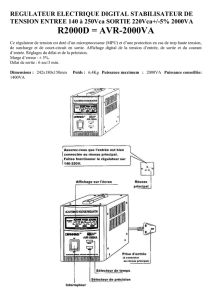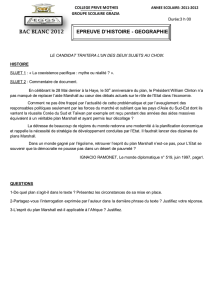Pour une réinvention écologique de l`initiative économique

POUR UNE
REINVENTION
ECOLOGIQUE DE
L’INITIATIVE
ECONOMIQUE
PUBLIQUE
Edgar Szoc, coordinateur de la prospective à Etopia
Octobre 2011
www.etopia.be

111111
Page 1 sur 3
La crise nous invite à repenser le rôle de l’intervention publique dans l’économie. Alors
qu’elle nous proposait de remplacer l’État entrepreneur/opérateur par l’État régulateur,
la vague de libéralisation et de privatisation des années 80 et 90 a d’abord réduit la
capacité de l’État à jouer efficacement son rôle de régulateur. La crise du néo-libéralisme
et du productivisme doit dès lors nous inciter à effectuer un bilan de ce mouvement et à
penser à nouveaux frais le rôle de l’État dans l’économie. Le sauvetage public des
banques privées tout comme la réorientation globale de l’économie dans un sens
écologique nous y contraignent. Mais cette réinvention ne peut se solder par un retour
en arrière et par la relance de l’initiative économique publique dans un cadre national,
telle qu’elle avait été promue au cours des Trente glorieuses. Celle-ci a en effet montré
ses limites tant sur le plan social qu’écologique et démocratique.
Depuis l’éclatement de la bulle immobilière et la crise financière consécutive – dont les
innovations financières étaient censées nous protéger – se sont multipliés les appels,
demeurés essentiellement incantatoires à ce jour, à la régulation d’une série de secteurs
économiques. Sans évidemment renoncer à ce louable objectif, près de trois années de
quasi paralysie en la matière devraient toutefois amener à s’interroger sur les vertus
apparemment très peu productives de ces appels.
L’hypothèse ici formulée est que, dans une série de domaines desquels l’État s’est
progressivement désengagé au cours des dernières décennies sous les coups de butoir
conjoints du New Public Management, des contraintes budgétaires liées à l’entrée dans
l’Euro et de la concurrence des territoires induites par la mondialisation, cette disparition
de l’État comme opérateur a très fortement obéré ses capacités à agir comme un régulateur
efficace et juste, notamment parce qu’il l’a privé des informations économiques que lui
fournissait les entreprises publiques. Ce désengagement de l’État comme producteur l’a
rendu particulièrement vulnérable aux lobbies les mieux organisés – et par conséquent les
mieux financés. La malheureuse saga de l’enlisement de la régulation financière en atteste
de manière presque caricaturale.
Avoir l’ambition de donner à l’État les moyens de jouer un rôle de régulation en matière
économique nécessite de repenser cette division conceptuelle, qui n’est qu’apparemment
évidente, entre État régulateur, d’une part et État opérateur et producteur, d’autre part.
Renoncer à cet élément central du New Public Management et à sa foi dans l’efficacité
intrinsèque des marchés et de l’initiative privée implique de repenser à nouveaux frais le
rôle des politiques publiques, et notamment l’importance de l’État opérateur comme outil
public de connaissance de l’économie.
Ce retour de l’État opérateur, pour des raisons a minima cognitives, c’est-à-dire de
connaissance sur les domaines d’activité qu’il entend continuer – ou plutôt recommencer –
à réguler nécessitera des adaptations massives des outils législatifs – mais aussi des
routines de pensée – qui ont accompagné et scellé la victoire du néolibéralisme. Ce travail
d’ampleur à mener sur des fronts nombreux n’a malheureusement pas été préparé. En
effet, alors même qu’ils claironnaient leur foi dans l’économie de la connaissance, les
thuriféraires de la pensée néolibérale se montraient incapables de prendre acte des
conséquences particulièrement préjudiciables du mouvement d’enclosure (de
privatisation ?) dont cette connaissance était l’objet. Logés au cœur même des secteurs que
les autorités politiques entendent (re)réguler, le savoir et l’expertise pratique
indispensables à une régulation juste et efficace font désormais cruellement défaut à la
puissance publique qui s’est en quelque sorte auto-amputée.

222222
Page 2 sur 3
À cet égard, les conditions dans lesquelles les États européens décideront de recapitaliser
les banques, et notamment l’implication publique dans le management en vue de réduire
l’asymétrie informationnelle entre régulateurs et régulé, constituera un indicateur de la
prise de conscience par les États de leur impuissance informationnelle, et de leur volonté
d’y remédier.
La souveraineté politique s’est progressivement vidée de son sens par un double
mouvement articulé, interne et externe, de privatisation/dérégulation d’une part, de
globalisation de l’autre : c’est donc uniquement en combattant sur ce double front, que
pourra se matérialiser la possibilité d’un réencastrement et d’une domestication du
capitalisme. Plaider en faveur d’une simple re-régulation dans le cadre juridique actuel -
dont le fronton est gravé des lettres dorées de la « concurrence non faussée » - ne pourra,
du fait même de l’impuissance même de ce plaidoyer, qu’aggraver encore le
désenchantement politique initié par la perte de souveraineté.
D’autres arguments, tout aussi urgents, plaident également en faveur d’une réactivation
massive de l’intervention publique en matière économique. L’imposera par exemple la
réorientation écologique de l’économie ainsi que la planification qu’elle nécessitera, du
moins si on ne s’aveugle pas sur la myopie d’agents prétendument rationnels. Mais aussi la
tertiarisation croissante et le développement des services à la personne, qui induisent un
accroissement systématique de l’asymétrie d’information entre producteurs et
consommateurs.
Mais le plaidoyer en faveur d’un retour en force de l’intervention publique en matière
économique, comme opérateur et plus uniquement régulateur, ne doit pas dispenser d’une
réflexion sereine sur les limites du compromis keynésien réalisé dans le cadre de ce
qu’Etienne Balibar a nommé l’État social national, et dès lors sur le caractère non seulement
illusoire, mais également peu souhaitable de sa restauration à l’identique. Le prétendu
miracle de l’initiative économique publique des Trente Glorieuses s’est fait aussi sur le dos
des peuples du Sud et de l’environnement.
De même, si la logique de démantèlement ou la privatisation des services publics a pu se
mener sans être enrayée par une résistance particulièrement forte, c’est que leurs modes de
fonctionnement avaient pu se trouver pervertis et entravés par des logiques corporatistes
et particratiques, aussi opaques qu’autocentrées et fermées à l’implication citoyenne.
Recréer un consensus social autour de la nécessité d’une fourniture publique, ou au moins
collective, d’une série de biens et services passe donc également par une réflexion en
profondeur sur les modes d’organisation, et en particulier la prise en compte et la
participation des usagers et sur le renforcement de la démocratie économique dans les
entreprises publiques comme dans les services publics.
La prise en compte de l’ensemble de ces contraintes – et opportunités se doit-on de dire
pour ne pas désespérer Billancourt – apparaît primordiale pour éviter que le retour de
l’État en matière économique ne constitue que l’avatar ultime de sa commercialisation.
Jusqu’à présent en effet, tous les pays qui sont intervenus à grands frais pour empêcher
l’effondrement systémique de leurs banques l’ont fait sans projet, vision, ni d’ailleurs
envie, avec comme seul horizon d’éviter le pire, et comme scénario optimiste, le retour au
statu quo ante.

333333
Page 3 sur 3
Ce qui peut apparaître prima facie comme le retour d’une initiative publique forte sur le
plan économique ne signe dans les faits, à l’heure actuelle au moins, que l’intégration
absolue des contraintes économiques et financières privées dans les logiques d’action
publique. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la reculade du gouvernement
britannique de Gordon Brown lorsqu’il a été question de surtaxer les bonus de la City :
cette taxe a été appliquée un an puis suspendue aux milieux des cris d’orfraie. Et encore,
cette courbe rentrante fait-elle figure de geste particulièrement audacieux en regard de ce
qui (ne) fut (pas) tenté ailleurs. Utiliser le terme de nationalisation pour évoquer un
sauvetage qui ne conduit même pas à modifier les structures de rémunération et
d’incitants les plus universellement décriées relève plutôt de la mauvaise plaisanterie que
de l’analyse politologique. Plus qu’à une forme quelconque d’étatisation de l’économie,
c’est donc bien à une forme de privatisation financière des logiques d’État que les citoyens
ont assisté impuissants. Il y a fort à parier qu’il continuera à en être ainsi tant qu’une
description positive et articulée du rôle de l’État en matière économique ne sera pas
substituée à la vulgate moribonde qui continue, depuis le cimetière des idées, à orienter les
pensées et les actions des « décideurs » européens.
1
/
4
100%