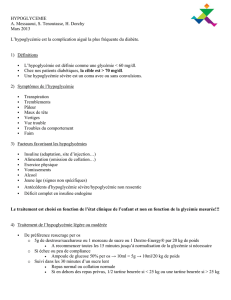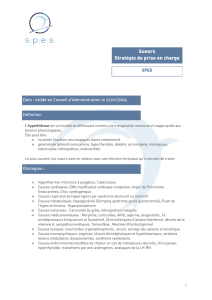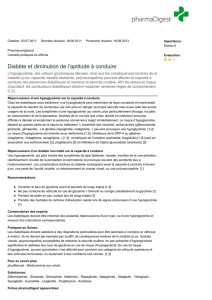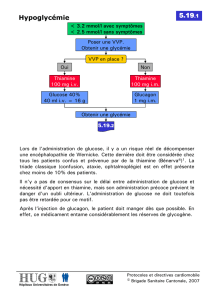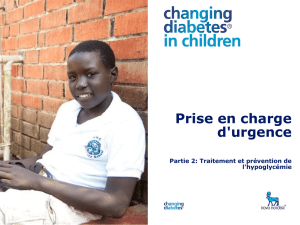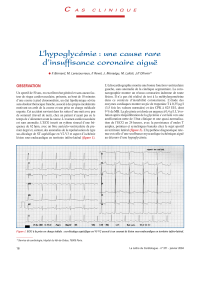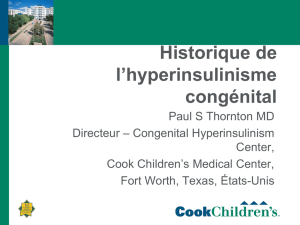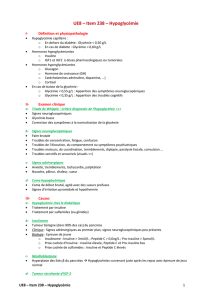Suspicion d`hypoglycémie chez l`adulte non diabétique

Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte
non diabétique
A. Hartemann-Heurtier
Le diagnostic d’hypoglycémie est souvent évoqué par le patient lui-même, à l’occasion de malaises, mais
cette hypoglycémie correspond en fait très rarement à une authentique hypoglycémie organique. Cette
dernière doit être suspectée en présence soit d’un contexte favorisant (insuffisance surrénale, cachexie,
sujet âgé polypathologique, etc.), soit de signes de neuroglycopénie évoquant un insulinome. Pour arriver
à ce diagnostic extrêmement rare, il faut d’abord prouver l’existence d’une insulinémie anormalement
élevée en présence d’une glycémie basse, lors d’une épreuve de jeûne en milieu hospitalier.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
Mots clés : Hypoglycémie ; Iatrogénie ; Insulinome ; Postprandiale ; Sulfamides hypoglycémiants
Plan
¶Introduction 1
¶Temps primordial de l’interrogatoire 1
Quels sont les symptômes rapportés ? 1
Comment sont rapportés les symptômes ? 2
Circonstances de survenue des symptômes 2
Contexte 2
¶Hypoglycémie non organique ou syndrome idiopathique
postprandial 2
¶Éliminer les hypoglycémies organiques de cause évidente 2
Hypoglycémies médicamenteuses et toxiques 2
Hypoglycémies d’origine endocrinienne 2
Hypoglycémies tumorales extrapancréatiques 3
¶Devant une hypoglycémie organique sans cause apparente :
épreuve de jeûne 3
Épreuve de jeûne 3
¶Conclusion 3
■Introduction
On se trouve rarement confronté, en pratique, à la triade de
Whipple (hypoglycémie inférieure à 0,50 g/l, associée à des
symptômes typiques et calmée par la prise de sucre) qui permet
de déclencher les examens complémentaires nécessaires à
l’enquête étiologique. Bien plus fréquemment, les patients
consultent pour des malaises ou bien avec déjà un autodiagnos-
tic : « Je fais de l’hypoglycémie ». Or, ce que l’on appelait
antérieurement « l’hypoglycémie réactive » doit être actuelle-
ment intégrée dans un tableau clinique plus vaste de « syn-
drome postprandial idiopathique ». En effet, la diminution de la
glycémie après un repas est, d’une part rarement constatée chez
les patients se plaignant de malaises postprandiaux, d’autre part
un phénomène physiologique ! Il faut donc, en pratique,
rassembler le maximum d’arguments cliniques pour ne pas
passer à côté d’une rare hypoglycémie organique, et une fois ce
diagnostic récusé, ne surtout pas négliger la plainte du patient
dont la souffrance, même si on la comprend mal sur le plan
physiopathologique, est réelle. L’interrogatoire est le temps
primordial de l’enquête pour distinguer ce qui est le plus
fréquent, à savoir un « syndrome postprandial idiopathique » et
qui nécessite une prise en charge thérapeutique sans aucun
bilan, de ce qui est très rarement une « hypoglycémie organi-
que ». L’interrogatoire permet d’avoir, dans la plupart des cas,
une première orientation diagnostique, évitant la multiplication
d’explorations complémentaires inutiles, et inversement, mais
très rarement, incitant à la recherche acharnée d’une tumeur
insulinosécrétrice en cas de suspicion d’hypoglycémie organique
sans cause évidente.
■Temps primordial
de l’interrogatoire
Quels sont les symptômes rapportés ?
Les symptômes de l’hypoglycémie sont de deux types
[1]
:
• les symptômes neurovégétatifs liés à la stimulation du
système nerveux autonome et survenant pour un seuil
glycémique aux alentours de 0,60 g/l mais qui pourrait être
variable selon les sujets ;
• les symptômes liés à la souffrance du système nerveux
central, dits neuroglycopéniques, survenant pour un seuil
glycémique inférieur à 0,50 g/l.
Les manifestations neurovégétatives sont secondaires à la
réponse hypothalamo-hypophyso-surrénalienne à l’hypoglycé-
mie, avec stimulation adrénergique et cholinergique. Les plus
fréquentes sont : mains moites, tremblements des extrémités,
pâleur du visage et des extrémités, anxiété, tachycardie, nervo-
sité, sensation de faim intense, sueurs diffuses. Plus rarement :
troubles du rythme, nausées, voire vomissements, crise d’angor
chez les patients coronariens.
Le type de symptômes rapporté par le patient lors de l’inter-
rogatoire est capital : la présence de manifestations neuroglyco-
péniques sévères traduisant une glycémie inférieure à 0,5 g/l
(troubles psychiatriques, troubles neurologiques déficitaires,
crise convulsive) est fortement évocatrice d’hypoglycémie
organique. Inversement, des symptômes neurovégétatifs isolés
ou associés à des symptômes neurologiques mineurs (sensation
¶1-1340
1Traité de Médecine Akos
þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

de malaise, vertige, céphalées) sont en faveur d’une hypoglycé-
mie réactive ou d’un syndrome postprandial idiopathique.
Enfin, la présence de symptômes non liés à l’hypoglycémie
(bouffées de chaleur, diarrhée, douleurs coliques en barre, soif
d’air, polypnée, bradycardie) permet de remettre en question le
diagnostic.
Les manifestations neuroglycopéniques proviennent essen-
tiellement de la souffrance du cortex cérébral et du cervelet, et
apparaissent pour un seuil glycémique plus bas. Elles peuvent se
traduire par :
• sensation de malaise avec asthénie ;
• difficulté de concentration, céphalées ;
• vue trouble ;
• paresthésies des extrémités ;
• troubles psychiatriques avec changement de comportement,
de l’humeur, confusion, agitation, état pseudoébrieux,
hallucinations, etc ;
• symptômes déficitaires neurologiques avec troubles moteurs,
diplopie, aphasie, crises convulsives localisées ou généralisées,
troubles de la conscience jusqu’au coma.
Il faut savoir que des épisodes d’hypoglycémie sévère répétés
(hypoglycémie organique) conduisent à un abaissement du seuil
glycémique de stimulation du système nerveux autonome. Les
manifestations neuroglycopéniques sont alors isolées, ou
peuvent précéder les symptômes neurovégétatifs qui perdent
leur valeur d’alerte. Il faut donc penser au diagnostic d’hypo-
glycémie organique, même en l’absence de symptômes
neurovégétatifs.
Comment sont rapportés les symptômes ?
Le syndrome confusionnel qu’entraîne la souffrance neuro-
glycopénique ne s’observe que lors d’une hypoglycémie organi-
que. Il est alors responsable d’une difficulté, pour le patient, à
décrire précisément ses troubles. Le patient peut même parfois
avoir du mal à se souvenir des circonstances déclenchantes du
malaise ou du mode résolutif de celui-ci : il raconte mal son
histoire. Le recours à un tiers peut être nécessaire lors de
l’interrogatoire. Ce n’est pas le cas lors des « syndromes
postprandiaux ». Ceux-ci sont décrits dans le détail par les
patients eux-mêmes, avec une certaine richesse symptomatique,
et leur progression chronologique facilement récapitulée.
Circonstances de survenue des symptômes
Les manifestations cliniques d’hypoglycémie survenant à jeun
le matin ou à distance d’un repas (plus de 5 h après) et/ou lors
d’un effort physique sont en faveur du caractère organique de
l’hypoglycémie. Les symptômes cèdent rapidement à la prise de
sucre rapide. Le patient ne peut pas se permettre de sauter un
repas et prévient les malaises avec des collations, entraînant
souvent mais pas toujours une prise de poids.
Inversement, les malaises étiquetés « hypoglycémie réactive »
surviennent2à3heures après un repas, et ne sont pas forcé-
ment calmés par la prise de sucre rapide. L’évolution pondérale
est variable.
Mais dans la mesure où l’insulinome reste sensible aux
stimuli physiologiques de la cellule bêta, une véritable hypogly-
cémie organique peut aussi se manifester après un repas.
Contexte
L’interrogatoire doit aussi préciser :
• s’il existe des arguments en faveur d’une pathologie orga-
nique responsable d’hypoglycémie : endocrinopathie
(insuffisance surrénale, insuffisance antéhypophysaire,
hypothyroïdie), insuffisance hépatocellulaire, syndrome
tumoral, alcoolisme, etc. ;
• si le patient prend des médicaments qui peuvent entraîner
une hypoglycémie ;
• si le patient a, dans son entourage, un diabétique (hypogly-
cémie factice à l’insuline ou aux sulfamides hypoglycé-
miants) ;
• s’il a des antécédents de pathologie auto-immune.
■Hypoglycémie non organique
ou syndrome idiopathique
postprandial
Les symptômes postprandiaux, s’ils sont bien réels, sont en
fait rarement contemporains d’hypoglycémie et s’intègrent dans
un tableau non encore compris de syndrome postprandial
(hypersécrétion d’hormones gastro-intestinales, hypotension
postprandiale ?). La diminution de la glycémie après ingestion
de glucose en dessous du niveau mesuré à jeun est un fait
physiologique, connu depuis longtemps, et peut s’observer chez
les patients présentant des symptômes postprandiaux, mais
aussi chez les sujets normaux
[2]
. L’existence d’une glycémie
basse dans les temps tardifs d’une hyperglycémie provoquée par
voie orale n’a donc aucune spécificité et ne s’accompagne pas,
le plus souvent, de malaise chez les patients souffrant de
symptômes postprandiaux
[3]
. Il ne semble donc plus souhaita-
ble de demander une hyperglycémie provoquée par voie orale
sur 5 heures, source de faux positifs
[4]
, et inversement ne
permettant pas d’infirmer un syndrome postprandial idiopathi-
que. Seule la mesure de la glycémie au moment d’un malaise
(ou après un repas riche en sucre rapide) peut avoir un intérêt :
le plus fréquemment, elle confirme l’absence d’hypoglycémie
organique en cas de normalité ; très rarement, elle peut montrer
l’existence d’une réelle hypoglycémie réactive en cas de glycé-
mie inférieure à 0,5 g/l. En cas de doute avec une hypoglycémie
organique, on envisage alors une épreuve de jeûne (cf. infra).
Finalement, le plus important est de suivre l’évolution des
malaises (caractéristiques, fréquence) après une prise en charge
adaptée aux plaintes des patients, le traitement n’étant pas pour
l’instant clairement défini. Après avoir éliminé, par un interro-
gatoire approfondi, un malaise vagal, un syndrome d’hyperven-
tilation, une attaque de panique, on peut proposer : des mesures
diététiques (fractionnement des repas, diminution de l’apport
en sucre rapide, augmentation de l’apport en sucre lent et en
fibres au cours des repas, suppression de l’alcool), éventuelle-
ment un traitement par bêtabloquants, permettant la diminu-
tion des symptômes neurovégétatifs par anxiolytiques, ou
inhibiteur de l’alphaglucosidase
[5]
. On ne connaît pas l’effica-
cité réelle de ces mesures qui comportent certainement une
grande part d’effet placebo. Cette prise en charge non spéciali-
sée, reposant essentiellement sur une écoute réelle des plaintes
des patients et leur prise en compte, peut être effectuée par le
médecin généraliste.
■Éliminer les hypoglycémies
organiques de cause évidente
En cas de suspicion d’hypoglycémie organique, il convient
d’éliminer un certain nombre de diagnostics étiologiques, avant
d’avoir recours à l’épreuve de jeûne et à des investigations plus
poussées.
Hypoglycémies médicamenteuses
et toxiques
De nombreux médicaments (en dehors des médicaments
hypoglycémiants) peuvent être responsables d’hypoglycémie par
des mécanismes variés
[6, 7]
(Tableau 1). Mais tous ces médica-
ments voient leur potentialité à déclencher une hypoglycémie
augmenter sur un terrain facilitant : surtout insuffisance rénale,
dénutrition ou cachexie, diarrhée prolongée, infection sévère,
polypharmacothérapie, insuffisance surrénale latente, etc.
L’alcool, enfin, est bien connu comme pouvant entraîner une
hypoglycémie, en inhibant la néoglycogenèse hépatique chez
un sujet dénutri, à jeun, ou en potentialisant l’effet de médica-
ments hypoglycémiants.
Hypoglycémies d’origine endocrinienne
L’hypoglycémie fait partie de la symptomatologie de l’insuf-
fisance surrénalienne primitive ou corticotrope, de l’insuffisance
antéhypophysaire, de l’hypothyroïdie. Au moindre doute, il est
donc justifié de demander un test au Synacthène
®
immédiat, un
1-1340
¶
Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique
2Traité de Médecine Akos
þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

dosage de T
4
libre et de thyroid stimulating hormone (TSH), ou
des tests de stimulation hypophysaire. Ces dosages sont à
demander, uniquement en cas de suspicion clinique, dans un
laboratoire spécialisé, au mieux sous le contrôle de l’endocrino-
logue qui prend en charge le patient en cas de résultats positifs.
Hypoglycémies tumorales
extrapancréatiques
Leur diagnostic repose sur la découverte d’une tumeur
volumineuse, parlante cliniquement, associée à des malaises
fréquents et graves.
■Devant une hypoglycémie
organique sans cause apparente :
épreuve de jeûne
Épreuve de jeûne
Lorsque l’interrogatoire, l’examen clinique et les examens
biologiques simples font suspecter une hypoglycémie organique
mais ne permettent pas d’en préciser la cause, la recherche d’un
insulinome devient impérative. Dans un premier temps, il faut
démontrer l’existence d’une sécrétion inappropriée d’insuline
lors d’une hypoglycémie. On peut répéter les dosages de
glycémie et d’insulinémie à jeun et au cours de la journée. Les
résultats sont à interpréter en fonction des techniques de dosage
utilisées. Si l’on détecte une insulinémie supérieure à 6 µU/ml
(36 pM/l) en radio-immunosorbent assay (RIA) (dont la limite
inférieure de détection est de 5 µU/ml) pour une glycémie
inférieure à 0,40 g/l, le diagnostic de sécrétion inappropriée
d’insuline peut être affirmé. Mais, dans la plupart des cas, ces
dosages sont insuffisants, et l’on a recours à l’épreuve de jeûne.
Celle-ci dure 72 heures et doit se dérouler en service spécialisé
hospitalier, dans des conditions standardisées. Les dosages
effectués permettent de conclure à la présence d’un insulinome
en cas de sécrétion d’insuline inadaptée à l’hypoglycémie
[8, 9]
,
associée à un taux non freiné de peptide C.
L’hospitalisation permet d’éliminer les diagnostics différen-
tiels rares de l’insulinome : les hypoglycémies factices (injection
d’insuline exogène ou prise de sulfamides hypoglycémiants), les
hypoglycémies auto-immunes.
Une fois le diagnostic d’insulinome posé, différentes techni-
ques servent à sa localisation (échoendoscopie préopératoire,
cathétérisme portal, éventuellement injection intra-artérielle de
calcium)
[10, 11]
. La prise en charge thérapeutique sera menée par
des équipes spécialisées.
■Conclusion
Finalement, l’interrogatoire permet d’aboutir à trois conclu-
sions (Fig. 1).
• Il n’y a pas d’argument à l’interrogatoire pour une hypogly-
cémie organique. Aucun bilan n’est nécessaire. Le plus
important, mais le moins bien codifié, est le traitement de
cette « pathologie » dite « fonctionnelle ». Pourtant, lorsque la
prise en charge est adaptée, l’évolution des troubles vers une
raréfaction et/ou une modification symptomatologique des
Tableau 1.
Médicaments hypoglycémiants.
– Sulfamides hypoglycémiants, insuline
– Disopyramide (Rythmodan
®
), cibenzoline (Cipralan
®
)
– Dextropropoxyphène (Di-Antalvic
®
, Propofan
®
)
– Antidépresseurs (fluoxétine, IMAO)
– Pentamidine (Lomidine
®
), cotrimoxazole (Bactrim
®
)
– Perhexiline (Pexid
®
)
– Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (captopril, énalapril)
– Aspirine à forte dose
– Dérivés de la quinine
IMAO : inhibiteurs de la monoamine oxydase.
Interrogatoire et examen clinique
Pas de médicaments hypoglycémiants
Pas d'endocrinopathie
Examen clinique normal
Description aisée des malaises
Horaire postprandial
Pas de symptômes neuroglycopéniques
Médicaments hypoglycémiants
arrêt
Endocrinopathie clinique
test au Synacthène® immédiat
T4, TSH
Insuffisance hépathique grave
Alcoolisme
Contexte auto-immun
Ac anti-insuline et antirécepteur
de l'insuline
Syndrome tumoral
Pas d'arguments pour une origine
organique
Pas de bilan
Suivi de l'évolution :
diminution de la fréquence et
modification de la symptomatologie
des malaises
Description malaisée
À jeun ou après effort
Symptômes neuroglycopéniques
Correction rapide par le sucre
Suspicion d'insulinome
Hospitalisation pour
épreuve de jeûne
1) Prise en charge diététique
+ psychologique + médicaments
2) Ordonnance pour glycémie
lors d'un malaise, en postprandial tardif
Figure 1. Arbre décisionnel. Conduite à tenir devant une suspicion d’hypoglycémie. TSH : thyroid stimulating hormone ; Ac : Anticorps ; T
4
: thyroxine ou
tétra-iodothyronine.
Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique
¶
1-1340
3Traité de Médecine Akos
þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.

malaises permet de confirmer l’absence d’hypoglycémie
organique. En cas de persistance, voire d’aggravation des
malaises, associée à une hypoglycémie biologique constatée
au moment d’un malaise, il faut recourir à l’épreuve de jeûne.
• Il y a des arguments cliniques en faveur d’une insuffisance
surrénalienne, ou d’une hypothyroïdie, que l’on confirme
biologiquement. Il y a des médicaments favorisant l’hypogly-
cémie que l’on peut arrêter.
• Il y a une suspicion d’hypoglycémie organique sans cause
évidente : il faut confirmer le diagnostic par une épreuve
de jeûne en hospitalisation avant de poursuivre les
investigations.
■Références
[1] Mitrakou A, Ryan C, Veneman T, Mokan M, Jenssen T, Kiss I, et al.
Hierarchy of glycemic thresholds for counterregulatory hormone
secretion,symptoms,andcerebraldysfunction.AmJPhysiol1991;260:
E67-E74.
[2] Palardy J, Havrankova J, Lepage R, Matte R, Bélanger R, D’Amour P,
et al. Blood glucose measurements during symptomatic episodes in
patients with suspected postprandial hypoglycemia. N Engl J Med
1989;321:1421-5.
[3] Charles MA, Hofeldt F, Shackelford A, Waldeck N, Dodson Jr. LE,
Bunker D, et al. Comparison of oral glucose tolerance tests and mixed
meals in patients with apparent idiopathic postabsorptive
hypoglycemia: absence of hypoglycemia after meals. Diabetes 1981;
30:465-70.
[4] Johnson DD, Dorr KE, Swenson WM, Service FJ. Reactive
hypoglycemia. JAMA 1980;243:1151-5.
[5] Richard JL, Rodier M, Monnier L, Orsetti A, Mirouze J. Effect of
acarbose on glucose and insulin response to sucrose load in reactive
hypoglycemia. Diabete Metab 1988;14:114-8.
[6] Pandit MK, Burke J, Gustafson AB, Minocha A, Peiris AN. Drug-
induced disorders of glucose tolerance. Ann Intern Med 1993;118:
529-39.
[7] Larger E, Hillaire-Buys D, Assan R, Blayac JP. Drug-induced
hypoglycemia in 1995. Pharmacovigilance data, analysis of the
literature. Journ Annu Diabetol Hotel Dieu 1995:89-105.
[8] ServiceFJ. Hypoglycemic disorders. N EnglJMed1995;332:1144-52.
[9] Vezzosi D, Bennet A, Fauvel J, Boulanger C, Tazi O, Louvet JP, et al.
Insulin levels measured with an insulin-specific assay in patients with
fasting hypoglycaemia related to endogenous hyperinsulinism. Eur
J Endocrinol 2003;149:413-9.
[10] McLeanAM,FaircloughPD. Endoscopicultrasoundinthelocalisation
of pancreatic islet cell tumours. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab
2005;19:177-93.
[11] Noone TC, Hosey J, Firat Z, Semelka RC. Imaging and localization of
islet-cell tumours of the pancreas on CT and MRI. Best Pract Res Clin
Endocrinol Metab 2005;19:195-211.
Pour en savoir plus
Hartemann-Heurtier A, Chanson P. Hypoglycémies chez l’adulte non
diabétique. In: Traité d’endocrinologie. Paris: Médecine-Sciences
Flammarion; 2007. p. 1106.
Young J. Hypoglycémie. In: Endocrinologie, diabétologie et maladies
métaboliques. Connaissances et pratiques. Paris: Elsevier Masson;
2007. p. 206.
A. Hartemann-Heurtier, Professeur des Universités, praticien hospitalier ([email protected]).
Service d’endocrinologie-métabolisme, groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Hartemann-Heurtier A. Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique. EMC (Elsevier Masson
SAS, Paris), Traité de Médecine Akos, 1-1340, 2008.
Disponibles sur www.em-consulte.com
Arbres
décisionnels Iconographies
supplémentaires Vidéos /
Animations Documents
légaux Information
au patient Informations
supplémentaires Auto-
évaluations
.
.
1-1340
¶
Suspicion d’hypoglycémie chez l’adulte non diabétique
4Traité de Médecine Akos
þÿDocument téléchargé de ClinicalKey.fr par HFR hopital fribourgeois freiburger spital octobre 30, 2016.
Pour un usage personnel seulement. Aucune autre utilisation n´est autorisée. Copyright ©2016. Elsevier Inc. Tous droits réservés.
1
/
4
100%