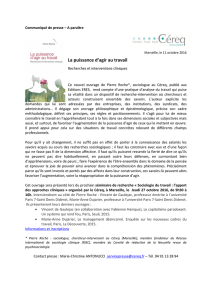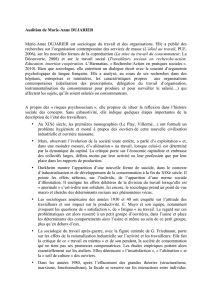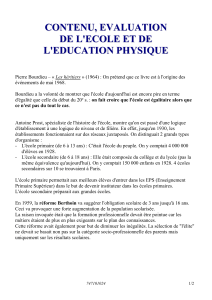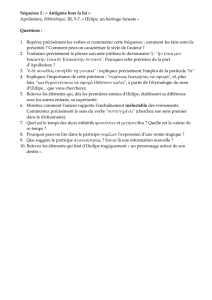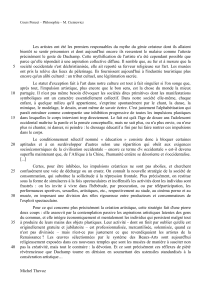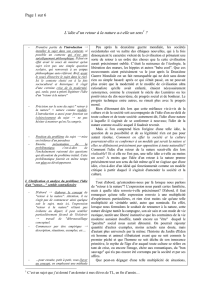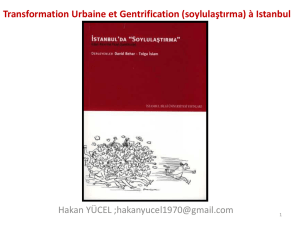Rester bourgeois

décembre 2015 I n° 182 I idées économiques et sociales 77
I LECTURES
Apparu en 2000 sous la plume du journaliste états-
unien David Brooks, le terme de « bobos » s’est rapi-
dement diusé de ce côté-ci de l’Atlantique. Mais il
désigne des groupes sociaux relativement disparates,
de l’intellectuel désargenté au nouveau riche esthète
en passant par les militants altermondialistes et autres
consommateurs de produits « bio », comme le
remarque d’emblée Anaïs Collet. Sociologue, celle-ci
s’est donc eorcée dans sa thèse de doctorat, dont est
issu le présent ouvrage, de préciser les frontières
intérieures de cette catégorie « fourre-tout » et non
dénuée de connotations morales. Partant du postulat
selon lequel les dynamiques sociales, et en particulier
les recompositions de la stratification, se reflètent
largement dans la distribution sociale de la population
et ses évolutions 1 , elle s’est plus précisément penchée
sur la population des « gentrieurs », c’est-à-dire ces
membres des classes moyennes ou supérieures inves-
tissant les quartiers populaires. Pour ce faire, elle a
comparé plus précisément deux territoires particuliè-
rement concernés par la gentrication : le quartier des
Pentes de la Croix-Rousse à Lyon et celui du Bas-
Montreuil situé dans la ville du même nom, elle-
même sise dans la petite couronne parisienne. Elle a,
pour ce faire, mené une cinquantaine d’entretiens
auprès de ménages « gentrieurs » d’âge et d’ancien-
neté différents pour tenter de reconstituer leurs
« motivations » au regard de leurs trajectoires et
contraintes respectives, mais aussi la manière dont ils
se sont concrètement approprié leurs nouveaux
espaces de résidence ou de travail.
Elle met ainsi en évidence deux résultats principaux :
d’une part, la diversité eective de cette population
des « gentrieurs » et, de l’autre, le fait que, loin de se
cantonner à une situation passive résultant des forces
Note de lecture rédigée
par Igor Martinache,
Prag de SES
à l’université Lille 1
1 Comme l’ont montré
plusieurs travaux
contemporains : voir par
exemple ceux de D. Harvey ;
ou encore M. Cartier, I.
Coutant, O. Masclet, Y. Siblot,
La France des « petits-
moyens », Paris,
La Découverte, 2008 ;
O. Masclet, La Gauche et
les Cités, Paris, La Dispute,
2003 (notamment la première
partie) ; sans oublier N. Elias,
J. Scotson, Logiques de
l’exclusion, Paris, Fayard,
1997 [1965].
2 Dont Pierre Bourdieu,
entre autres, a déjà montré
tout le travail de construction
sous-jacent. Voir P. Bourdieu,
Les Structures sociales
de l’économie, Paris,
Seuil, 2000.
3 S. Tissot, De bons voisins,
Paris, Raisons d’Agir, 2011.
du marché immobilier 2 , la gentrication implique un
triple travail : économique, social et symbolique.
Les « gentrifieurs » se distinguent en premier
lieu par leur génération d’appartenance, comme le
montre d’abord l’auteur : aller s’installer dans les
quartiers ouvriers ne revêt pas le même sens pour
les membres des « nouvelles classes moyennes »
dans les années 1970 et leurs puînés des années
2000. Le contexte n’est en particulier pas le même,
les pouvoirs publics ayant entre-temps adopté une
posture de promotion active de ce processus, tant
sur le plan symbolique qu’économique. Mais l’hété-
rogénéité subsiste également au sein d’une même
génération, en fonction notamment de la dotation
relative en capitaux, respectivement culturels et
économiques, détenus par les ménages concernés,
elle-même étroitement liée aux professions de ses
membres, mais aussi à leurs héritages familiaux, au
sens large. Vont en découler des manières distinctes
d’investir les lieux, au sens plein du terme, sur le
plan matériel, mais aussi symbolique, en agissant de
diverses façons pour changer leur image publique,
et relationnel, à travers son insertion dans le tissu
associatif et politique local par exemple. La thèse
que défend ainsi Anaïs Collet est que ce travail de
« gentrication » constituerait pour les générations
les plus récentes une manière de compenser un relatif
déclassement social, que traduit spatialement l’im-
possibilité de demeurer dans les quartiers bourgeois
traditionnels. Se joue ainsi par là une nouvelle forme
du processus de distinction sociale mis en évidence
par Pierre Bourdieu, ce qui rejoint notamment le
travail de Sylvie Tissot sur les gentrieurs, certes
socialement plus haut placés, du quartier de South
End à Boston
3
.
Rester bourgeois
Anaïs Collet
Paris, La Découverte, coll. « Enquêtes de terrain », 2015, 283 p.
ISBN : 978-2-7071-7565-6

Que ce soit en tant que citoyen, travailleur ou usager,
il se passe rarement une journée sans que chacun d’entre
nous ne peste contre la « bureaucratie ». Par là, nous
entendons en fait plus exactement les divers dispositifs,
c’est-à-dire cet ensemble disparate de « choses » non
humaines (règlements, procédures, instruments, orga-
nisations spatiales et matérielles, discours, etc.) qui ont
en commun d’orienter nos conduites d’une manière ou
d’une autre. On doit à Michel Foucault d’avoir mis en
évidence la montée de cette forme de « gouvernemen-
talité » qui permet le contrôle à distance des publics, et
on ne compte plus les travaux qui, dans sa lignée, se sont
depuis appliqués à en analyser les rouages dans une
multiplicité de contextes 1 . Mais si beaucoup ont étudié
la réception de ces dispositifs, peu ont cependant analysé
leur production, comme le note Marie-Anne Dujarier,
qui propose donc de corriger ici cette lacune. Elle met
ainsi au jour le travail et les représentations de ceux qui
conçoivent les dispositifs et qu’elle regroupe sous le
terme de « planneurs ». Cette catégorie recouvre cette
fraction des cadres qui n’encadrent pas directement le
travail de leurs subalternes : ingénieurs des méthodes,
consultants, contrôleurs de gestion, responsables
qualité, des ressources humaines, de la communication
interne ou du marketing, etc., qui travaillent souvent
dans le confort feutré des sièges de leurs entreprises ou
administrations. L’auteur livre ainsi dans cet ouvrage
quelques-uns des résultats d’une vaste enquête, à la fois
quantitative et qualitative 2 , menée durant trois ans pour
le compte de l’Association pour l’emploi des cadres
(Apec), dans le but de mieux comprendre pourquoi, en
dépit de leurs dénonciations unanimes – y compris de la
part des « planneurs » eux-mêmes, qui sont aussi le plus
souvent les utilisateurs des dispositifs élaborés par
d’autres ! –, les dispositifs et les fonctions de conception
associées ne cessent néanmoins de se diuser dans nos
sociétés. L’auteur commence par pointer que les dispo-
sitifs peuvent relever de trois grands types diérents : les
dispositifs de finalités, qui consistent à assigner des
objectifs quantitatifs à leurs destinataires ; les dispositifs
de procédés, qui prescrivent une marche à suivre et
automatisent, ce faisant, le comportement de leurs utili-
Note de lecture rédigée
par Igor Martinache,
Prag de SES
à l’université Lille 1
1 Parmi eux, on peut,
entre autres, renvoyer à un
« classique » : P. Lascoumes,
P. Le Galès (dir.), Gouverner
par les instruments, Paris,
Presses de Sciences Po, 2011.
2 Relevant plus précisément
de la sociologie clinique,
comme elle le détaille
p. 26-29.
3 Voir E. Hughes, Le Regard
sociologique, textes choisis et
traduits par J.-M. Chapoulie,
Paris, Éd. de l’EHESS, 1997.
4 Voir par exemple, B. Bréville,
P. Rimbert, « Pour gagner
des points, lisez cet article »,
Le Monde diplomatique,
décembre 2013.
sateurs ; et enn, les dispositifs d’enrôlement, dont la
nalité est de faire adhérer les employés aux objectifs de
l’organisation qui les porte. Elle développe ensuite les
critiques adressées aux dispositifs, avant d’expliquer
pourquoi, malgré les aberrations fréquentes qui résultent
de leur mise en œuvre, ceux-ci s’intègrent néanmoins
tout à fait dans le vaste mouvement de rationalisation mis
en évidence par Max Weber, et en particulier dans sa
phase actuelle « néolibérale ». Puis, elle se penche plus
précisément sur les « planneurs », dont elle décrit
d’abord le prol – plus féminisés, diplômés, mais aussi
d’origine sociale plus élevée et appartenant à de plus
grandes organisations que la moyenne des cadres –, avant
de se pencher sur leur activité à proprement parler.
Ceux-ci sont d’abord investis d’un triple mandat :
réduire les coûts, augmenter la productivité et enn
mesurer divers aspects de l’activité organisationnelle, ce
qui n’est pas sans s’apparenter à un « sale boulot » au sens
d’Everett Hughes 3 . Conscients de cela, ils déploient,
lors des entretiens avec Marie-Anne Dujarier, diérents
registres de justication, sans paraître cependant tout à
fait convaincus par ces derniers. La sociologue y voit ainsi
des « pratiquants non croyants » du capitalisme néo-
libéral, qui s’attellent néanmoins avec un zèle évident
aux différentes tâches qui constituent leur activité,
pendant un certain temps du moins, car si certains
aspirent à monter dans la hiérarchie, d’autres nissent
plus ou moins vite par ne plus « se prendre au jeu ». Ce
dernier terme est à prendre au sérieux selon l’auteur, qui
explique nalement que pour beaucoup, c’est précisé-
ment le fait de « s’amuser » en manipulant des abstrac-
tions déconnectées de leurs conséquences pratiques, du
fait notamment d’une sociabilité restreinte à leurs pairs,
qui permet aux « planneurs » de faire ce qu’ils font
pendant un temps relativement dilaté, au-delà des rétri-
butions monétaires et sociales et de l’intériorisation de
normes professionnelles de la « réussite ». Elle invite
ainsi plus largement à s’interroger sur ce processus de
«ludicisation» du management qui s’étend à l’ensemble
de la vie sociale 4 et se révèle d’autant plus ecace qu’il
est souvent inaperçu. Qui en eet se doute qu’il est
gouverné quand il pense simplement s’amuser ?
Le Management désincarné
Marie-Anne Dujarier
Paris, La Découverte, coll. « Cahiers libres », 2015, 259 p.
ISBN : 978-2-7071-7844-2
LECTURES I
1
/
2
100%