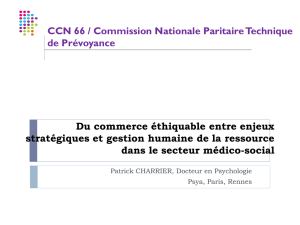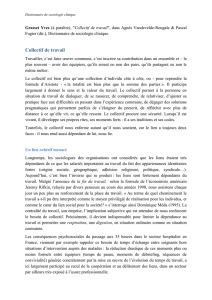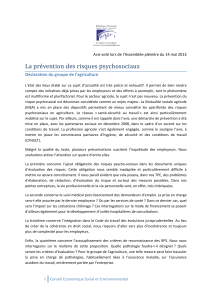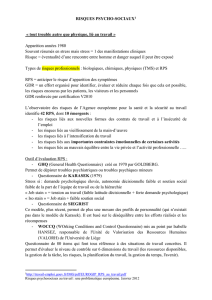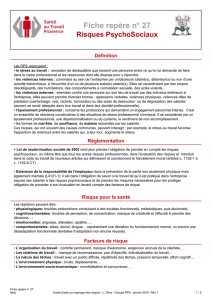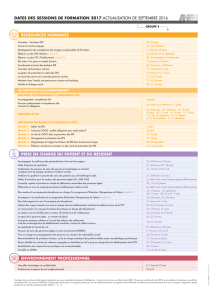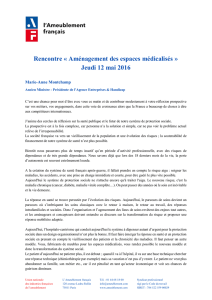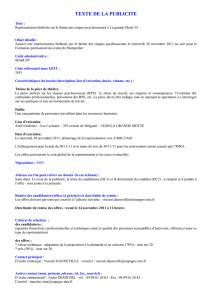Compte-rendu de l`audition de Marie-Anne Dujarier

Audition de Marie-Anne DUJARIER
Marie-Anne DUJARIER est sociologue du travail et des organisations. Elle a publié des
recherches sur l’organisation contemporaine des services de masse (L’idéal au travail, PUF,
2006), sur les nouvelles formes de la coproduction (La mise au travail du consommateur, La
Découverte, 2008) et sur le travail social (Travailleurs sociaux en recherche-action.
Education, insertion coopération. L’Harmattan, « Recherche-Action en pratiques sociales ».
2010). Bien que sociologue, elle entretient un dialogue étroit avec le courant d’ergonomie
psychologique de langue française. Elle a analysé, au cours de ses recherches dans des
hôpitaux, entreprises et ministères, les caractéristiques propres aux organisations
contemporaines (idéalisation des prescriptions, délégation du travail d’organisation,
instrumentalisation du consommateur pour produire et pour surveiller le salarié…) qui
affectent les sujets, qu’ils soient salariés ou consommateurs.
A propos des « risques psychosociaux », elle propose de situer la réflexion dans l’histoire
sociale des concepts. Sans exhaustivité, elle indique quelques étapes importantes de la
description de l’état des travailleurs.
• Au XIXè siècle, les premières monographies (Le Play, Villermé…) ont formulé un
problème hygiéniste et moral à propos des ouvriers de cette nouvelle civilisation
industrielle et ouvrière naissante.
• Marx, observant l’évolution de la société toute entière, a parlé d’« exploitation » et,
dans une moindre mesure, d’« aliénation » au travail, lorsque celui-ci est déterminé
par la dynamique du capital. La critique porte sur l’économie capitaliste et embrasse
des collectifs larges, définis moins par leur activité ou leur profession que par leur
place dans les rapports de production.
• Durkheim montre l’apparition d’une nouvelle forme de suicide, dans le contexte
d’industrialisation et de développement de la consommation à la fin du XIXè siècle. Il
pointe les effets néfastes, sur l’individu, de l’apparition d’une norme sociale
d’illimitation. Il souligne les effets délétères de la division du travail lorsqu’elle est
« anormale » c’est-à-dire non solidaire. Ici encore, le sociologue prend un point de vue
macro et cherche des déterminants sociaux aux phénomènes vécus.
• Les sociologues américains des années 1930 et 40 ont enquêté sur l’attitude des
travailleurs et son impact sur la productivité. E. Mayo et son équipe, notamment
évoquent les questions de « satisfaction », de « fatigue » au travail. Le regard sur ces
problématiques est alors resserré à un petit groupe d’ouvrières, dans l’usine et place
les déterminants des comportements dans l’usine et même au sein de ce petit groupe,
plus qu’en dehors d’eux.
• La sociologie du travail après-guerre, avec la figure centrale de G. Friedmann, porte
sur les effets de la rationalisation industrielle sur l’activité et les travailleurs. Elle fait
la critique de ce « travail en miettes » et de son pendant, la société de consommation
qui ne tient pas ses promesses compensatrices. Les études empiriques portent alors
essentiellement sur les ateliers. Elles dénoncent « l’insatisfaction », « l’aliénation » et
la « soif de culture » des ouvriers.
•
Dans les années 1980, après l’effacement des grandes théories (structuralisme,
marxisme, fonctionnalisme), la focale se resserre sur les interactions entre individus.

Le terme de « stress » se banalise pour parler du vécu des cadres, puis des autres
travailleurs, notamment dans les services. Il qualifie le plus souvent ce qui se joue
dans la relation entre deux personnes (chef / subordonné, ou consommateur / salarié
ou encore usager / fonctionnaire, typiquement).
• Le terme de « souffrance » a pris le devant de la scène dans les années 1990 : la
réception sociale des ouvrages employant ce terme montre un glissement notoire vers
l’expression d’une plainte subjective individuelle à propos de la manière de vivre le
travail. Enfin, ce n’est que depuis récemment qu’est apparue l’expression de « risques
psychosociaux », comme invention sémantique mobilisée pour les négociations entre
employeurs, employés et Etat (et leurs représentants). Il désigne un ensemble flou de
symptômes individuels tels que le stress, le harcèlement moral, violence, souffrance,
suicides, dépressions, TMS.
Comme l’a montré Marc Loriol, les désignations sociales et sociologiques de ces phénomènes
au travail, comportent des enjeux importants, que la sociologie peut repérer et analyser. En
l’occurrence, ces différents moments historiques indiquent un resserrement de la focale (allant
de la civilisation au sujet isolé), une psychologisation des discours et le retour d’une critique
morale, débouchant sur des préconisations d’actions centrées sur la réparation et la
responsabilité individuelles plus que sur de la lutte collective.
A propos de l’expression « Risques psychosociaux », Marie-Anne DUJARIER relève les
ambigüités du terme.
• Tout d’abord, « RPS » n’indique pas si le « psychosocial » est la cause ou l’objet du
risque. La dimension « psychosociale » du travail fait-elle courir des risques à certains
acteurs de l’entreprise (il faudrait alors savoir de quels acteurs il est question, et quels
risques ils encourent) ? Ou bien le travail génère-t-il des symptômes délétères, de
nature psychosociale ? L’expression ouvre les deux possibilités d’interprétation,
pourtant fort différentes. Surtout, elle invite à clarifier le rapport entre « facteur » et
« symptôme », si l’on fait l’hypothèse que la dimension psychosociale est à la fois
requise et produite dans l’activité.
• Ensuite, cette expression laisse entendre qu’il existerait des risques non
psychosociaux1. Selon la réponse donnée à la première question nous pouvons faire
des hypothèses sur ce que serait le risque non psychosocial. Sans doute s’agit-il, dans
cette représentation, des risques causés par les machines (mais celles-ci ne sont-elles
pas conçues, construites et maniées par des hommes ?) ou des risques causant des
dégâts matériels et corporels. Dans cette représentation implicite de l’homme et de son
action sur le monde, affleure l’idée que le monde matériel (des objets, des techniques
etc.) comme le corps sont des catégories séparées et étanches à la « psyché » et au
« social ». Cette représentation est fort discutable d’un point de vue sociologique
comme épistémologique.
• Enfin, le risque est une notion qui renvoie au lexique gestionnaire. Parler de risque,
c’est induire l’idée que l’on peut le connaître, l’anticiper, le « gérer ». Que l’on doit et
que l’on peut contrôler l’incertitude et l’ampleur de ses effets, en renforçant les règles
ou les dispositifs autour du travailleur, tout en lui donnant des consignes précises et
normées de comportement. Cette approche bien connue du risque, que les experts
nomment « bureaucratique », produit plus de prescriptions et tend à la désignation de
1 Le rapport Nasse-Legeron de 2008, par exemple, définit explicitement les RPS comme étant « à côté des
risques physiques, biologiques et chimiques ».

victimes émissaires aux dépens d’une analyse des processus réels. En outre, cette
expression peut récupérer et donc occulter la réalité du risque tel qu’il est vu du métier
(risque acceptable, risque comme ressource, jeu avec le risque etc…), vu des
consommateurs et vu des citoyens …et qui ont un tout autre aspect.
La conception de Marie-Anne DUJARIER à propos du lien entre travail, organisation et santé,
part d’un présupposé que tout travail est une activité. Celle-ci peut être définie comme ce qui
consiste à sentir les situations, à élaborer des réponses et à produire des significations.
L’activité est alors à la fois le lieu de construction du sens et de production de la santé. De ce
point de vue, elle est toujours « risquée » puisqu’elle peut échouer, être empêchée, altérée,
détournée. Le plus grand des risques serait alors le déni de ce risque-là.
Le risque serait donc d’oublier (ou feindre d’oublier) que se joue dans l’activité, à la fois le
sens de ce que nous faisons au monde et la santé des sujets. Il apparaît chaque fois que
l’activité est réduite à ce qu’elle produit (plus qu’à ce qu’elle est), c’est-à-dire à sa dimension
abstraite, comptable (son coût et sa productivité) et, conséquemment, lorsque celui qui la fait
n’est socialement saisi que comme « ressource humaine ». Ce risque a été identifié dès les
débuts du salariat. Entre la conception abstraite du travail par l’employeur et celle, concrète
du travailleur, il existe une inévitable différence d’attentes et de perceptions. Dans bien des
cas, elles sont en tension, voire en contradiction. Le premier cherche des gains de productivité
qui passent le plus souvent par une dégradation du travail. Tâches parcellaires, répétitives,
standardisées, sous pression temporelle, avec isolement… produisent en effet le plus souvent
des sensations désagréables, réduisent les occasions d’élaboration et les possibilités de
produire des significations collectives. Diminuer le « risque » pour le travailleur, consiste
donc essentiellement à pouvoir opposer à la conception abstraite et quantitative du travail,
celle de l’activité.
Or les déterminants de ce rapport de force sont aussi extra-organisationnels. La législation
portant sur l’état du marché du travail et la protection du salarié contre l’asymétrie salariale,
notamment, ont une influence sur la qualité, l’intérêt et la dangerosité de l’activité. Les
normes sociales, notamment en matière de risques acceptables selon les pays, les âges et les
statuts, jouent également. La règlementation portant sur la circulation des capitaux, des
produits et du travail est enfin décisive puisqu’elle induit une certaine division (sociale,
géographique et organisationnelle) des activités productives. Les institutions expriment et
concrétisent la manière dont le travail est situé dans une société donnée. Plus que la
« moralisation » des employeurs, comme le suggèrent des rapports récents, c’est donc la
règlementation de l’emploi, des conditions de travail, du capital et du marché des biens et
services qui peuvent jouer significativement sur les conditions de vie au travail, dans un
contexte de mondialisation.
A un niveau plus méso, le rapport de force est également à l’œuvre avec les employeurs. Il
porte sur les conditions de travail et la nature des tâches, ce que Marie-Anne DUJARIER
appelle le « travail d’organisation » et qui se réalise à de nombreux niveaux et moments :
entre l’employeur et le salarié, dans les instances (CE, CHSCT…), dans une équipe ou un
métier et même dans l’interaction avec l’usager ou consommateur.
Pascale MOLINIER demande s’il n’y a pas d’autres leviers de l’action que ceux qui portent
sur les déterminants extra-organisationnels, ou que ceux qui sont au niveau de l’employeur :
les salariés peuvent aussi mettre collectivement en place des aménagements efficaces au point
de vue de la santé.

Marie-Anne DUJARIER en convient : la théorie sociologique de la régulation, a bien montré
l’importance de la « régulation autonome », des arrangements et renormalisations locales. Ils
sont précisément le moment de l’activité telle que définie précédemment. Mais elle observe
que les conditions sociales à cette régulation sont aujourd’hui fragiles, notamment du fait de
l’accroissement continu du chômage de masse qui instaure un rapport social pesant. Mais les
marges de manœuvre sont aussi dépendantes des interactions et relations. Or une forte
individualisation (des emplois, parcours, formations, tâches, horaires, primes …) et la mise en
concurrence entre travailleurs comme l’intensification des contrôles, fragilisent les conditions
de formation d’un acteur collectif. Il arrive souvent que le rapport de force amène à « prendre
sur soi » plutôt qu’à produire de nouveaux arrangements vivables avec les autres employés.
La difficulté de produire une régulation autonome est l’un des principaux facteurs de
dégradation de l’activité et donc d’accroissement des « Risques psychosociaux » aujourd’hui.
Marie-Anne DUJARIER revient sur l’ambigüité du terme risque. Il peut être compris de deux
manières. Il peut, dans un premier sens, concerner la santé des salariés. Mais le terme « RPS »
peut être entendu autrement. Il peut également désigner le risque pénal, financier et
commercial pour l’employeur. Vu de ce coté-ci de la relation salariale, le mot « risque »,
signifie que l’employeur pourrait être taxé (moralement et financièrement) de n’avoir pas
mené des actions préventives suffisantes. Le risque, pour lui, est surtout de se voir accuser
(justement ou non) par un juge, les médias ou les consommateurs de symptômes visibles, tels
que, par exemple, un fort taux de suicides ou de maladies dans l’entreprise. Les employeurs et
leurs représentants (cadres supérieurs salariés) se voient donc incités à se « couvrir » en
montrant qu’ils prennent des mesures concrètes contre ces risques. Ils deviennent alors
acheteurs de solutions leur permettant de réduire les coûts économiques des « risques
psychosociaux ». Toute une série de nouveaux « experts » (autoproclamés) des RPS vont
s’empresser de leur fournir ces moyens, sous forme de méthodes, formations, communication,
certifications, audits, notations, assurances, etc. Marie-Anne DUJARIER établit une
comparaison avec les phénomènes qu’elle a étudiés dans son livre L’idéal au travail (PUF,
2006) à propos des procédures dites de « Qualité ». La « qualité vitrine » et la « qualité
réelle » peuvent diverger considérablement et mener à ce qu’une entreprise couverte de labels
de qualité et de certifications, produise malgré tout des processus et des produits jugés
défaillants par d’autres évaluateurs (la direction, les travailleurs eux-mêmes, les
consommateurs, …). Bien des salariés aujourd’hui sont obligés de « se couvrir » en laissant
des traces d’une activité conforme, et ce même s’ils jugent, au même moment, qu’ils font un
travail de mauvaise qualité. L’obligation de moyens sur les RPS peut mener au même
phénomène de simulation gestionnaire et de dissimulation du réel. Nous assistons donc à la
construction sociale d’un marché où les offres de conseil, de mesure, d’audit, de certification,
notation, …rencontrent les demandes des employeurs incités à se « couvrir » contre ce
nouveau risque légal. Devenu un produit sur un marché et donc un enjeu de développement
commercial, il est logique que les RPS augmentent.
Dans ce contexte, au moment de bâtir des enquêtes statistiques, une question essentielle à se
poser serait celle de savoir à l’attention de quels acteurs sociaux elles sont produites et dans
quel but. En outre, il serait intéressant, si cela est possible, de mesurer la part des RPS qui
sont liés de leur marchandisation, indépendamment de l’évolution des conditions de travail
elles-mêmes.
Il pourrait être intéressant de mesurer une éventuelle corrélation entre niveau de concurrence
entre travailleurs et la santé au travail. Si l’on confirme statistiquement ce que les cliniciens
observent, à savoir que la concurrence entre les salariés dégrade leur santé, alors nous aurions

un argument quantitatif supplémentaire à opposer à ceux qui, dans le champ social ou
sociologique, postulent et pratiquent l’inverse.
Mais d’une façon plus générale, selon Pascale MOLINIER, il faut tenir compte de la question
de l’acceptabilité des risques, qui varie d’une société à l’autre. Marie-Anne DUJARIER en
convient et rappelle que la sociologie du travail et des professions a amplement étudié cette
division et répartition sociales des tâches, la distribution du « sale boulot » (Hugues) et des
risques. Elle cite également les travaux d’Annie Thébaud-Mony. Celle-ci montre que nous
assistons à une division internationale de la morbidité du travail. Les consommateurs
occidentaux acceptent finalement assez bien l’idée que des activités risquées (intoxications,
accidents du travail, précarité, cadences et horaires éreintants…) jugées inacceptables ici,
soient délocalisées.
1
/
5
100%