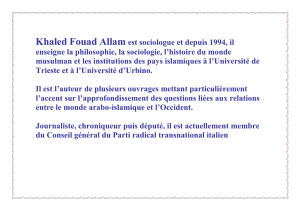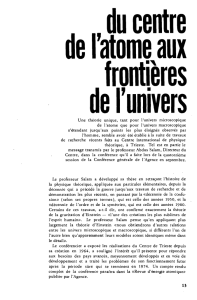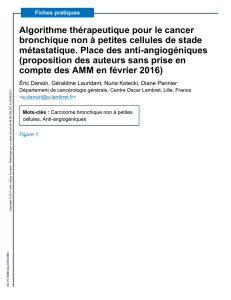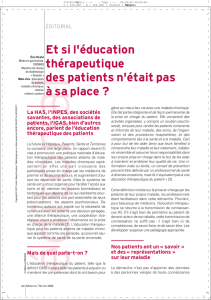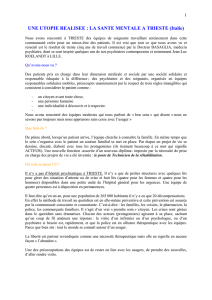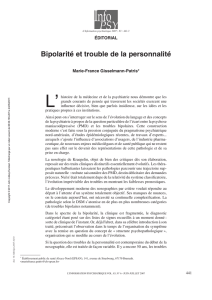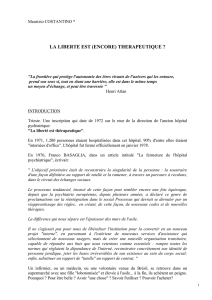Rencontre avec Catherine Zittoun

Journal Identification = IPE Article Identification = 1097 Date: August 29, 2013 Time: 12:24 pm
L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 571–7
MÉMOIRES VIVES
Rubrique coordonnée par S. Parizot, M. Reca, C. Hanon, M. Sicard
Rencontre avec Catherine Zittoun
Cécile Hanon, Marion Sicard
©Yann Layma
Cécile Hanon : Bonjour ma chère Catherine. Nous nous sommes rencontrées il y
a plus de dix ans, alors que j’étais jeune interne et que je faisais mon premier stage
de pédopsychiatrie dans ton service. Tu étais alors praticien hospitalier, en charge de
la consultation d’un des CMP et de l’accueil familial thérapeutique du 11esecteur de
psychiatrie infanto-juvénile de Paris. C’est toi qui m’as alors fait découvrir ce que le mot
« antipsychiatrie » voulait dire, et je me souviens de nos discussions enflammées au sujet
de ton expérience italienne. Tu es maintenant chef de ce service de pédopsychiatrie, et
c’est tout naturellement que j’ai pensé à toi pour intervenir dans notre rubrique.
Luciano Carrino, interrogé par Suzanne Parizot dans notre rubrique précédente,
évoquait son départ à Trieste en 1971 en ces termes : « Nous avons pu relancer le
travail qui a abouti au dépassement de l’asile dans une atmosphère enthousiasmante
qui nous amenait de très nombreux visiteurs ou stagiaires venant du monde entier et
qui constituaient comme des « brigades internationales » engagées dans notre combat
contre l’exclusion ». Étais-tu de ces brigades ?
Catherine Zittoun : Je n’aime pas trop ce mot « brigades » mais oui, en quelque
sorte. On parlait plutôt de « volontaires»àTrieste. Je décidais d’y partir au début
des années 1980. J’ai alors 18 ans, je ne suis pas encore psychiatre ni même médecin.
Enfant, j’ai été traversée par ce grand élan de 1968. J’entendais ces voix tout près
revendiquant plus de liberté, d’égalité, la beauté, l’imagination. J’écrivais à peine mais
sur les murs, des mots dans l’air du temps. Émerveillée, j’entendais ces appels à la fin du
capitalisme, d’un système policé et d’autres mots tiroirs aux yeux d’un enfant. Avec ce
bagage entre autres, j’entrais dans l’adolescence. J’y croisais ici et là la psychanalyse,
les écrits de Freud, ceux de Laing et Cooper, « Le moi divisé », « La politique de la
doi:10.1684/ipe.2013.1097
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦7 - SEPTEMBRE 2013 571
Pour citer cet article : Hanon C, Sicard M. Rencontre avec Catherine Zittoun. L’Information psychiatrique 2013 ; 89 : 571-7 doi:10.1684/ipe.2013.1097
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1097 Date: August 29, 2013 Time: 12:24 pm
C. Hanon, M. Sicard
famille », « Le voyage de Mary Barnes »... Le monde de la folie ouvrait à des terres
extraordinaires et infinies.
Ces années-là, je croisais Marisa qui venait d’Argentine avec un aller sans retour.
Elle résidait souvent à Trieste où elle faisait de la céramique dans un lieu étrange où
l’on côtoyait des fous. Là-bas on avait ouvert les asiles. Les fous n’étaient plus des fous
mais des personnes autres. Dans les mots de Marisa, ces lieux regorgeaient de vie. Je
partis pour Trieste.
Des volontaires affluaient du monde entier pour contribuer à cette expérience. Nous
logions dans l’enceinte du manicomio, l’asile, constitué de pavillons dispersés dans
une végétation prolixe, des vallons, des prairies. Je me souviens d’une grande chambre
aux murs lézardés, des matelas au sol, un joyeux fouillis. Nous dormions là et il y avait
des repas festifs, des fêtes tardives.
Très vite après mon arrivée, je croisais Fulvio, un homme au visage vérolé, au
sourire borgne qui me parla de ces régions là-bas dans ces montagnes autour des lacs,
de coutumes étranges où l’on côtoie les esprits. Lui-même les avait approchés. Il en tirait
un savoir particulier. Installé à Trieste depuis plusieurs années, Fulvio gravitait autour
de nous. Il n’était ni dedans ni dehors de ce cercle que nous formions. Il semblait trouver
là un état d’équilibre. L’écoutant raconter, je chevauchais des frontières, j’entrevoyais
des précipices. Je mesurais la précarité des limites entre folie et normalité.
C¸ a se passait là, à Trieste, aux confluents de l’histoire et des cultures. Des civili-
sations voisinaient dans une apparente méconnaissance mutuelle. À côté de quartiers
cossus au pur style autrichien, des quartiers italiens délabrés. D’autres quartiers plus
coquets. Des files étranges de gens en noirs aux abords de la gare, ils venaient de You-
goslavie. On y manquait de tout, disait-on. Ces personnes comme des ombres passaient
la frontière pour s’approvisionner en Italie. Ici à Trieste, la mer et la montagne faisaient
l’horizon.
Marion Sicard : Comment était la vie dans les centres de soins ?
C.Z. : Dans un quartier modeste, Via Gambini quatro, un immeuble près d’un
carrefour, le Centro de Salute Mentale occupait le rez-de-chaussée et le premier étage.
Y travaillait une équipe de soins équivalente à celle d’un CMP. Le type de travail y
est le même aussi. Des patients viennent là ponctuellement ou davantage. Quelques
bureaux sont réservés aux soignants, les autres espaces étant ouverts à tous. On discute
à une table autour d’un thé. On se regroupe. On échange. On m’accueille. Je m’initie.
Je ne parle quasiment pas l’italien, quelques mots à peine extrapolés du latin. Hors les
livres, la folie, je ne connais pas.
J’accompagne des patients. Ambra, une jeune utente1, m’entraîne dans Trieste, elle
me parle, me parle, sa vie, passionnante, un roman. Elle est heureuse de parler, d’être
écoutée, d’être quelqu’un dans l’attention de quelqu’un. Je ne connais pas la folie. Je
n’ai aucun jugement.
À un médecin du centre, je raconte, Ambra m’a révélé des bribes de son histoire. Le
médecin rit gentiment. La jeune femme n’a rien vu, rien vécu de tout c¸a. Quoi, tout cela
n’est pas vrai ? Tout cela était le monde de la jeune femme. Mais rien de tangible, rien
de saisissable. Cette journée avec elle, j’ai marché sur du vent. Invalidant ces dires, la
parole du médecin sonne comme un couperet. Des précipices s’ouvrent, je suis proche
d’y tomber.
Je suis des soignants dans leurs missions. Mario, médecin responsable du centre,
m’emmène chez Philippo. Il ne va pas bien. Il vit dans sa famille. Il n’y a plus
d’hôpital ici. Une cage d’escaliers, les étages défilent. On est dans un salon, une lumière
glauque. Une chambre attenante. Philippo est immobile dans son lit, ne réagit pas aux
sollicitations. Mario soutient les parents, discute avec eux, donne des conseils. Mario
rédige une ordonnance. Il faudra revenir bientôt.
1Utente : usagers de la psychiatrie. C’est ainsi que l’on nommait les patients. En France on les nommait des malades.
572 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦7 - SEPTEMBRE 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1097 Date: August 29, 2013 Time: 12:24 pm
Rencontre avec Catherine Zittoun
Je vais avec des infirmiers et quelques utente pour des promenades en ville. Nous
longeons le bord de mer, bras dessus bras dessous. Nous sommes des promeneurs parmi
d’autres. Des regards de travers, probablement. De tous les gens que j’ai connus par la
suite à Trieste, à moins de quelques-uns uns travaillant dans le milieu de la psychiatrie
ou gravitant autour, peu étaient au courant de ce mouvement d’ouverture des asiles
dans leur ville. D’autres aussi, méfiants ou peureux à cet égard. Les fous, il fallait s’en
tenir à distance.
C’était au début des années 1980, le manicomio avait fermé ses portes et libéré ses
fous dix ans plus tôt. À l’acceptation de la différence et de la singularité de l’autre,
le chemin à parcourir était long. Dans les centres de santé mentale, partout, entre
volontaires, on réfléchissait à des solutions. Trieste était un lieu de créativité et de
débats incessants.
Des débats à propos des devenirs aussi. Les utente, sortis de l’asile, étaient partis
vivre dans leurs familles ou dans des appartements collectifs. Mais sans but, et héritiers
sans doute d’une longue tradition de relations soignants-soignés, ils attendaient dés-
œuvrés devant le centre de la Via Gambini ou dans les cafés autour. C’était un signe.
L’institution devait encore avancer, l’avenir devait encore se penser. Les patients les
plus régressés ou les plus vieux au trop long passé asilaire étaient restés à l’intérieur des
murs de l’asile. Une chambre pleine de vieilles femmes démentes jouxtait la chambre
des volontaires. Aux odeurs que dégageaient nos oreillers quand nous rentrions le soir,
les vieilles s’étaient trompées de chambre ou s’ingéniaient à nous faire des farces. Je
baissais les bras, quittais la chambre commune et partis vivre au centre ville chez des
amis, travaillant aux assurances2, dockers au port et tous musiciens. J’appris l’italien
très vite.
M.S. : Comment se convertit alors l’hôpital psychiatrique ?
Quelle place y trouvas-tu ?
C.Z. : J’allais avec Mario la nuit visiter l’hôpital, juste quelques lits de crise. Pour
le reste, on devait se débrouiller autrement. F. Rotelli, qui succéda à Basaglia, mort
peu d’années auparavant, me demande un jour:«Ettoi, qu’est-ce que tu sais faire ? »
« Moi, rien ! » Puis la mémoire me revient, ces quatre années de théâtre dans un cours
prestigieux, les stages dans les compagnies d’Augusto Boal3, la création de petits
spectacles de poésie dans des caves de café et dans les festivals de poésie. À côté de
spectacles autour d’André Chédid ou de Guillevic, des auteurs moins connus, des
prisonniers dont les textes m’étaient parvenus. On me propose de me joindre un atelier
de théâtre en cours de constitution. J’embarque aussitôt. Les pavillons désaffectés
de l’asile servent à des ateliers. On nous en attribue un, pas loin de celui où Marisa
fait de la céramique. Les utente arrivent sur la pointe des pieds puis plus résolus.
Nous nous essayons les uns les autres à des improvisations, des jeux collectifs sur des
propositions d’Augusto Boal. Ne me parlez pas de l’analyse des mouvements groupaux,
des problématiques psychiques des uns et des autres, je n’y connaissais rien. Et cela
était peu mon problème. Nous étions tous pris par le plaisir du jeu. Ne me demandez
pas comment tout c¸a tenait, nous n’étions pas formés à la direction d’acteurs pas plus
qu’à aucune autre. Mais notre groupe de théâtre se portait plutôt bien. C’était juste la
vie sans doute. On se lanc¸a dans l’écriture de spectacles aux échos surréalistes. On
nous invitait même à les jouer en public. On nous aidait financièrement. C’était un
autre temps. Des partis politiques étaient partie prenante de ce mouvement d’ouverture
et facilitaient les choses.
On se référait souvent à l’asile de Gorizia où Basaglia avait initié le mouvement
au début des années 1960. On faisait des projets. Mario Realli, le médecin du centre
Via Gambini, partirait bientôt pour fermer un grand manicomio dans la province de
2Compagnie d’assurances : de longue tradition à Trieste.
3Augusto Boal a créé le théâtre de l’opprimé en 1971.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦7 - SEPTEMBRE 2013 573
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1097 Date: August 29, 2013 Time: 12:24 pm
C. Hanon, M. Sicard
Rome, le plus grand d’Italie. Maurizio, psychologue sur le même centre, avait acquis
un bateau et partait en mer avec quelques utente. Sous peu, ils embarqueraient pour
plusieurs jours.
C.H. : Et après ce séjour, tu es rentrée en France, comment s’est passé cet « après »
Trieste ?
C.Z. : Brutalement ! Je fais des remplacements d’agent hospitalier à l’hôpital Sainte-
Anne, dans un pavillon obscur où l’on attache les patients sur leurs lits. On dit qu’on
y fait des expériences pour tester des collyres pour les yeux. Je proteste. Je me vois
aussitôt affectée dans un pavillon vétuste, à l’écart de tout. Des clés pour entrer, des
clés pour sortir, un grand dortoir sentant l’urine. Il y avait des grands schizophrènes
régressés, des patients atteints de paralysie générale. Il fallait les laver, mais il n’y avait
pas de quoi les laver. On prenait du détergent, de grosses bonbonnes de savon liquide,
avec des vieux draps en guise de gants. Les infirmiers qui étaient avec moi étaient eux
aussi des « contestataires », tous mutés dans ce pavillon.
Entre deux cours à la faculté de médecine, je fais un stage dans le service de
Ginette Amado, centre rue Garancière à Paris. Je retrouve un peu là cette atmosphère
d’élation qui portait l’expérience de Trieste. Ginette Amado était une pionnière. Les
années suivantes, je suis attrapée par le moule des études de médecine, les examens,
l’apprentissage de la place du médecin, de celle du malade, de la hiérarchie. J’enfouis
les souvenirs de Trieste. Dans les services de médecine, de chirurgie, je fais de mon
mieux l’étudiante sérieuse mais je me sens vaguement en décalage. Je vis douloureuse-
ment ces relations thérapeutiques objectalisant le patient dans des discours comme des
carcans. Ce modèle, mortifère, n’épargne pas la psychiatrie, certains services parmi
les plus renommés et se réclamant de la pensée psychanalytique. S’y perpétuent des
rapports de pouvoir maintenant un ordre établi. La parole de celui qui est sensé savoir
confine le patient à une place de malade éternel qui légitime la place de l’institution
soignante telle un garde-fou.
C.H. : Comment fais-tu alors pour te « retrouver » ?
C.Z. : Je refusais, parfois en dernière limite, ce qui ne me correspondait pas ; je
retrouvais le théâtre, la poésie et la peinture ; j’entrepris une psychanalyse et découvris,
en écho à l’expérience italienne, les écrits phénoménologiques, ceux de Binswan-
ger, Fédida, Hochmann, Maldiney... Selon ce modèle, dans la relation thérapeutique
notamment, le soignant cherche un lieu particulier depuis lequel il regardera le patient,
un lieu tel qu’il le verra d’abord et simplement dans sa dimension d’altérité, un regard
tel qu’il perc¸oit l’autre dans son « advenance », dans ses naissances au monde. Cette
position, Henri Michaux l’exprime aux extrêmes, de cette fac¸on:«Jevoulais dessiner
la conscience d’exister et l’écoulement du temps, comme on se tâte le pouls ». C’est,
idéalement, dans cette intention et cette attention que l’on entre, que l’on est en rela-
tion avec le patient. Ce qui, on l’entendra, convoque une dimension philosophique et
esthétique.
C.H. : Cette expérience italienne t’a alors guidée dans ton début de carrière ?
C.Z. : Elle m’a au moins confortée dans ce que j’étais. Ce n’est pas pour rien que je
suis allée à Trieste. Je ne sais pas si ce qui m’a plu au début dans l’antipsychiatrie, c’était
la psychiatrie ou l’anti- ! Maintenant Cécile, si tu veux bien, je préfère au terme de
carrière celui de chemin. Il sera toujours temps de creuser sa carrière. Sur mon chemin,
oui, l’expérience italienne me fait des appels de phares ici ou là. Ce terme de négation
notamment. Dans sa pensée sur la communauté thérapeutique, qualification appliquée
aux réalisations de l’antipsychiatrie, Basaglia insiste sur la nécessaire négation, mou-
vement que doit opérer sans cesse l’institution pour échapper à la cristallisation dont
elle ferait l’objet dès lors qu’elle serait insérée dans le système en place.
574 L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦7 - SEPTEMBRE 2013
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.

Journal Identification = IPE Article Identification = 1097 Date: August 29, 2013 Time: 12:24 pm
Rencontre avec Catherine Zittoun
Ce que Basaglia énonce à propos de l’institution, s’entend aussi à propos du
patient. J’ai rencontré récemment un homme de 35 ans, hospitalisé dans une clinique
psychiatrique en Asie où il était venu en voyage alors qu’habituellement il sortait peu
de chez lui. Rapidement il me dit:«jesuis schizophrène ». Un peu plus tard:«Jesuis
schizophrène, donc voilà, je ne peux rien faire, je suis un malade mental, j’ai intégré ».
Ce « label » de schizophrène semblait peser lourdement sur lui. En France, il ne fai-
sait rien sinon regarder la télé. Il semblait identifié à sa maladie, complètement rentré
dans le discours que le pouvoir, s’exerc¸ant notamment à travers le diagnostic, tient
sur lui.
C.H. : Comment a évolué l’expérience de Trieste ?
C.Z. : Je ne l’ai pas suivie jusqu’à aujourd’hui. La vie m’a appelée ailleurs. Mais
je suis retournée à Trieste quelques années après ces premiers séjours. C’était triste.
Quelque chose de ce grand élan semblait être tombée. Maurizio continuait ses traversées
en mer avec les utente, mais sans plus de convictions. Il avait du mal à trouver des crédits
pour financer ses expéditions. Mario, qui était parti fermer un asile dans les alentours
de Rome, était revenu à Trieste. Son entreprise semblait s’être soldée par un échec. Il
s’était heurté là-bas à trop d’adversité. Je suis allée me consoler de cela dans ce petit
jardin près du grand manicomio, ce petit jardin où je venais réfléchir devant une statue
de James Joyce qui avait habité Trieste.
C.H. : Que te reste-t-il aujourd’hui de cette expérience ?
Quels sont pour toi les domaines qui continuent de dialoguer avec l’antipsychiatrie ?
C.Z. : Ce qui me reste, c’est d’abord l’inscription d’une aventure belle et intense,
la mémoire de ces soignants qui essayaient, qui tâtonnaient, qui avanc¸aient dans une
expérience nouvelle, un monde plutôt souple et plein d’élan, très stimulant pour la
pensée comme à chaque fois qu’il y a des changements, des mues, des mutations. On
n’est plus tout à fait en phase avec ce qui nous entoure, notre regard ne colle plus au
monde et on le voit.
De ce point de vue, c’est une période un peu équivalente que l’on traverse
aujourd’hui. La période, historique – post-historique ? – que nous traversons, res-
semble à un théâtre animé de mouvements tectoniques de plaques continentales qui se
séparent, basculent, vacillent, s’entrechoquent. Ces périodes suscitent de l’inquiétude,
des crispations autour de positions sûres, parce que connues et établies depuis des
siècles de civilisation occidentale. Autant ces moments régressifs que le moment de
l’histoire dans lequel nous sommes entrés suscitent des réactions et des mouvements
divers. Certains4, en même temps qu’ils pointent les mécanismes du pouvoir et ses
articulations à la finance notamment, sont amenés à proposer d’autres formes sociales
et d’autres priorités aux politiques.
Ainsi, ce qui se continue après Trieste, c’est la nécessité de penser ensemble le
soin à différents niveaux : dans la relation thérapeutique singulière, dans ses aspects
institutionnels, mais aussi corrélativement à un projet de société : un nouveau contrat
social, pourquoi pas ? Sur le plan de la conception des soins, la pensée, dont participe
l’expérience de Trieste, est celle qui prélude à l’organisation des soins psychiatriques
de secteur. Il s’agit là de soigner une personne et non pas une maladie, de dialoguer
avec un autre affecté d’un trouble et non de tronc¸onner cet autre en syndromes et même
en symptômes dont tel institut spécialisé ou telle molécule serait le champion. Je ne
dis pas que les thérapeutiques médicamenteuses ne sont pas nécessaires. À Trieste,
dans ces années fastes, on utilisait des médicaments. Dans notre travail de psychiatres
de secteur aujourd’hui, on fait appel aux médicaments. Mais, ils sont un des aspects
du soin parmi d’autres. Aujourd’hui on a tendance à adresser le malade à tel ou tel
4Dans le champ de la psychiatrie : L’Appel des Appels initié par Roland Gori ou le Collectif des 39.
L’INFORMATION PSYCHIATRIQUE VOL. 89, N◦7 - SEPTEMBRE 2013 575
Copyright © 2017 John Libbey Eurotext. Téléchargé par un robot venant de 88.99.165.207 le 24/05/2017.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%