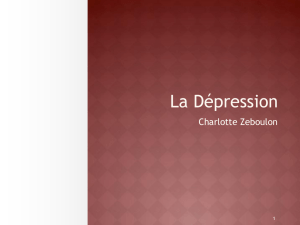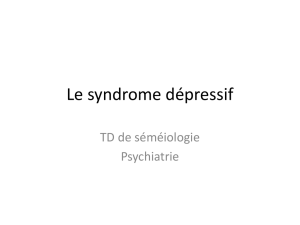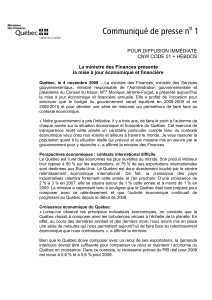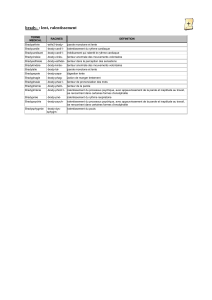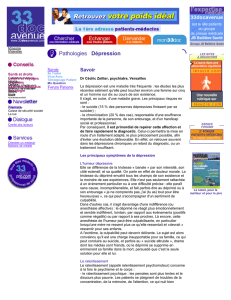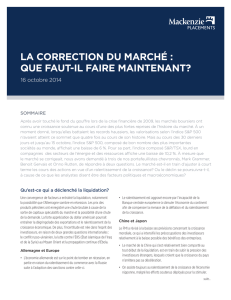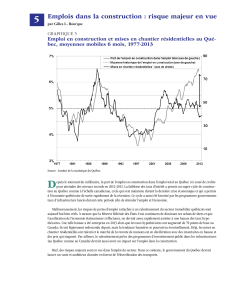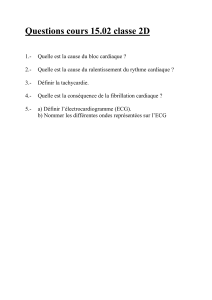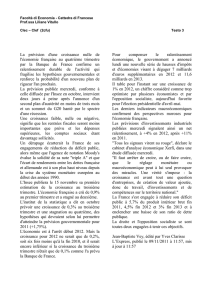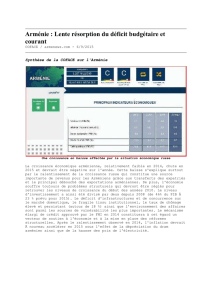Télécharger l`article au format PDF

Correspondance.
Adresse e-mail : [email protected] (M. Freton).
© L’Encéphale, Paris, 2012
L’Encéphale (2012) 38, S33-S36
Disponible en ligne sur www.sciencedirect.com
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
Les nouvelles formes du ralentissement dépressif
M. Freton
Service de Psychiatrie Adulte, Hôpital Pitié-Salpêtrière, 47-83, boulevard de l’Hôpital, 75651 Paris cedex 13, France
Le ralentissement dépressif est décrit depuis Hippocrate
et Arethée de Capadoce, qui le premier a décrit la stupeur
mélancolique, état de prostration avec une obtusion de
l’intelligence et des troubles du sommeil.
Le ralentissement dépressif peut être décrit de façon
dimensionnelle ou de façon catégorielle, et il constitue l’un
des signes cardinaux de la dépression ; il est l’un des 9 critères
de dépression du DSM-IV.
En 1983, Widlocher donnait comme défi nition : « le
ralentissement psychomoteur est une caractéristique des
actions humaines ; il s’articule avec d’autres conduites ou
d’autres caractéristiques des conduites pour réaliser un
comportement général qui constitue la condition dépressive ;
être déprimé, ce n’est pas être malade d’un trouble psycho-
logique ou physiologique dont le ralentissement serait un des
signes ; être déprimé, c’est être emprisonné dans un système
d’actions, c’est agir, penser et parler selon des modalités
dont le ralentissement constitue une caractéristique » [1].
Le ralentissement psychomoteur reste un concept diffi cile
à préciser. Il comprend des caractéristiques psychiques et
motrices : des troubles du discours, marqué par des pauses,
une diminution du tonus verbal, des réponses différées ; des
troubles des mouvements oculaires, avec un regard fi xe,
une pauvreté des contacts oculaires ; un ralentissement
global des mouvements des membres, du tronc, et de la
tête, avec trouble de la posture ; une augmentation des
auto-contacts, en particulier du visage ; enfi n, une expression
faciale appauvrie[2-5] (Tableau 1).
Spécifi cités du ralentissement dépressif
Deux approches se sont toujours opposées concernant la
compréhension de la dépression : on peut soit considérer
que le ralentissement est la conséquence de l’humeur
dépressive (l’absence d’action vient de la perte d’intérêt
ou de plaisir à l’action) ; soit considérer que la perception du
ralentissement psychomoteur, phénomène primaire, entraîne
un moindre intérêt ou un moindre plaisir à l’action.
Sur le plan symptomatique, le ralentissement représente
une inhibition généralisée, et se distingue ainsi de l’inhibition
anxieuse, plus localisée. Une symptomatologie d’agitation
dépressive peut être comprise comme complémentaire du
ralentissement, les auteurs décrivant un ralentissement axial
et une agitation périphérique.
Contrairement à une idée bien ancrée, les études cli-
niques ne permettent pas d’affi rmer de différence quant à
l’intensité du ralentissement entre les déprimés unipolaires
et les déprimés bipolaires. En revanche, la dépression avec
caractéristiques mélancolique s’accompagne d’un ralentis-
sement plus marqué [6].
De même, il n’existe pas de consensus dans la littérature,
pour considérer qu’il existe une corrélation entre sévérité
de la dépression et intensité du ralentissement, mais le
ralentissement apparaît absent dans les dysthymies, où la
symptomatologie dépressive est moins sévère [7].
Mesures du ralentissement dépressif
L’évaluation du ralentissement dépressif se fait de plusieurs
façons. La première est l’évaluation par l’observation cli-
nique (parole, marche…). La seconde repose sur l’utilisation
d’échelles générales de dépression (HAM-D, MADRS), qui
comprennent des items de ralentissement. La troisième
recourt à des échelles spécifi ques de ralentissement, comme
l’échelle ERD de Widlöcher [1] qui comprend 15 items
cotés de 0 à 4, évaluant les aspects cognitifs, moteurs et
verbaux du ralentissement, et dont l’étude de validation a
montré une structure factorielle à un facteur, représentant
60 % de la variance. Enfi n, en neuropsychologie, des tests
cognitifs et moteurs, explorant les fonctions exécutives, la
mémoire, l’attention, ont montré des corrélations entre le
défi cit de ces fonctions et l’importance du ralentissement
psycho-moteur.
Biologie du ralentissement dépressif
Si l’on fait, comme Widlöcher, l’hypothèse que le ralentis-
sement est rapporté à un mécanisme physiopathologique
unique, il faut identifi er le système cérébral en cause.

S34 M. Freton
Les différentes pistes de recherche dans ce domaine ont
évoqué :
• des dysfonctions des ganglions de la base et du cortex
préfrontal, hypothèse s’appuyant en particulier sur le fait
que des pathologies neurologiques, comme la maladie de
Parkinson ou la maladie de Huntington, qui impliquent ces
structures cérébrales, s’accompagnent d’un ralentissement ;
• des anomalies de l’axe hypothalamo-hypophyso-surré-
nalien, hypothèse reposant sur les travaux des années
1980 ayant montré une corrélation entre l’intensité du
ralentissement et l’échappement des taux de cortisol lors
du test à la dexaméthasone ;
• des anomalies des systèmes neuromédiateurs mono-
aminergiques, avec essentiellement des anomalies
dopaminergiques (diminution de la fi xation cérébrale de
la dopamine marquée chez les sujets ralentis), mais aussi
noradrénergiques ;
• des anomalies cognitives, soit par ralentissement global,
soit par défaut d’initiation, soit par défi cit de ressource
cognitive.
Ralentissement dépressif
et réponse aux antidépresseurs
Un grand nombre d’études ont cherché à évaluer si l’impor-
tance du ralentissement dépressif pouvait être prédicteur
d’une plus ou moins bonne réponse aux différents antidé-
presseurs, l’observation initiale étant celle d’une meilleure
réponse aux antidépresseurs des déprimés ralentis.
Concernant les antidépresseurs sérotoninergiques, les
résultats des études sont contrastés, les études plus récentes
ayant infi rmé les données des premières études qui faisaient
état d’une meilleure réponse chez les sujets ralentis.
Concernant les antidépresseurs tricycliques, trois études
sur cinq ont montré une valeur prédictive du ralentissement
sur la qualité de la réponse au traitement.
Concernant les IMAO, les données de la littérature sont
trop parcellaires pour que des conclusions soient tirées.
Les traitements biologiques non médicamenteux ont éga-
lement été évalués de la même façon : la plupart des études
montrent que le ralentissement psycho-moteur est prédictif
d’une meilleure réponse à l’électro-convulsivothérapie.
Retentissement fonctionnel du
ralentissement psycho-moteur
Le ralentissement psycho-moteur a un retentissement
fonctionnel important sur les différents domaines de
fonctionnement, qu’ils soient en rapport avec l’humeur, les
cognitions, ou les symptômes physiques (Fig. 1).
Le ralentissement psychomoteur :
un trouble multidimensionnel
Une étude de Milak [9] (Fig. 2) a étudié, chez près de 300 sujets
présentant un épisode dépressif majeur sans traitement vs
sujets contrôle, l’activité métabolique cérébrale (par mesure
Tableau 1 Caractéristiques du ralentissement psychomoteur. D’après [5].
Item Présentation des retards
moteurs
Évaluation par Références
Parole Augmentation des pauses,
diminution du volume,
diminution de l’articulation,
du ton et de l’infection,
réponses différées
Léger changement
– magnétophone et oscilloscope
Important changement –
observation par un clinicien
Greden et al. (1981),
Greden et Carroll (1981),
Greden (1993), Hary et al.
(1984), Sobin et Sackeim (1997),
Szabadi et al. (1976)
Mouvement
oculaire
Regards fi xes, pauvreté
des contacts oculaires
Léger changement – EOG
Changement brutal – observation
par un clinicien
Schmidt-Priscoveanu et Allum
(1999), Sobin et al. (1998),
Widlochez (1983)
Mouvement
des membres
Diminution et/ou
lenteur des mouvements
des mains, des jambes,
du torse et de la tête
Léger changement
– temps de réaction,
temps de réalisation d’un dessin
Changement brutal – observation
par un clinicien Important
changement – observation
par un clinicien
Bezzi et al. (1981),
Iverson (2004),
Parker et Hazi-Pavlovic (1996),
Sobin et al. (1998),
van Hoof et al. (1993),
Widlocher (1983)
Posture Chute en position assise
et debout
Observation par un clinicien Parker et Hazi-Pavlovic (1996),
Sobin et al. (1998),
Widlocher (1983)
Auto-contact Augmentation
des auto-contacts,
en particulier du visage
Observation par un clinicien Sobin et Sackeim (1997)
Expression
du visage
Expression faciale appauvrie Léger changement – EMG
Changement brutal – observation
par un clinicien
Greden et Carroll (1981),
Parker et Hazi-Pavlovic (1996),
Widlocher (1983)

Les nouvelles formes du ralentissement dépressif S35
des fl ux de glucose), en parallèle avec les scores à l’échelle
de dépression de Hamilton. Les auteurs ont ainsi retrouvé une
corrélation entre l’augmentation du métabolisme dans les
ganglions de la base et la sévérité de la dépression.
En utilisant l’analyse factorielle à 5 facteurs de la HAMD
(dépression psychique, perte de motivation, psychose,
anxiété et troubles du sommeil), les auteurs ont montré
une corrélation entre le score au facteur « perte de moti-
vation » et une diminution de l’activité métabolique du
cortex préfrontal dorsal, alors que le facteur « dépression
psychique » était corrélé avec une hyperactivité limbique
et sous-corticale.
Figure 2 Glass brain avec régions en volume. Cartes de corrélations entre l’activité métabolique de glucose relative régionale dans le
cerveau humain en dépression et la sévérité de la dépression mesurée par l’HDRS 24-item. En haut à gauche, score total de dépression.
En haut à droite, Facteur 1 : dépression psychique. En bas à gauche, Facteur 2 : perte de motivation. En bas à droite, Facteur 5 : trouble
du sommeil. Milak et al. [9].
Figure 1 Retentissement fonctionnel des symptômes dépressifs. D’après [8].
•Irritabilité
•Tristesse
•Anxiété
•Perte de plaisir
•Désespoir
•Conflit
•Imprévisibilité
émotionnelle
•Évitement
•Retrait social
•Perte de motivation
•Concentration
•Troubles
mnésiques
•Indécision
•Rumination
•Perte d’efficience
•Erreurs
•Mauvaises décisions
•Distractibilité
•Troubles
du sommeil
•Modification
de l’appêtit
•Perte d’énergie
•Fatigue
•Négligence
•Absentéisme
Symptômes Fonction
Humeur
Cognition
Physiques

S36 M. Freton
Recherches actuelles
sur le ralentissement psycho-moteur
Apathie et dépression
L’apathie est défi nie comme un défi cit des comportements
dirigés vers un but. Dans un travail de Levy et al. [10], les
auteurs ont étudié l’apathie selon trois aspects : l’apathie
affective, caractérisée par une perte d’intérêt, un émous-
sement affectif, une indifférence affective ; l’apathie
cognitive, caractérisée par une diffi culté à planifi er des
actions ; et l’apathie comportementale, caractérisée par
une diffi culté à initier des comportements.
L’apathie affective serait sous-tendue, sur le plan neuro-
biologique, par une dysfonction du cortex orbito-médial et du
striatum ventral ; l’apathie cognitive par une dysfonction du
cortex préfrontal dorso-latéral et des ganglions de la base
(noyau caudé) ; et l’apathie comportementale et motrice
par une dysfonction du cortex préfrontal médial.
Ruminations et dépression
Les travaux de Noelen Hoecksema ont permis de théoriser les
ruminations comme un style cognitif basé sur des processus
de pensées répétées, avec perte de fl exibilité cognitive [11].
Déclaration d’intérêts
M. Freton : conférences : invitations en qualité d’intervenant.
Références
[1] Widlöcher D. Le ralentissement dépressif. PUF, Paris, 1983.
[2] Fossati P, Ergis AM, Allilaire JF. Neuropsychologie des troubles
des fonctions exécutives dans la dépression unipolaire : une
revue de la littérature. Encephale 2002;28:97-107.
[3] American Psychiatric Association. Diagnosic ans statistical
manual of mental disorders. Fourth Ed., text revision. American
Psychiatric Association, Washington DC, 2000.
[4] Pelissolo A. Le ralentissement psychomoteur de la dépres-
sion. Expert Rev Neurotherapeutics. Edition Spéciale.
Décembre 2011.
[5] Buyukdura JS, McClintock SM, Croarkin PE. Psychomotor retar-
dation in depression: biological underpinnings, measurement,
and treatment. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry
2011;35:395-409.
[6] Parker G, Fink M, Shorter E, Taylor MA, Akiskal H, et al.
Issues for DSM-5: whither melancholia? The case for its
classifi cation as a distinct mood disorder. Am J Psychiatry
2010;167:745-7.
[7] Pier MP, Hulstijn BG. No Psychomotor slowing in fi ne motor
tasks in dysthymia. J Affect Disord 2004;83:109-20.
[8] Bender A. Depression in the Workplace: Response and
Recognition. Association des Médecins Psychiatres du Québec,
2006.
[9] Milak MS, Parsey RV, Keilp J, Oquendo MA, Malone KM, Mann
JJ. Neuroanatomic correlates of psychopathologic com-
ponents of major depressive disorder. Arch Gen Psychiatry
2005;62:397-408.
[10] Levy R, Dubois B. Apathy and the functional anatomy of the
prefrontal cortex-basal ganglia circuits. Cerebral Cortex
2006;16:916-28.
[11] Nolen-Hoeksema S, Wisco BE, Lyubomisky S. Rethinking rumi-
nation. Perspect Psychol Sci 2008;3:400-24.
1
/
4
100%