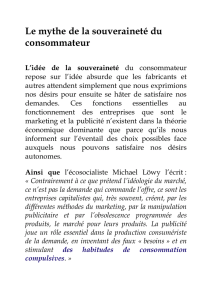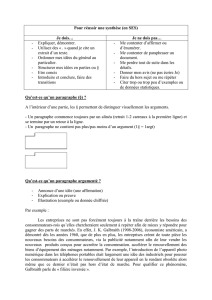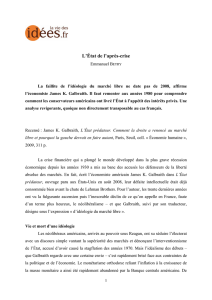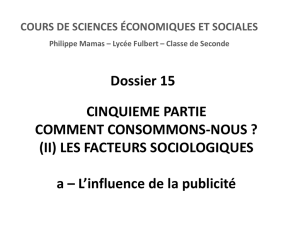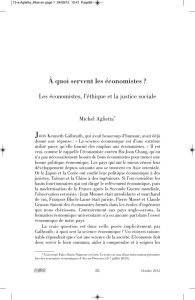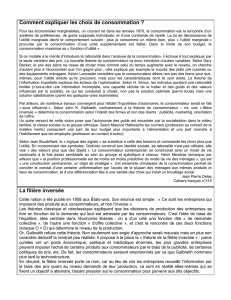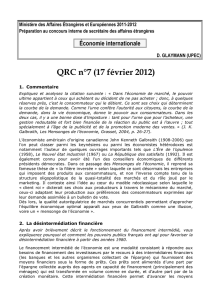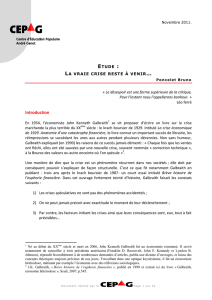Galbraith et la technostruc

Galbraith et la technostructure.
Les propriétaires du capital sont là pour la galerie. C'est la technostructure qui tire réellement les ficelles,
estime John Kenneth Galbraith, l'économiste américain qui ne dédaigne pas la provocation. Plongée dans
une approche qui refuse les abstractions.
Pour la plupart des gens, l'effort mental est quelque chose qu'il est exceptionnellement agréable d'éviter. " John Kenneth
Galbraith, manifestement, n'est jamais parvenu à s'accommoder de cette tendance qu'il croit déceler chez ses contemporains
(1). Aussi a-t-il multiplié les livres destinés à bousculer les certitudes assises qui ne reposent que sur une vision tronquée - "
instrumentale ", écrit-il (2) - du système économique et social dans lequel nous vivons, le capitalisme de cette deuxième
moitié du XXe siècle.
En fait, Galbraith utilise peu le terme de capitalisme. Il lui préfère " système industriel " ou " système planifié ". Prudence de
langage, dans un pays - les Etats-Unis - où l'on est qualifié de marxiste dès que l'on avance la moindre critique vis-à-vis de
l'économie de marché? Ce serait mal connaître notre homme, qui ne déteste pas l'art de la provocation. C'est en fait le signe,
plus fondamentalement, d'une volonté de souligner que le pouvoir économique, dans notre société, n'est plus exercé par le
capital ou par ceux qui le possèdent, mais par les organisations et ceux qui les font vivre: " Dans la société industrielle
moderne, le pouvoir de décision est exercé non par le capital, mais par l'organisation, non par le capitaliste, mais par le
bureaucrate industriel ", écrit-il dès les premières lignes de son livre majeur, Le nouvel Etat industriel (3).
Ne nous méprenons pas: l'organisation dont il est question déborde largement la direction générale des grandes firmes, les
managers salariés qui décident de la stratégie, les actionnaires comptant pour du beurre. Galbraith n'en disconvient pas: "
Seule une part minime des actions est effectivement représentée aux assemblées générales des actionnaires, lors de
cérémonies où les lieux communs ne le cèdent qu'aux faux-semblants. (...) La direction, malgré une participation négligeable
à la propriété de l'entreprise, a celle-ci bien en main: de toute évidence, elle détient le pouvoir. "
Galbraith, pourtant, élargit considérablement le propos. Le pouvoir de l'organisation n'est pas entre les seules mains de la
direction salariée. Celle-ci joue d'ailleurs largement un rôle illusoire, car la fonction directoriale n'est rien sans les multiples
compétences dont elle a besoin pour prendre les décisions cruciales: " Ceux qui occupent un rang élevé dans la hiérarchie
formelle d'une organisation - le directeur général de la General Motors ou de la General Electric - n'ont que des pouvoirs
modestes de décision autonome. Ces pouvoirs sont certainement moindres que la déférence conventionnelle qui les
entoure, leurs relations professionnelles, ou parfois leur vanité, ne voudraient le faire croire. "
Non, le pouvoir de l'organisation " consiste en l'association d'hommes doués de connaissances techniques, d'expériences et
de qualités différentes que requièrent la technologie et la planification moderne. Cette association elle-même s'étage depuis
la direction de l'entreprise industrielle jusqu'à un niveau à peine supérieur à celui de la force de travail et englobe des
effectifs nombreux et une large variété de qualifications ". Ce groupe social composé de nombreuses personnes situées à
des niveaux hiérarchiques différents, Galbraith l'appelle la technostructure.
Le pouvoir de la technostructure déborde largement les frontières de l'entreprise. Cette dernière, en effet, mobilise des outils
si coûteux et si complexes, met en oeuvre des processus de production si longs et des compétences si diversifiées qu'elle ne
peut se permettre un échec. On ne risque pas de tels investissements sans, au préalable, avoir réduit au maximum les
incertitudes du marché. Contrats d'approvisionnement à prix garantis passés avec les fournisseurs, voire prise de contrôle de
ces derniers, accords salariaux avec les syndicats, planification interne stricte, tout cela permet de déterminer les coûts,
donc les prix de vente, lesquels sont fixés par la firme, non par une hypothétique concurrence. Encore faut-il, cependant,
réduire la principale incertitude, celle qui concerne les débouchés: car si la demande n'est pas au rendez-vous ou ne l'est
pas de façon aussi importante qu'attendu, les prix fixés ne suffiront pas à assurer la rentabilité de l'investissement.
Le système industriel va donc agir sur la demande: " La production, non seulement passivement au moyen de l'émulation,
mais activement au moyen de la publicité et d'activités annexes, crée les désirs qu'elle cherche à satisfaire " (4). L'analyse
habituelle fait du consommateur le juge final de l'intérêt d'un produit: l'entreprise se plie aux décisions des individus, seuls
maîtres de leurs désirs. Balivernes, estime Galbraith. Le pouvoir de persuasion des firmes est trop grand, lorsqu'elles
mobilisent la publicité ou les mille et une façons d'influencer l'acheteur. L'appareil de production façonne les besoins et les
demandes des acheteurs, ces derniers se bornent à ratifier les décisions prises. Galbraith parle à ce propos de " filière
inversée ". Malignité? Non pas, simplement une contrainte imposée par la logique technologique: " La technologie avancée
et l'utilisation massive du capital ne sauraient être soumises au flux et au reflux de la demande de marché. "
Un américain social-démocrate.
Né en 1908, John Kenneth Galbraith est l'exemple même du non-conformiste. Libéral - c'est-à-dire de gauche dans la
terminologie américaine -, il se convertit au keynésianisme très tôt. Dans " Voyage dans le temps économique " (éd. du
Seuil, 1995), sorte d'autobiographie intellectuelle, il écrit que " l'un des premiers livres sérieux que j'ai lus sur l'économie
(...) fut celui de John Maynard Keynes ". " Les conséquences économiques de la paix ", publié en 1920. Enseignant en
économie agricole à Harvard, il est marqué par la crise (à laquelle il consacrera un livre intéressant, " La crise économique
Galbraith et la technostructure. par Denis CLERC - issu de n°135 Mars...
http://www.alternatives-economiques.fr/print_article2.php?lg=fr&id_p...
1 sur 3 14/09/2009 08:26

de 1929 ", traduit chez Payot): son premier livre (1938) est un plaidoyer en faveur de la réglementation de l'économie.
Pendant la guerre, il a la responsabilité de l'Office des prix et du rationnement. Il fut ensuite professeur à Princeton, puis à
Harvard. Proche de Kennedy, ce dernier fit de lui son ambassadeur en Inde, parce que Galbraith avait été un des premiers
à enseigner l'économie du développement (dès 1951) . Dans un texte récent publié dans la revue " Afrique 2000 ", il
procède à une intéressante autocritique des thèses auxquelles il adhérait alors en matière de développement. Lors de sa
nomination comme ambassadeur, il était en train d'achever son livre majeur, " Le nouvel Etat industriel ". Il écrit
plaisamment à ce propos: " J'étais tracassé à l'idée que le monde était en train d'échanger un auteur irremplaçable contre
un diplomate de modèle bien plus répandu. " Irremplaçable ? Bien que peu modeste, Galbraith a raison: dans le monde
universitaire américain, il est un des rares à avoir clairement choisi son camp: celui de la social-démocratie. A 87 ans, il
vient de publier son trentième livre. Il y écrit: " Aucune mesure fondamentale pour atténuer la pauvreté ou améliorer les
conditions de vie (...) n'est possible sans action de l'Etat, même s'il existe des arguments (...) pour prouver le contraire. Ces
arguments ne visent pas à faire avancer les choses, mais à épargner aux actuels privilégiés mauvaise conscience et
désagréables dépenses. " Toujours une langue et une plume acérées, ce Galbraith.
On voit donc le lien étroit que Galbraith établit entre technologie, planification et manipulation. Le système industriel a besoin
de consommateurs soumis et, en échange, il peut continuer à mettre au point des objets ou des services de plus en plus
complexes: " Un esprit libre peut détester cette évolution. Mais c'est à la cause qu'il doit s'en prendre. Il ne doit pas demander
que l'avion à réaction, les centrales nucléaires, ni même l'automobile moderne à son échelle actuelle sortent de firmes qui
s'accommodent de prix fluctuants et d'une demande organisée. Il doit demander qu'on n'en produise pas. " Les firmes
décident, en fonction de leurs critères propres, de ce qu'il convient de produire.
Leurs critères? Comme toute organisation, la technostructure a pour finalité de " persévérer dans l'être ", c'est-à-dire de se
maintenir, de prospérer et de se développer. Elle y parvient au prix de deux conditions. La première consiste à assurer aux
actionnaires des revenus suffisants pour qu'ils ne soient pas tentés de reprendre le pouvoir. Il s'agit, au fond, d'acheter leur
passivité. Le profit n'est pas le but, mais le moyen grâce auquel l'entreprise se procure les fonds dont elle a besoin pour son
expansion et les revenus nécessaires pour dédommager le capital. Le vrai but du système industriel c'est le développement
de la technostructure: la possibilité, pour chacun de ses membres, de poursuivre une carrière avec des revenus, des
pouvoirs et une considération sociale accrus. C'est pourquoi la technostructure vise avant tout la croissance économique.
A côté de l'organisation industrielle, Galbraith souligne - dans La science économique et l'intérêt général (5) - qu'il existe un
ensemble beaucoup plus important d'entreprises, de taille petite ou modeste, soumises aux lois du marché. Elles ne
contrôlent pas leurs prix et dépendent d'une demande qu'elles ne maîtrisent pas. Dans l'ensemble, les revenus, les salaires
et le pouvoir de ces entreprises sont bien moindres. S'instaure ainsi une inégalité structurelle au sein du système productif.
Pis: la technostructure se soucie comme d'une guigne du sort de ceux qui, faute de compétences, de formation ou de
chance, ne parviennent pas à se faufiler au sein des organisations complexes qui dominent la société et la modèlent.
Dans une analyse plus récente (6), Galbraith avance que " notre économie a besoin de pauvres pour faire les travaux que
les mieux lotis ne font pas et qui, manifestement, leur paraîtraient désagréables ". Pour les nantis - les membres de la
technostructure, mais aussi les détenteurs du capital qui, s'ils n'ont plus le pouvoir, ont encore le patrimoine - quoi de plus
agréable que de se dire que l'on doit sa réussite à son intelligence ou à ses dons, et quoi de plus rassurant que d'attribuer la
pauvreté ou l'exclusion des autres à leurs propres tares?
Ce n'est pas la seule conséquence négative du système industriel. On déploie des trésors d'imagination pour vous
convaincre de changer votre voiture tandis que certains sont sans logis, que l'air devient irrespirable et que les écoles sont
démunies de moyens. Dans L'ère de l'opulence, Galbraith analyse longuement ce divorce choquant qui fait passer le
superflu avant le nécessaire. Il y voyait alors l'indice de la toute-puissance du système industriel. Dans ses derniers écrits, il
y voit davantage l'influence des groupes sociaux favorisés qui craignent comme la peste les impôts, puisqu'ils financent des
dépenses dont ils ne sont pas bénéficiaires ou pas les seuls. La seule exception à cette réticence à payer concerne les
dépenses militaires, puisqu'elles se traduisent par des commandes de joujoux technologiques toujours plus complexes que le
système industriel souhaite continuer à fabriquer.
Sans doute, cette analyse n'est-elle pas sans défaut. Galbraith prête à la technostructure - un concept qui, finalement, ne se
sera pas imposé - un pouvoir excessif. Les années 80 ont vu la revanche des propriétaires et des actionnaires: aux
Etats-Unis au moins, on ne compte plus les dirigeants salariés qui ont été remerciés ou délogés par des raiders pour n'avoir
pas réussi à maximiser les profits. Les consommateurs ne sont vraisemblablement pas aussi malléables et influençables que
notre auteur le pense, les firmes n'ont pas forcément cette capacité persuasive qu'il leur attribue. En mettant en avant le
souci de planification des grandes entreprises et l'effacement relatif du profit comme mobile dominant, Galbraith a conclu,
sans doute un peu vite, à une forme de " socialisme rampant ": " L'entreprise moderne n'est plus subordonnée au marché;
ceux qui la dirigent ne doivent plus leur autorité à la propriété privée. (...) Pour les tâches d'une grande complexité technique
le système industriel se confond avec l'Etat. " Là encore, la montée du libéralisme, l'effondrement du socialisme réel, la crise
des organisations publiques apportent un démenti à ces appréciations à l'emporte-pièce.
Tout cela, cependant, ne doit pas masquer l'essentiel: à savoir la dénonciation d'une science économique coupée du réel,
privilégiant des abstractions dont la finalité ultime est souvent de justifier ce qui existe et d'empêcher que le doute, la critique
Galbraith et la technostructure. par Denis CLERC - issu de n°135 Mars...
http://www.alternatives-economiques.fr/print_article2.php?lg=fr&id_p...
2 sur 3 14/09/2009 08:26

ou la réflexion sur le sens d'une société ne viennent perturber les délicats équilibres du système économique concret. Joan
Robinson écrivait, à propos d'Alfred Marshall, qu'il " était certainement un grand moralisateur, mais d'une façon ou d'une
autre sa morale revenait toujours à ceci que tout ce qui est, est à peu de choses près le meilleur " (7). John K. Galbraith, à
propos du même Marshall, indique (8) qu'il " remarquait qu'un économiste devait par-dessus tout craindre les
applaudissements ". Galbraith a sans doute reçu plus de coups que d'applaudissements: peut-être parce qu'il ne parvenait
pas à se persuader, au contraire de la majorité de la profession, que notre système économique est le meilleur de ce qui est
possible.
Denis CLERC
Alternatives Economiques - n°135 - Mars 1996
Notes
(1)
La République des satisfaits, éd. du Seuil, 1993, p. 71.
(2)
Il s'agit, précise-t-il, " non pas [de] faire connaître ou [d'] améliorer le système économique mais [de] servir les fins de
ceux qui disposent du pouvoir à l'intérieur du système " (La science économique et l'intérêt général, éd. Gallimard,
1974, p. 23). Et il ajoute: " Les économistes ne se font pas délibérément les serviteurs de l'intérêt économique. (...)
Comme les autres mortels, les économistes sont instinctivement attirés par ce qui est sûr, sérieux et estimable, et c'est
essentiellement en nous montrant ce qu'ils ont de sérieux et d'estimable que les intérêts économiques assurent leur
prédominance. "
(3)
La première traduction de ce livre est parue chez Gallimard en 1968. Une nouvelle édition, revue et augmentée, a été
publiée en 1974 et une troisième, encore revue, en 1989. Nous nous appuyons, dans ce qui suit, sur la deuxième
édition et, sauf indication contraire, les phrases de Galbraith citées dans le texte sont tirées de cette édition.
(4)
L'ère de l'opulence, publié en 1958, traduit en 1961 (nouvelle édition augmentée en 1970) chez Calmann-Lévy. La
citation figure p. 172 de cette nouvelle édition.
(5)
Publié en 1973 et traduit en 1974 aux éd. Gallimard.
(6)
La République des satisfaits, op. cit., p. 42.
(7)
Philosophie économique, éd. Gallimard, 1967, p. 120.
(8)
L'économie en perspective, éd. du Seuil, 1989, p. 146.
Galbraith et la technostructure. par Denis CLERC - issu de n°135 Mars...
http://www.alternatives-economiques.fr/print_article2.php?lg=fr&id_p...
3 sur 3 14/09/2009 08:26
1
/
3
100%