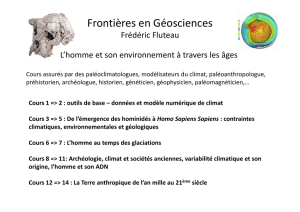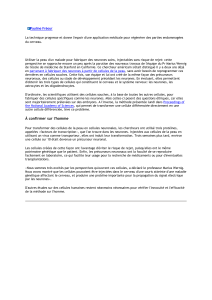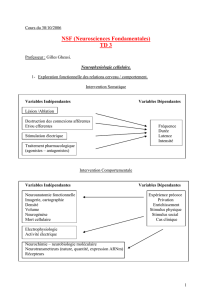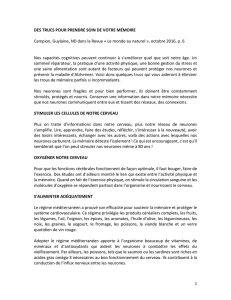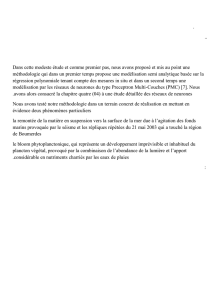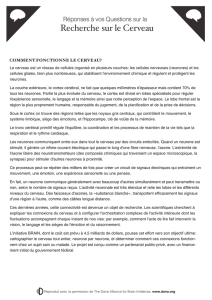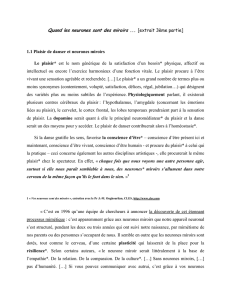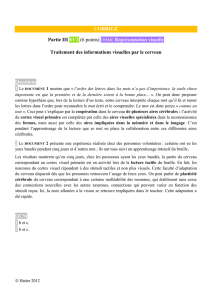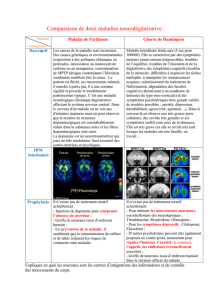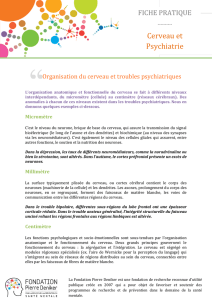Langage et Cerveau Le nez dans le moteur Psycholinguistique

1
Langage et Cerveau
Laboratoire de Psychologie Cognitive,
Pôle 3C, Marseille
Xavier Alario
Jonathan Grainger
Marie Montant
Johannes Ziegler
Le nez dans le moteur
Psycholinguistique et Cerveau
Marie Montant
Laboratoire de Psychologie Cognitive
Marseille
Psycholinguistique
• Étudie le langage en terme de traitement
de l’information.
• Stimulus -> boîte noire -> réponse
représentation
Psycholinguistique
• Étudie le langage en terme de traitement
de l’information.
• Stimulus -> boîte noire -> réponse
• Comment les mots sont perçus, appris,
reconnus, stockés puis rappelés,
assemblés et produits.
La psycholinguistique a-t-elle
besoin du cerveau ?
Cerveau ou genou, quelle différence ?
La psycholinguistique a-t-elle
besoin du cerveau ?
Traditionnellement, les psycholinguistes ne
s’intéressent pas :
à l’implémentation du langage dans le cerveau
à la phylogenèse du langage
à l’ontogénèse du langage

2
La psycholinguistique a-t-elle
besoin du cerveau ?
Selon Fodor (1975, 1983), parler c’est manipuler des
symboles (influence des linguistes), cad des
informations
abstraites
amodales
arbitraires
désincarnées
Langage et Cerveau :
Principes
• Le langage est incarné (dans le cerveau)
• Le cerveau est plastique (il apprend et oublie)
• Le cerveau est économe (exploitation
neuronale)
• Le cerveau et le langage sont le produit de
l’évolution
Phylogenèse du langage
• Le langage de H. sapiens est unique.
(critères de Hocket)
• Mais l’évolution est conservatrice, elle aime
la continuité : évolution de l’encéphale
Définition du langage
Critères de Charles Hockett
1. Canal auditif/oral
2. Signal transitoire : Il s’efface rapidement.
Ce n’est pas le cas de la communication colorée des
oiseaux.
3. Interchangeabilité : l’utilisateur peut
produire et comprendre les mêmes
signaux (parité).
Ce n’est pas le cas de la communication proie/prédateur
(couleurs du papillon qui indiquent sa toxicité), ni des
oiseaux ou des criquets chez lesquels seuls les mâles
chantent.
4. Feedback total : l’émetteur peut contrôler
son signal à chaque instant.
Ce n’est pas le cas du langage corporel
(rouge aux joues). Ce n’est pas le cas non
plus des seiches qui communiquent par la
couleur (contrôle hormonal).
5. Spécialisation : pas d’autres fonction
biologique que la communication.
Ce n’est pas le cas de la femelle chimpanzé
dont le derrière rose indique qu’elle est prête
à s’accoupler.
6. Sémantique : le signal réfère à des
parties du monde et non pas à lui-même.
(comme c’est le cas du derrière rose)
7. Arbitrarité : le signal est physiquement
sans relation avec sa signification.
Le mot « poule » n’est acoustiquement pas
proche de son objet. Le même objet est
représenté par des signaux différents dans
les différentes langues (exception : les
onomatopées)

3
8. Déplacement : le langage peut faire
référence à des objets distants
spatialement ou temporellement
(donc
physiquement absents au moment de
l’émission).
9. Transmission : le langage s’apprend au
contact de ses pairs.
Ce n’est pas le cas de la plupart des espèces
animales chez lesquelles la communication
est innée (innée ne veut pas dire présente à
la naissance).
10.Discrétion : le langage est composée
d’unités plus petites que les mots. Ces
unités peuvent être combinées pour former
différents mots. C’est un système
combinatoire.
permet d’apprendre un nombre limité d’unités
et de produire un nombre infini de messages
différents.
Chez les autres animaux, on trouve entre 12 et 35
messages différents max.
11. Prévarication : permet de mentir,
d’imaginer des choses qui n’existent pas
(licornes).
Aucun animal ne se sert du langage pour
inventer des choses qui n’existent pas mais
certains savent mentir (théorie de l’esprit).
Phylogenèse du langage
• Le langage de H. sapiens est unique.
(critères de Hocket)
• Mais l’évolution est conservatrice, elle aime
la continuité : évolution de l’encéphale
• Striedter (2005) : Le néocortex n’est pas
une invention des mammifères. Il provient
de la transformation du cortex dorsal des
reptiles.
• Huxley (1963) : un changement mineur
(non encore détecté) de l’anatomie
cérébrale est à l’origine du langage.
L’évolution est conservatrice

4
• Forte corrélation + entre taille néocortex et
nombre d’aires corticales.
->Pourtant, pas d’aire corticale nouvelle chez H.
sapiens par rapport aux autres primates
• BA 44 et 45 trouvent leurs homologues
chez le macaque.
L’évolution est conservatrice L’évolution est conservatrice
Striedter, 2005
Les aires de Brodmann (BA 44, 45) trouvent leurs
homologues chez le macaque
L’évolution est conservatrice…
mais elle accélère
L’évolution est conservatrice…
mais elle accélère
• En 5 MA, entre Toumaï et H. habilis,
l’encéphale double de volume
(350 -> 700 cm3).
• En 2 MA, entre H. habilis et H. sapiens,
l’encéphale double à nouveau de volume.
mm1
• Rapport néocortex/medulla = 30/1 pour les
chimpanzés contre 60/1 chez H. sapiens
• Certaines aires pré-frontales et temporales
sont plus grandes chez H. sapiens que
chez les autres primates.
L’évolution est conservatrice…
mais elle accélère Aires primaires vs associatives
Aires auditives Aires visuelles Aires motrices
somatosensorielles

Slide 22
mm1
augmentation avec des plateaux, voir Striedter p316
marie montant; 08/10/2007
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%