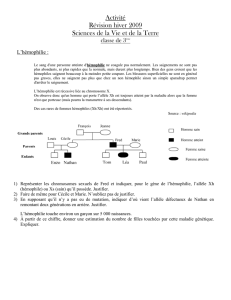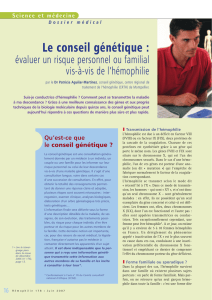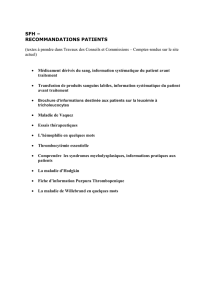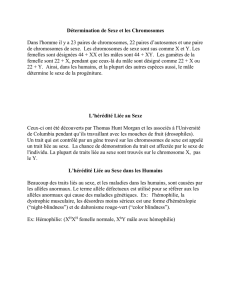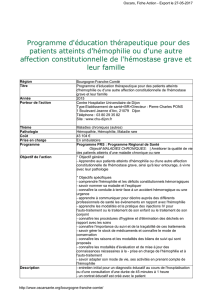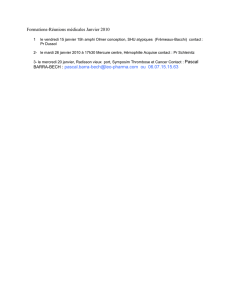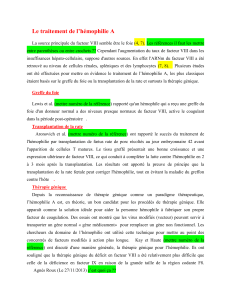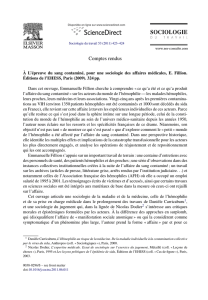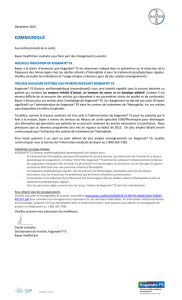Le conseil génétique - Association Française des Hémophiles

Dossier médical
16
Hémophilie 178
•
Juin 2007
Science et médecine
Transmission de l’hémophilie
L’hémophilie est due à un déficit en facteur VIII
(FVIII) ou en facteur IX (FIX), deux protéines de
la cascade de la coagulation. Chacune de ces
protéines est synthétisée grâce à un gène qui
porte le même nom. Les gènes FVIII et FIX sont
situés sur le chromosome X, qui est l’un des
chromosomes sexuels. Dans le cas d’une hémo-
philie, l’un de ces gènes est porteur d’une ano-
malie (on dit « mutation ») qui l’empêche de
fabriquer normalement le facteur de la coagula-
tion correspondant.
L’hémophilie se transmet selon le mode dit
« récessif lié à l’X ». Dans ce mode de transmis-
sion, les hommes – qui sont « XY », et n’ont donc
qu’un seul chromosome X – sont généralement
malades : en effet, ils ne possèdent qu’un seul
exemplaire du gène concerné et celui-ci est défi-
cient. Les femmes ont, elles, deux chromosomes
X (XX), dont l’un est fonctionnel et l’autre pas :
elles sont appelées transmettrices ou conduc-
trices. Très exceptionnellement cependant, une
femme peut être hémophile1. A ce jour, on estime
qu’il y a environ de 5 à 10 femmes hémophiles
en France. Un dérèglement du phénomène
appelé « inactivation de l’X » est le plus souvent
en cause dans ces cas, conduisant à une inacti-
vation préférentielle du chromosome X fonc-
tionnel et empêchant ce dernier de compenser
l’effet du chromosome porteur du gène déficient.
Forme familiale ou sporadique ?
Dans la plupart des cas, l’hémophilie survient
dans une famille où existent plusieurs sujets
porteurs : on parle de forme familiale. Mais par-
fois, on ne retrouve qu’un seul garçon hémo-
phile dans toute la famille : c’est une forme dite
Le conseil génétique :
évaluer un risque personnel ou familial
vis-à-vis de l’hémophilie
par le Dr Patricia Aguilar-Martinez, conseil génétique, centre régional de
traitement de l’hémophilie (CRTH) de Montpellier.
Suis-je conductrice d’hémophilie ? Comment peut se transmettre la maladie
à ma descendance ? Grâce à une meilleure connaissance des gènes et aux progrès
techniques de la biologie moléculaire depuis quinze ans, le conseil génétique peut
aujourd’hui répondre à ces questions de manière plus sûre et plus rapide.
Qu’est-ce que
le conseil génétique ?
Le conseil génétique est une consultation généra-
lement donnée par un médecin à un individu, un
couple ou une famille pour les informer sur leur
risque personnel ou celui de leur descendance
vis-à-vis d’une maladie génétique. Il s’agit d’une
consultation longue, voire dans certains cas
d’une succession de consultations. En effet, pour
obtenir la totalité des renseignements permet-
tant de donner une réponse claire et adaptée,
plusieurs étapes sont souvent nécessaires : inter-
rogatoire, examen clinique, analyses biologiques,
élaboration d’un arbre généalogique très précis,
tests génétiques…
L’information finale sera délivrée sous la forme
d’une description détaillée de la maladie, de ses
signes, de son évolution, des traitements possi-
bles, du risque pour chaque individu d’en être
porteur et du risque pour les autres membres de
la famille. Cette dernière notion est importante,
car, pour des raisons de secret médical, la législa-
tion, française n’autorise pas le médecin à
contacter directement les apparentés d’un sujet
atteint. Il est donc indispensable que la per-
sonne qui a reçu une information généti-
que transmette cette information aux
autres membres de sa famille et les incite
à consulter à leur tour*.
1• Lire le témoi-
gnage paru
dans la revue
de décembre
2006 (n° 176),
page 13.
* Conformément à l’avis n° 76 du Comité consultatif
national d’éthique (CCNE).
AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 16

dossier
17
Hémophilie 178
•
Juin 2007
« sporadique » (voir le schéma de la transmission
page19). Dans ce cas, on ne peut pas être sûr
que la mère de l’hémophile est conductrice,
c’est-à-dire porteuse dans ses gènes de l’anoma-
lie moléculaire sur le FVIII ou le FIX. Il est pos-
sible en effet que l’anomalie soit survenue chez
l’hémophile lui-même (mutation « de novo »). Pour
le savoir, il faudra s’aider d’analyses génétiques.
La consultation de génétique
Les motifs de consultation de génétique pour
une hémophilie sont divers, mais deux grandes
questions dominent pour une jeune femme :
celle de savoir si elle est conductrice, et, lorsque
ce diagnostic a été posé avec certitude, la
demande éventuelle d’un diagnostic prénatal.
Ces deux questions sont souvent liées, mais pas
toujours : cela dépend beaucoup du vécu per-
sonnel de la jeune femme, de l’existence de cas
familiaux d’hémophilie et de leur lien de
parenté avec elle. Souvent, lorsque l’hémophile
est un parent éloigné, la demande est plus
vague.
Le diagnostic des conductrices
Dans la majorité des cas, la jeune femme sou-
haite savoir si elle est ou non conductrice. Ce
diagnostic est de difficulté variable. L’arbre
généalogique peut suffire à rassurer une jeune
femme en écartant le risque pour elle d’être
conductrice d’une hémophilie familiale, par
exemple lorsque l’hémophilie est clairement
transmise dans la branche paternelle, le père de
la jeune femme étant lui-même indemne.
Lorsque l’hémophilie est présente dans la bran-
che maternelle ou que le père est hémophile, et
que le dosage des facteurs de la coagulation
montre un taux abaissé, le diagnostic de
conductrice peut aussi être aisément porté.
Dans les autres cas, c’est souvent plus compli-
qué. On pourrait en effet s’attendre à ce que
toutes les conductrices fabriquent environ 50 %
du taux normal de FVIII ou de FIX. En fait, ce
n’est pas toujours le cas : certaines conductrices
peuvent avoir un taux normal de facteur ou, au
contraire, un taux très bas (lire l’encadré). Il faut
alors avoir recours à l’analyse moléculaire des
gènes pour trancher.
L’étude génétique dans l’hémophilie
L’étude moléculaire des hémophilies a connu
plusieurs bouleversements, liés d’une part à la
découverte des inversions sur le gène FVIII et,
d’autre part, aux progrès techniques dans le
Conductrices :
ce qu’il faut savoir
On peut être conductrice tout en ayant un
taux normal de facteur VIII ou IX ou en
ayant au contraire un taux très bas, sans
que cela soit corrélé avec le degré de
sévérité de l’hémophilie dans la famille.
Ainsi, une minorité de conductrices d’hé-
mophilie ont un taux de facteur VIII ou IX
inférieur à 30 % et peuvent présenter des
signes cliniques : bleus, règles abondantes
ou hémorragiques…
Il est conseillé à toute femme ayant un
hémophile dans sa famille de consulter un
centre de traitement de l’hémophilie ou une
consultation de génétique pour évaluer son
risque hémorragique personnel et les possi-
bilités de transmission à sa descendance.
Pour rappel, sont conductrices de façon cer-
taine : les filles d’hommes hémophiles, les
mères de plusieurs enfants hémophiles et les
mères d’un enfant hémophile dans une
famille comptant déjà un hémophile connu.
Pour plus d’informations, lire la revue de
décembre 2006 (n° 176), pages 10 à 13.
L’information sur les
possibilités d’un diag-
nostic prénatal doit
être donnée au couple,
car la décision d’y avoir
recours ou non revient
conjointement aux
deux futurs parents.
AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 17

Science et médecine
Dossier médical
18
Hémophilie 178
•
Juin 2007
domaine du séquençage. Il y a quinze ans, le
diagnostic génétique d’hémophilie A s’effectuait
essentiellement par une méthode dite « indirecte »
dont les conclusions ne pouvaient être certaines.
En 2007, il est possible dans la majorité des cas
d’identifier l’anomalie responsable sur le gène
FVIII ou FIX, ce qui permet un diagnostic dit
« direct » chez les conductrices.
Il est important, avant d’entreprendre cette ana-
lyse, de disposer d’un dossier complet avec un
arbre généalogique, des informations fiables sur
le ou les hémophile(s) de la famille (gène atteint,
sévérité de l’hémophilie, etc.). En effet, ces
informations conditionnent le type d’analyse.
Dans le cas d’une hémophilie A sévère (FVIII
< 1 %), on cherchera en première intention une
inversion de l’intron 22 (50 % des cas) ou de
l’intron 1 (5 % des cas). Ces deux anomalies sont
de gros réarrangements du gène FVIII qui le
détruisent et le rendent impropre à la synthèse
de facteur VIII. Il s’agit d’anomalies dites
« récurrentes » : on les observe chez de nom-
breux hémophiles non apparentés car elles peu-
vent survenir « de novo ». Lorsque ces anomalies
sont absentes chez un hémophile sévère, il faut
rechercher une « mutation ponctuelle », c’est-à-
dire une anomalie de petite taille, qui nécessite
une exploration laborieuse de tout le gène FVIII.
De même, dans le cas d’une hémophilie modérée
(2 % < FVIII > 5 %) ou mineure (6 % < FVIII
< 30 %), la cause est habituellement une muta-
tion ponctuelle.
Les hémophilies B sont majoritairement dues à
de petites mutations ou réarrangements, mais,
ce gène étant plus petit que celui du FVIII, son
étude est plus simple.
Envisager une grossesse…
Lorsque le diagnostic de conductrice d’hémo-
philie sévère est établi chez une jeune femme,
celle-ci peut demander à faire pratiquer un
diagnostic prénatal (DPN) lors d’une grossesse.
Cependant, cette demande dans le cadre d’une
hémophilie est relativement rare (pas plus de
trois ou quatre par an dans un CHU comme celui
de Montpellier). Le diagnostic prénatal est une
pratique médicale très réglementée en France. Il
ne peut être envisagé que si l’enfant à naître
présente un risque important d’être porteur
d’une affection d’une « particulière gravité ». En
pratique, il ne peut concerner que les hémophi-
lies sévères.
Comme nous l’avons évoqué, la demande est
très dépendante du vécu familial de chaque
conductrice, ainsi que de son conjoint. Certaines
jeunes femmes viennent simplement s’informer
et affirment d’emblée qu’elles ne souhaitent pas
avoir recours au DPN. Dans tous les cas, il faut
dialoguer longuement avec les couples, car par-
fois on se rend compte qu’une demande de DPN
n’a d’autre but que le fait de « savoir », le cou-
ple n’ayant aucun souhait d’interrompre la
grossesse en cas de diagnostic de garçon hémo-
phile. Dans ce cas, il faut bien faire comprendre
que le DPN n’a aucun intérêt s’il s’agit d’une
simple « curiosité », et que, au contraire, il peut
faire courir un risque inutile à la grossesse. Il
sera simplement indispensable de prévoir un
accouchement non traumatique en milieu spé-
cialisé. Le diagnostic chez le petit garçon sera
effectué après la naissance. Pour d’autres cou-
ples, la demande de DPN est en revanche immé-
diate et irréversible. Enfin, dans de très rares
cas, l’incertitude du couple est impossible à
dépasser avant le résultat du DPN lui-même.
Le diagnostic prénatal (DPN)
Comme le diagnostic de conductrice, le diagnos-
tic prénatal a bénéficié ces dix dernières années
des progrès dans la connaissance des gènes ainsi
que d’améliorations des gestes et des techni-
ques. Une meilleure information des conductri-
ces et des médecins a également limité les cas de
demande tardive de DPN.
De manière idéale, la première consultation a
lieu dès que la grossesse est confirmée chez une
conductrice obligatoire connue chez laquelle
l’anomalie moléculaire responsable a préalable-
ment été identifiée. Il est alors possible de pro-
poser la stratégie actuelle, très « allégée » par
rapport à ce qui était pratiqué auparavant. Le
progrès majeur dans ce domaine est venu de la
possibilité depuis quelques années de réaliser un
diagnostic de sexe fœtal sur une simple prise de
sang maternel. Cette technique recherche dans
le sang de la mère de l’ADN provenant du chro-
mosome Y d’un éventuel garçon et permet
d’identifier ainsi le sexe du fœtus. Si le fœtus
est une fille, le DPN s’arrête à ce stade. Si c’est
un garçon, il sera nécessaire d’avoir recours
1984 • Identification des gènes FVIII et FIX
1993 • Identification de l'inversion de l'intron 22 du gène FVII
2001 • Identification de l'inversion de l'intron 1 du gène FVIII
• Diagnostic « de sexe fœtal sur sang maternel »
Quelques dates clés
AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 18

dossier
19
Hémophilie 178
•
Juin 2007
à un prélèvement de « villosités choriales »
(vers 11 semaines d’aménorrhée [SA]) ou éven-
tuellement de liquide amniotique (entre 13 et
16 SA). La confirmation de l’hémophilie peut
être obtenue dès la 12eou la 13esemaine.
L’utilisation de cette nouvelle stratégie a réduit
de moitié le nombre de ponctions nécessaires et
constitue donc une amélioration considérable.
Le diagnostic pré-implantatoire (DPI)
Pour certains couples qui ne souhaitent pas
envisager de diagnostic prénatal pour des rai-
sons éthiques ou religieuses, ou qui l’ont vécu
douloureusement (plusieurs DPN avec enfant
atteint en particulier), il existe une alternative,
le diagnostic pré-implantatoire (DPI). Celui-ci
est autorisé en France depuis 2000 et trois
centres sont en mesure d’effectuer ce type de
prouesse technologique : Paris, Strasbourg et
Montpellier. C’est une démarche complexe et
individuelle qui nécessite une forte implication
de la part du laboratoire qui réalise l’analyse,
car il devra mettre au point une méthode adap-
tée à chaque cas, mais également de la part du
couple, puisque la stratégie est basée sur des
méthodes de fécondation in vitro. Il faut savoir
qu’un délai de dix-huit mois à trois ans est en
moyenne nécessaire pour aboutir à une gros-
sesse. Le DPI demeure donc, pour l’instant, une
méthode réservée à des cas particuliers2.
Conclusion
La pratique du conseil génétique de l’hémophi-
lie a radicalement changé au cours des quinze
dernières années, avec l’évolution des techni-
ques de biologie moléculaire autorisant un
diagnostic de conductrice fiable. Les progrès
techniques ont également considérablement
simplifié le diagnostic prénatal. Le diagnostic
pré-implantatoire est une alternative au DPN,
mais demeure une démarche lourde et encore
peu répandue.
2• Sur le DPI, lire
l’interview du Pr René
Frydman dans le n° 168
(novembre 2004),
pages 16-17.
Forme sporadique (1 famille sur 3) Forme familiale (2 familles sur 3)
La commission
« Femmes et hémophilie »
de l’AFH
accueille et informe toutes les femmes
concernées de loin ou de près par
l’hémophilie et la maladie de Willebrand.
Contact :
Murielle Pradines au 04.74.05.11.05
ou par e-mail :
AFH_Revue_178 14/06/07 17:28 Page 19
1
/
4
100%