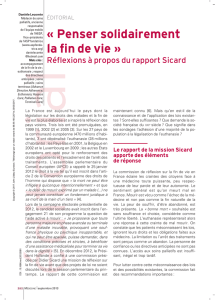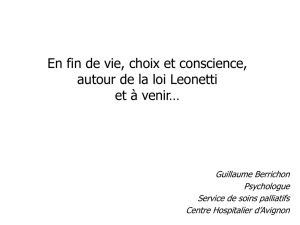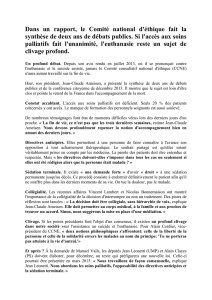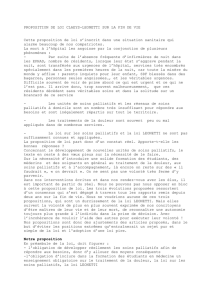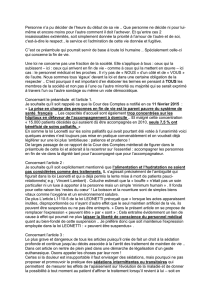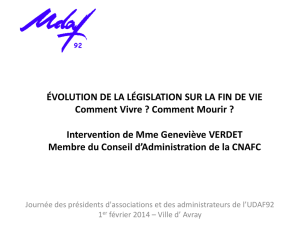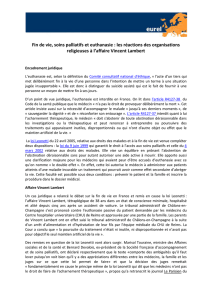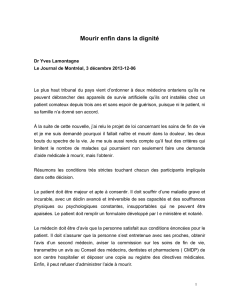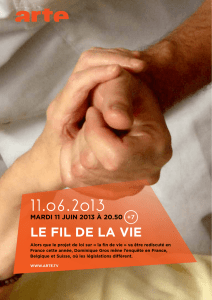Philippe Bataille, sociologue, directeur d`études à l`Ecole des hautes

Philippe Bataille, sociologue, directeur d’études à l’Ecole des hautes études en sciences
sociales a mené une enquête pendant plusieurs années dans différentes unités de soins
palliatifs en France. Le fruit de ce travail vient d’être publié au travers du livre A la vie, à
la mort (éditions Autrement). Dans cet ouvrage émaillé d’exemples, le sociologue dénonce
“le palliativisme” des soignants et leur manque d’écoute des patients en fin de vie. Il
déplore également la mauvaise application de la loi Leonetti et place beaucoup d’espoir
dans le travail de la commission Sicard mandatée par François Hollande pour réfléchir à la
fin de vie.
Egora.fr : Pourquoi un ouvrage sur l’euthanasie et les soins palliatifs ?
Philippe Bataille : J’ai beaucoup travaillé sur le cancer en publiant des travaux, de longues
enquêtes depuis une dizaine d’années. Ces écrits, d’une manière générale, sont portés par la
thématique du droit des malades ou en tous cas de l’introduction forte de ce qu’on a appelé il
y a 10 ans, la parole du malade dans la relation médicale. En suivant des malades du cancer
sur plus d’une décennie, on arrive à un moment ou un autre en activité palliative.
A côté de cela, je participe depuis 2002 à une expérience en tant que membre du Centre
d’éthique clinique de l’Hôpital Cochin. Là on ne travaille pas du tout sur l’expérience de la
maladie mais plutôt sur des attentes d’euthanasie qui viennent se télescoper avec le cadre de la
loi. Sur plusieurs années, au travers des activités de ce Centre j’ai vu comment étaient traitées
les demandes d’aide à mourir depuis la loi Chevènement / Kouchner en 2002, en passant par
la loi Leonetti de 2005 et jusqu’à aujourd’hui. Dans le livre, l’aborde toutes sortes de
situations, tout aussi invraisemblables et douloureuses les unes que les autres. Celle d’un
enfant de 2 ans dont la mère réclame que tout s’arrête après beaucoup d’efforts en réanimation
ou encore celle d’un homme qui se retrouve locked-in syndrom après un accident vasculaire.
Enfin, celles de malades qui ont avancé dans le parcours de soins. Ils se sont mobilisés pour se
soigner avec beaucoup d’espoir et d’investissement mais arrivés à la fin de ce parcours, ils
refusent de s’enfermer dans une espèce d’acharnement thérapeutique.
Vous dénoncez dans votre livre le “palliativisme”, qu’est-ce que cela signifie ?
Il n’y a pas de définition unique du palliativisme, c’est pour cela que j’ai écrit ce livre. La
palliativisme n’est pas, ce que beaucoup de gens ont compris, une dérive des soins palliatifs.
Je pense au contraire qu’il est à l’origine du succès des soins palliatifs. Le palliativisme, c’est
l’intention de développer à l’intérieur des organisations sanitaires et du champ de la médecine
une forte conscience de ne pas s’enfermer dans l’acharnement thérapeutique, de ne pas
abandonner son patient et de ne pas pratiquer l’euthanasie. Et cela, peu importe leur situation,
qu’ils soient en demande d’euthanasie ou qu’il s’agisse du malade épuisé qui arrive en fin de
course. Tout ce que la médecine propose est ce que l’on appelle le laisser mourir. L’objectif
est de ne jamais être à l’origine de la mort au sens de l’intention médicale. La loi Leonetti
réalise cette intention et elle créée de nouveaux problèmes.
Vous vous êtes exprimé dans la presse concernant l’arrêt de l’alimentation des nouveau-
nés, il s’agit là d’un tabou ?
Depuis la loi Leonetti, le laisser mourir est la seule manière de finir ses jours à l’hôpital, dès
lors que la mort est recherchée. Qu’il s’agisse du début ou de la fin de la vie, on meurt
aujourd’hui de la même manière. L’euthanasie qui est accordée dans l’hexagone se réalise
dans cet unique moule, c'est-à-dire en suspendant l’hydratation et l’alimentation. Dans le cas
des nouveaux né, l’arrêt de l’alimentation artificielle prouve que la loi de 2005 n’a pas tout
réglé.

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué lors de vos différents séjours en unités de soins
palliatifs ?
Deux choses. La première c’est d’abord la compétence des personnels. C’est impressionnant.
Les cas cliniques sont affolants. On est dans des situations où le corps domine tout alors qu’il
n’a jamais été aussi faible. Je reste très étonné par l’activité palliative en tant que telle et
l’évidence de son immense qualité.
A côté de cela, la parole du malade et parfois même celle de ses proches n’est pas du tout
entendue, voire même déformée de mon point de vue. Je crois que le débat est là. Je suis
profondément choqué qu’il y ait tout une thèse autour du palliativisme qui justifie la
disparition de la parole du sujet malade, au nom de la qualité et des soins qui lui sont
proposés. Les soignants prenant même des décisions qui relèvent de la médecine et non de la
volonté du malade. Tout cela va très loin. En six mois d’observation sur le terrain, je n’ai vu
aucune directive anticipée. Cela n’existe pas. Quant à la personne de confiance, on frôle la
mascarade. Les dispositifs de la loi Leonetti, qui normalement constituent la parole du malade
ou qui servent à la garantir sont soit non utilisés, soit opposés au malade lui-même.
Mais en quoi la parole est-elle déformée ?
Tout simplement en n’accédant à aucune des demandes formulées. J’ai plusieurs fois vu des
patients et des patientes qui attendaient vraiment la mort.
Est-ce que vous avez ressenti, de la part de médecins, un malaise face à la non prise en
compte des demandes des patients ?
Non, il n’y a pas de malaise. Il y a au contraire une affirmation très ferme et très claire qu’on
ne saurait aller vers une injection létale ou tout simplement vers une sédation qui ferait que les
patients ne se réveillent pas.
Que faudrait-il faire pour que la voix des malades soit mieux entendue ?
Beaucoup de choses sont déjà faite. Le palliativisme est minoritaire même à l’intérieur des
soins palliatifs. Je trouve même que la cancérologie est bien rentrée dans cette dynamique de
personnalisation des soins du patient. On sent bien que c’est par là que les choses se passent.
Qu’attendez-vous de la mission du Professeur Didier Sicard mise en place par François
Hollande sur la fin de la vie ?
L’euthanasie est une réponse institutionnelle. Ce n’est rien ou plutôt c’est tout simplement la
manière dont nous répondons à une demande de mourir. Je crois qu’il faut que la mission
Sicard avance des propositions dans le sens de l’aide active à mourir. J’admets mal que l’on
n’offre comme seule porte de sortie que la suspension de l’alimentation et de l’hydratation à
des gens qui se sont battus, qui ont lutté contre la maladie ou le handicap. Que cette mission
réfléchisse cinq minutes à ce que cela signifie d’être emmuré dans son corps ! J’ai le
sentiment que l’on peut proposer mieux que cette réponse du laisser mourir pour des gens qui
ont tant lutté pour la vie. Je souhaite que la commission Sicard rebatte les cartes sur la base
d’un diagnostic basique de situation. Il faut arrêter de dire que la loi Leonetti n’est pas
connue, elle est très bien connue en France. Il faut la rediscuter. J’ai vu des patients venir

parler au nom de la loi Leonetti et les professionnels ne pas en tenir compte. J’attends de la
commission Sicard qu’elle s’affranchisse enfin de ses interdits habituels.
La commission Sicard au travail. Lors d’un déplacement dans une maison médicale dédiée
aux soins palliatifs, François Hollande avait annoncé la création d’une mission de réflexion
sur la fin de vie présidée par le Pr Didier Sicard, un ancien président du Comité consultatif
national d'éthique(CCNE). Ce dernier devra rendre un rapport sur la question avant le mois de
décembre. "L’objectif de cette mission est de recueillir l’avis de la société sur la question
plutôt que celui des experts", a fait savoir le Pr Sicard.
Le 22 septembre dernier, le premier débat public sur la fin de vie a été organisé dans le cadre
de cette mission de réflexion. Il s’est tenu à Strasbourg et a réuni 150 personnes. Sept autres
réunions devraient suivre.
1
/
3
100%